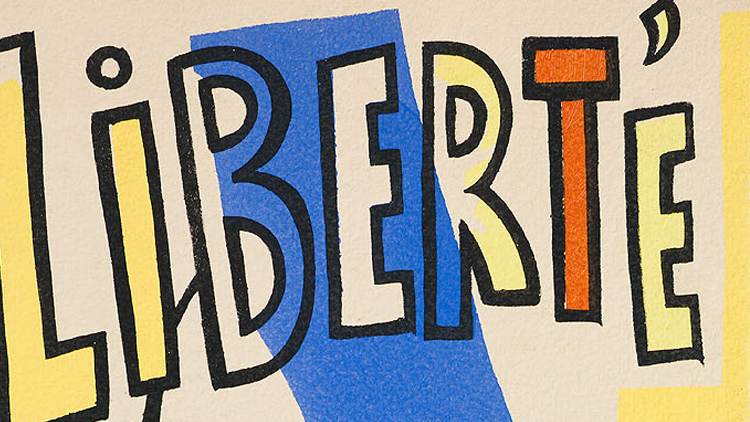Pascal Chabot : “La finance, la robotisation ou la numérisation touchent tous les aspects de notre existence”
Olivier Pascal-Moussellard, Télérama, 19/03/2018.
Peut-on encore choisir sa vie dans un monde contrôlé par des forces sur lesquelles nous n’avons aucune prise ? Pour résister au système, cultivons nos priorités, répond le philosophe belge, auteur d’un essai remarquable, “Exister, résister. Ce qui dépend de nous”.
Dans les années 1980, quand on se projetait dans l’avenir, on imaginait un monde où la technologie jouerait le premier rôle dans nos modes de vie, pour le meilleur et pour le pire. Ce monde est désormais sous nos yeux, nous baignons dedans. Un cocktail sucré-salé de robotisation, de vie numérique, de crise écologique, de progrès génétiques, d’intelligence artificielle, de financiarisation tous azimuts, mais aussi de « transparence » et de montée des populismes. Bref, tout ce que le philosophe belge Pascal Chabot, dans un essai remarquable, Exister, résister. Ce qui dépend de nous, appelle les « ultraforces ».
En trente ans, elles ont chamboulé nos mœurs, au travail, dans la famille, nos relations amoureuses, notre rapport au temps ou notre perception de l’avenir. Est-ce un bien, est-ce un mal ? Le tissage de nos vies quotidiennes avec ces ultraforces est devenu si fin et complexe que l’on ne peut plus répondre de manière tranchée. Deux choses semblent assurées, souligne Chabot : ce nouveau monde est un système en constante reconfiguration ; et l’injonction permanente à s’y adapter fragilise considérablement nos existences. Il faut donc poser un regard lucide sur ce réel fluide et bigarré, et se demander ce qui importe vraiment pour nous, individuellement et collectivement.
Qu’est-ce qui distingue les « ultraforces » contemporaines des simples « forces » à l’œuvre jusqu’au début des années 2000 ?
Les forces anciennes, même si elles avaient un impact direct sur nos modes d’existence, restaient circonscrites à un certain périmètre. Que l’on parle de technologie, comme les forges ou les centrales électriques, de techniques comme la cuisine, ou de forces politiques, elles pouvaient rayonner dans la société mais ne régentaient pas tous les aspects de cette dernière. Ces forces avaient une origine géographique précise, alors que les ultraforces, elles, sont globales et mondialisées, et surtout transversales : la finance, la robotisation, la numérisation ou la médicalisation touchent tous les aspects de nos existences, fixent le cadre des institutions, et modifient à leur avantage les règles du système.
Prenez Google (mais c’est vrai pour les autres Gafa) : c’est à la fois une force technologique, une puissance financière (vu la valeur de sa cotation en Bourse), politique et psychique (son usage a un impact direct sur la façon de penser des individus) et une force qui cherche à orienter notre rapport au futur, via ses expérimentations sur le transhumanisme. D’où notre impression d’être submergés, encerclés… Chercher une prise pour contrecarrer ces forces est un réflexe naturel, mais aucun bras de fer n’est possible avec elles, même l’administration américaine ou l’Union européenne ont du mal face à Apple ou Google. D’autant que ces derniers opèrent une espèce de chantage : « Si vous n’êtes pas d’accord, disent-ils en substance, rien ne vous empêche de sortir du système, de quitter nos services. » C’est faux : zapper Google de nos vies n’est plus une option, son emprise est trop importante sur des rouages clefs de la société.
Ces ultraforces professent pourtant une neutralité politique…
Elles ne représentent pas un pouvoir politique comme les autres : elles s’imposent sans négociation dans le paysage commun, régissent sans discussion et règnent sans Etat (d’âme). Voyez les difficultés de la Commission européenne pour faire plier les Gafa, qui ne payent quasiment pas d’impôts dans les pays ou ils sont implantés. La tâche est d’autant plus ardue que ces géants du numérique ou de la finance se présentent comme de belles âmes qui ne nous veulent que du bien : « Nous mettons juste à votre disposition les moyens de faire passer des contenus, ou la capacité d’emprunter pour faire naître les beaux projets qui vous tiennent à cœur, etc. » L’impact de ces géants sur nos existences exigerait de les traiter comme des acteurs responsables, fiscalisables et sommés de répondre devant un Parlement de leur action, mais ce n’est pas le cas. Car le rapport de force avec les ultraforces est presque inexistant, elles sont indifférentes et presque impassibles. En fait, notre lien avec elles est plutôt un anti-rapport…
En même temps, leur capacité à faire avancer le monde continue de fasciner…
L’humanité vit désormais au rythme de la disruption. La disruption, c’est une innovation radicale qui place son inventeur dans une situation de monopole quasi absolu sur le marché qu’il vient de créer — ce qui lui permet de rafler la mise, sans crainte de concurrent. Or, faire preuve de « mentalité disruptive » s’est imposé comme la nouvelle norme ! Certains s’en félicitent, ils oublient simplement que la plupart des activités humaines, pendant des siècles, voire des millénaires, n’ont jamais cherché à être disruptives. Un artisan qui cherchait à fabriquer correctement un vêtement, un agriculteur attaché à protéger sa terre, un cuisinier obsédé par son savoir-faire ne poursuivaient pas des manières de faire radicalement nouvelles. Seuls les artistes — un Michel-Ange, un Flaubert, un Manet — se montraient volontiers « disruptifs » — et, de fait, ils sont à l’origine d’une nouvelle école.
Désormais la disruption est partout. Des pans entiers de l’existence, qui semblaient totalement à l’abri de la commercialisation, deviennent par exemple monnayables. Ainsi le langage. Avec ses algorithmes, Google a créé, entre l’argent et le vocabulaire, un lien qui aurait encore semblé inimaginable il y a quinze ans (sans parler d’il y a trois siècles). Les mots valent de l’argent, des gens se disputent aux enchères le référencement de « restaurant » et « Champs-Elysées » pour être sûrs de sortir en tête des listings sur le moteur de recherche… Ce culte de la disruption me semble profondément dommageable, car il fait l’apologie d’une mentalité fondamentalement non sociale. On est sorti du modèle ancien de concurrence — étymologiquement : « courir ensemble » — pour basculer dans celui du « winner takes all » (le gagnant rafle la mise), et l’on n’est pas obligé de s’en réjouir.
Ne peut-on mieux contrôler l’impact de ces ultraforces sur nos vies quotidiennes ?
La peinture de Francis Bacon, analysée par le philosophe Gilles Deleuze, nous offre une bonne métaphore de la difficulté. La puissance des tableaux de Bacon, disait Deleuze, naît de la capacité du peintre à laisser hors champ la force qui tord horriblement corps et visages. Ne sont visibles sur la toile que des déformations angoissantes dont on ne connaît pas l’origine ! De la même façon, sur un plan philosophique, ou existentiel, ne pas pouvoir assigner une origine précise aux malaises qui nous touchent au quotidien est extrêmement troublant. C’est vrai des ultraforces : une puissance comme Google est le résultat syncrétique de plusieurs histoires, qui relèvent à la fois des mathématiques, de la logique, des microprocesseurs et des faisceaux de communication, qu’il faut ensuite croiser avec l’histoire récente du capitalisme et des nouvelles manières de penser les algorithmes fonctionnant avec la langue… Bref, l’objet Google est le résultat de tellement de forces conjuguées que le désigner comme l’auteur unique des bienfaits ou des malédictions de notre existence, comme on le faisait avec les dieux de l’Antiquité, est voué à l’échec : on ne peut pas tout réduire à la manipulation du monde par une dizaine de Gafa comploteurs. Soyons paranoïaques, certes, mais… pas trop !
On peut aussi choisir la fuite, le retrait du monde…
La déconnexion, le repli et la fuite sont effectivement des options, et je leur trouve d’ailleurs quelque chose de magnifique : après tout, elles visent à retrouver ce qui importe vraiment, à travers un mode d’existence plus proche de la nature, de la création, etc. Mais la rupture radicale est une chose difficile : aujourd’hui tout est tissé, relié, emmêlé, on ne fonctionne plus sur le modèle des grandes dichotomies, du temps où l’on pouvait encore se dire « dedans » ou « dehors », participer à la vie sociale ou se retirer du monde, être un zélateur du système ou un révolutionnaire. Je crois plus prometteur aujourd’hui de s’interroger sur ce que cette étrange réalité dans laquelle nous baignons fait de nous. Qui suis-je face à ces ultraforces ? Quel sujet clivé suis-je devenu face à un système qui me transforme en bon petit soldat « adapté » ? Reprendre le contrôle sur ce qui m’importe vraiment, se souvenir que « je suis pluriel » et pas un simple petit soldat clivé me paraît une saine posture. La tentation de fuir est grande mais je crois qu’il faut rester, coûte que coûte. Rester, et résister…
Certains rêvent de « renverser le système »…
« Système » et « antisystème » sont des notions complexes. Pendant la campagne présidentielle française, elles ont connu un grand succès dans la bouche des candidats, sans que l’on sache précisément ce qu’elles recouvraient. Mot-valise, « système » sert surtout de repoussoir où entasser tout ce qui nous gêne chez les candidats… sans pour autant que nous proposions de modèle alternatif, bien que l’on ne sache pas encore l’être humain capable de vivre en dehors de tout système ! Il faut penser le changement indispensable en faisant le deuil de cet idéal révolutionnaire qui a hanté toute la pensée du XXe siècle et qui affirmait qu’il existe quelque part un état « pur », ou « originel », vers lequel nous pourrions retourner. Cet idéal « rousseauiste » n’est plus endossé par grand monde aujourd’hui. L’infrastructure technique dans laquelle se déploie le monde est devenue trop complexe et entremêlée, on ne voit pas très bien comment le « système » pourrait être renversé sans que la vie de milliards d’individus s’arrête — question communication, transports, approvisionnement, etc. Je préfère donc parler de « transition » plutôt que de révolution. Mais les transitions aussi peuvent avoir leur radicalité !
Instiller un peu plus de raison dans le système ne suffira pas à le réguler…
Le rationalisme des Lumières a opposé la raison à la force, mais cette opposition tranchée n’est plus possible aujourd’hui. Car rien n’est plus rationnel, rien ne repose plus sur les mathématiques et la logique que les ultraforces qui irriguent notre système. Essayez de discuter avec les banques, vous découvrirez à vos dépens que la rationalité est de leur côté…
Avec quoi résister, si la raison ne suffit plus ?
Avec la justice. Pas seulement une justice au sens institutionnel du mot, pilier de notre démocratie : la justice au sens ou pouvaient l’entendre les philosophes Pascal, Simone Weil et Vladimir Jankélévitch. Être juste, c’est continuer à faire exister ce qui est immortel dans la nature et chez autrui, préserver la dignité en toute chose — même ce qui semble d’importance mineure, voire misérable —, sans chercher à l’écraser. Cette notion de justice, qui refuse la prédation de ce qui est commun et la règle du « gagnant remporte la mise », et qui veut mettre en avant « ce qui est important pour nous », est au cœur des pensées de la transition.
Il faut pour cela développer « un concept du soi, écrivez-vous, car c’est de lui que vient le désir d’exister en résistant »…
Lorsque je travaillais sur le burn-out, on m’expliquait cette pathologie comme un « trouble de l’adaptation ». Mais dire à ceux qui en sont frappés : « Votre problème, c’est que vous ne savez pas vous adapter » me paraît paradoxal. Car enfin l’adaptation n’est pas une fin en soi : nous ne nous adaptons pas pour être adaptés mais pour nous réaliser ! Le système évacue le problème en faisant comme si le fait de donner du sens à sa vie était une question purement privée, il ne nous demande qu’une chose : nous adapter. Or, ce qui s’adapte en nous, c’est notre moi, c’est-à-dire la part de notre être qui comprend les codes et s’y conforme, suit les procédures, les rituels de communication, etc. Ne le dénigrons pas trop vite, d’ailleurs, car il y a de la grandeur à bien fonctionner dans la société. Mais l’erreur, tragique, est de réduire l’individu à ce seul moi. Et d’oublier le « soi ».
C’est-à-dire ?
Le « soi » est une manière philosophique de dire que nous sommes des individus capables de nommer ce qui leur importe fondamentalement. Pour mieux le comprendre, demandez-vous ce que vous aimez chez l’autre quand vous aimez vraiment. Nous n’aimons jamais une personne pour son « moi » adapté au système mais pour ses qualités propres, celles qui font précisément qu’elle est elle, et pas une autre. Ce que nous aimons, c’est ce qui compte pour elle, c’est-à-dire son « soi ». Et chacun est libre évidemment de décider ce qui compte vraiment. Pourtant, il me semble qu’on peut déceler quelques invariants constitutifs en chacun de nous : la « saveur d’exister », par exemple, c’est-à-dire le rapport sensuel que nous tissons avec le monde, cette sensualité qui passe dans notre rapport à la nature, à ce que nous aimons manger, écouter, voir…
Un autre marqueur universellement partagé est la recherche de stabilité et d’équilibre — alors que la mentalité disruptive, on l’a vu, promeut justement le déséquilibre comme mode d’existence privilégié. Notre corps lui-même est une machine à retrouver des équilibres ! Autre marqueur : il me semble que la redécouverte de soi n’est jamais… une fin en soi : elle ouvre sur un désir de l’autre. Le cocooning, la recherche de bien-être ont leur importance, mais c’est n’aller qu’à mi-chemin avec ces instruments que de leur refuser de nous mener vers autrui. Sinon nous finirons tous comme le héros du film Cosmopolis, de David Cronenberg, enfermé dans sa limousine et se disant, alors qu’approche la fin du monde, que finalement il a réussi à se construire son petit pré carré de qualité, et que ça lui suffit… Le soi est toujours relié à l’autre, et c’est quand il se mue en « hors de soi », dans l’amitié, ou l’amour, après avoir défini ce qui lui importe vraiment et dépend de lui, qu’il est le plus épanoui.
Savoir ce qui dépend de nous n’est pas une tâche facile…
Cela nous rapproche du philosophe Épictète (50-135 apr. J.-C.) et de la question posée dans son fameux Manuel : « Qu’est-ce qui dépend de toi ? ». L’homme, disait Épictète, ne peut trouver le bonheur qu’en s’attachant à ce qu’il maîtrise, et en laissant de côté le reste. Mais le sage du Manuel se sauvait plus ou moins seul, dans une nature dont il n’avait pas vraiment à se soucier. La guerre, disait Épictète, est toujours lointaine, elle ne dépend pas de nous, donc ne nous en préoccupons pas ! Peut-être sommes-nous devenus plus sages que le sage…
Grâce, ou à cause, des ultraforces qui nous informent en continu, nous ne pouvons plus vivre enfermés dans une forteresse, et nous savons aussi que certaines de nos actions peuvent avoir un impact, même sur ce qui est lointain. Tout est lié, on ne peut plus, raisonnablement, se tenir éternellement à l’écart : impossible de délocaliser nos industries polluantes et de s’en laver les mains ! Là ou je rejoins Épictète, en revanche, c’est dans l’importance qu’il donne à la formulation claire de ce qui nous importe, parce que c’est précisément ce qui fait défaut aux idées politiques. C’est dans cette capacité à sortir de notre souffrance de sujets clivés, de choisir la quête d’un soi plus libre (et sans doute plus seul) pour dire haut et fort « Ceci est absolument essentiel pour moi et je me battrai pour le défendre », que se rejoignent la culture et la politique.
Exister, résister, exister en résistant… Ce pourrait être le slogan d’un nouvel existentialisme !
Comme disait Sartre, nous sommes ce que nous faisons de notre vie et nous n’échapperons pas à cette responsabilité. Et trouver son rôle dans le monde reste la grande affaire. Il faut donc prendre le risque de la liberté, « y aller », refuser cette mauvaise foi que Sartre décrivait si bien et qui consiste à toujours se trouver des excuses. Le génie de Sartre est d’avoir dit « non » à la croyance que nous ne sommes que des choses prises dans un système qui nous dépasse. Notre moi est pris, c’est vrai. Mais penser que l’individu tout entier est prisonnier de ce filet, c’est faire fi de cette liberté dans laquelle nous devons toujours créer notre devenir.
Pascal Chabot en quelques dates
1973 Naissance.
2011 Les Sept Stades de la philosophie (PUF).
2012 Simondon du désert, film écrit avec François Lagarde.
2013 Global Burn-out (PUF).
A lire
Exister, résister. Ce qui dépend de nous, Pascal Chabot, éd. PUF.
Que faire de notre liberté ?
Quel monde voulons-nous créer ?, se demandaient Sartre et Camus, qui nous sommaient d’agir. Pour l’essayiste britannique Sarah Bakewell, auteure de l’ouvrage “Au café existentialiste”, cette réflexion est toujours d’actualité.
« Bon, et maintenant qu’est-ce qu’on fait ? » Quelle génération de jeunes (ou de moins jeunes) ne s’est pas posé la question, pour guérir le monde de ses maladies chroniques, la pauvreté, l’injustice ou les inégalités… ? Dans le Paris d’après guerre, un quarteron d’intellectuels plongé, autour de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, dans un paysage politique, culturel et intellectuel en ruines, a tenté d’y répondre. Avec une ambition démesurée : faire coïncider le désir de reconstruire le monde sur de nouvelles bases politiques et l’existence vécue, dans ses dimensions les plus intimes. L’existentialisme était né. Il allait faire vibrer Paris avant de se diffuser partout dans le monde jusqu’en 1968, mêlant intuitions géniales et adhésion aveugle et tragique au communisme soviétique. Que faut-il garder de cette passionnante aventure philosophique ? Pour Sarah Bakewell, auteure d’un essai délicieux, Au café existentialiste, notre propre environnement, lui aussi branlant, peut avantageusement s’inspirer de la bande de Sartre, Camus et Merleau-Ponty. Peut-être pas pour les réponses qu’ils ont offertes, mais pour l’acuité, fulgurante et toujours actuelle, des questions qu’ils ont posées.
Comment définir l’existentialisme ?
Malgré leurs différences, les existentialistes regardent tous l’existence comme l’expérience personnelle et toujours unique de chacun d’entre nous. Leur réflexion ne commence donc pas, comme pour Descartes, par un axiome suivi d’une série d’investigations théoriques, mais avec le « moi ». Par ailleurs, tous ou presque définissent l’existence à partir de la liberté qu’a chacun d’entre nous d’être le créateur de sa propre vie. Nous sommes « jetés dans le monde » et forcés de nous demander quel genre d’être nous souhaitons devenir. Cette liberté provoque une profonde anxiété, comme l’ont bien analysé Jean-Paul Sartre et, avant lui, Soren Kierkegaard. Elle est donc à la fois très excitante et très angoissante…
Tout part d’une nouvelle façon d’observer le monde…
A la question de Kant « Comment pouvons-nous être sûrs de quelque chose ? » les phénoménologues Edmund Husserl et Martin Heidegger répondent par la suggestion que l’on peut décrire de manière extrêmement rigoureuse tous les phénomènes qui se présentent à nous, et philosopher sur eux. Husserl parlait d’ « aller aux choses elles-mêmes », en rejetant les présupposés et préjugés qui accompagnent généralement notre observation du monde, pour se concentrer vraiment sur l’expérience elle-même. Cette méthode plaît évidemment à ceux qui, comme Sartre, sont écrivains avant d’être philosophes, en tout cas au début de leur carrière. Les existentialistes vont la combiner avec leur réflexion sur l’angoisse de la liberté.
« Se sentir heureux n’est pas tout, il faut sortir de soi et transformer le monde. »
La méthode peut s’avérer utile dans tous les domaines, y compris en politique…
En Tchécoslovaquie pendant les années soviétiques, la phénoménologie était une arme très efficace pour réduire à néant le non-sens absolu auquel les citoyens étaient soumis, dans un espace politique où rien n’était vrai, rien ne pouvait être cru. Sous la couche épaisse des mensonges du régime, ils maintenaient grâce à elle une expérience du monde solide. Dans un monde pollué par les fake news et la confusion de l’information, elle nous serait aussi très utile…
D’autant que, si l’on suit Sartre, nous n’avons pas vraiment le choix : nous sommes engagés dans ce monde, que nous le voulions ou pas…
Sartre pensait que c’est à la fois le propre de la nature humaine que de ne pas pouvoir fuir le monde dans lequel elle est plongée et un devoir moral de s’engager vraiment. Est-ce que ses propres engagements politiques ont toujours été lucides ? C’est une autre affaire. Sa tentative de réconcilier existentialisme et théorie marxiste est une belle démonstration de certaines incompatibilités… On pourra d’ailleurs se demander longtemps pourquoi il a persisté dans ses erreurs. Mais je ne suis pas sûre qu’on puisse parvenir à une clarté absolue dans l’explication de nos choix !
Comment décririez-vous la différence entre l’existentialisme de Sartre et celui d’Albert Camus ?
Camus a très vite perçu les impasses du rêve socialiste de la société communiste parfaite, ce que n’a pas su faire Sartre, qui est passé du stalinisme au maoïsme et au castrisme, alternant les perspectives sur une même promesse qui ne fonctionnait pas. Pour Camus, il faut se méfier des grands soirs. L’homme doit se rebeller contre sa condition, disait-il, mais sans croire à la solution idéale. Sartre, lui, avait le sentiment qu’un jour un monde parfait, sans souffrance ni pauvreté, où le fascisme ne serait plus qu’un lointain souvenir, verrait le jour. Camus ne partageait pas cette illusion. Mais les deux hommes se distinguaient aussi, fondamentalement, sur ce que signifie « donner du sens à sa vie » à travers ce que l’on fait. Camus avait un sens très aigu de l’absurdité de l’existence et embrassait cette absurdité en affirmant que l’aventure méritait malgré tout d’être vécue ; pour Sartre, il y a du sens dans tout ce que nous faisons, même si aucun Dieu n’est là pour fixer la direction.
Simone de Beauvoir rappelle dans ses souvenirs à quel point, en 1945, « tout était possible »… Le monde d’aujourd’hui, avec ses crises politique et écologique, n’est-il pas propice lui aussi à une révolution des modes d’existence ?
Pour les existentialistes, n’importe quelle période de l’Histoire est propice au changement : ce qui construit le futur, c’est ce que nous décidons de faire de nos vies. La responsabilité vient toujours avec la liberté, quelle que soit la période pendant laquelle nous nous trouvons être sur terre. Une fois qu’on a dit cela, pourtant, je crois que l’incertitude entourant certaines périodes de l’Histoire élargit le champ des possibles. La fin de la Seconde Guerre mondiale avait évidemment ce potentiel. Des questions fondamentales surgissaient : comment croire en l’être humain après ce qui vient de se passer ? Comment même croire en un futur ? Comment garder confiance en l’Etat ou en l’Eglise quand tout semble si proche du chaos ? Sous les constats négatifs perçaient de nouvelles possibilités. Toutes proportions gardées, c’est aussi le cas aujourd’hui. Le paysage politique change, le déferlement technologique dans lequel nous sommes entraînés oblige à repenser notre condition humaine, etc. Sur ce point, la vraie question, soulignait Heidegger, n’est pas de savoir ce que nous allons inventer d’autre, mais ce que nos inventions nous font, comment elles transforment notre être-au-monde. Tout cela arrive si vite ! Comment naviguer dans ce nouveau monde et décider de ce qu’il faut faire ?
L’existentialisme offre-t-il des réponses ?
Je n’ai jamais pensé que Sartre et consorts pouvaient nous aider à résoudre nos problèmes. Mais je crois qu’ils posaient de bonnes questions : que sommes-nous, au juste ? Que faire de notre liberté ? Par extension, quel monde voulons-nous créer, politiquement, avec cette liberté ?
Les théories du développement personnel, la quête obsessionnelle de la « réalisation de soi » ne se substituent-elles pas au souci du monde ?
Le développement personnel serait de toute évidence perçu par Sartre comme un moyen frauduleux d’utiliser notre liberté. Parce que précisément il ne nous engage pas du tout dans le monde mais se focalise sur le regard intérieur — voire sur notre nombril. L’existentialisme a toujours insisté sur le fait que se sentir libre et heureux n’était pas tout, et qu’il fallait sortir de soi et transformer le monde pour le meilleur. Bien sûr, un meilleur équilibre intérieur permet sans doute un contrôle plus efficace de son action, et la méditation aide probablement, mais si vous aviez demandé à Sartre, il vous aurait répondu que pour que les gens aillent mieux améliorer leurs conditions de travail et mieux les payer seraient beaucoup plus efficace…
Par ses errements politiques, Sartre n’a-t-il pas détruit l’idée même d’engagement politique radical ?
Beaucoup de gens ont été tentés par la solution communiste et se sont brûlé les doigts. Cela a certainement terni l’image de l’engagement radical. Mais des générations ont passé depuis Sartre, et le paysage politique change vite. Sortir de son cocon de bien-être et manifester sa désapprobation sur la trajectoire actuelle du monde attire de nouveau. En Grande-Bretagne notamment, où l’on s’est rassemblé en masse pour défendre la sécurité sociale. Pour ce qui est de Sartre et Beauvoir, n’oublions pas que leur aveuglement politique était largement partagé dans certains milieux. Lorsque j’étais à la fac, la question n’était pas de savoir si on était de gauche ou de droite mais trotskiste, marxiste-léniniste ou mao ! Aujourd’hui cela paraît inouï, mais derrière tout cela il y avait un réel désir d’en finir avec l’inégalité, la pauvreté, les guerres, le fascisme et tout ce « vieux » monde qui s’était effondré. L’impression dominait aussi que l’on pouvait redémarrer à zéro. La suite a montré que c’était plus compliqué qu’on ne le pensait… Mais le désir peut toujours nous habiter, sans forcément nous emmener au même endroit.
On peut encore se dire « existentialiste », aujourd’hui ?
A 16 ans, lire La Nausée m’a donné envie de faire de la philosophie. Ma curiosité me pousse à revenir sur cette aventure philosophique, et à me demander pourquoi je trouvais Sartre et son cénacle si excitants… et pourquoi je vois désormais le monde de façon si différente. J’ai relu ces livres et la réponse est tombée : je continue de regarder l’approche de la vie et du monde par les existentialistes avec une certaine fascination mais… pour des raisons différentes de ce que j’avais vu au départ. A 19 ans, j’étais intéressée par la dimension politique et ce que nous devrions faire pour les autres. Aujourd’hui, ce qui me semble important, c’est le questionnement philosophique sur l’ « être humain » dans l’environnement écologique et social préoccupant que nous partageons. J’étais plus individualiste dans ma jeunesse, l’anxiété que l’on ressent quand on se lance dans le monde me torturait ; aujourd’hui, c’est la question de ce qui importe vraiment à l’humanité et dépend de nous que je me pose. Alors, même s’ils se sont beaucoup trompés, les existentialistes valent certainement la peine d’être lus aujourd’hui pour la façon dont ils ont, à leur époque, pris à bras-le-corps ces thématiques.
Sarah Bakewell
1963 Naissance au Royaume-Uni.
2010 National Book Critics Circle Award pour sa biographie de Montaigne.
2013 Comment vivre ? Une vie de Montaigne en une question et vingt tentatives de réponse, éd. Albin Michel.
A lire
Au café existentialiste. La liberté, l’être & et le cocktail à l’abricot, de Sarah Bakewell, éd. Albin Michel.