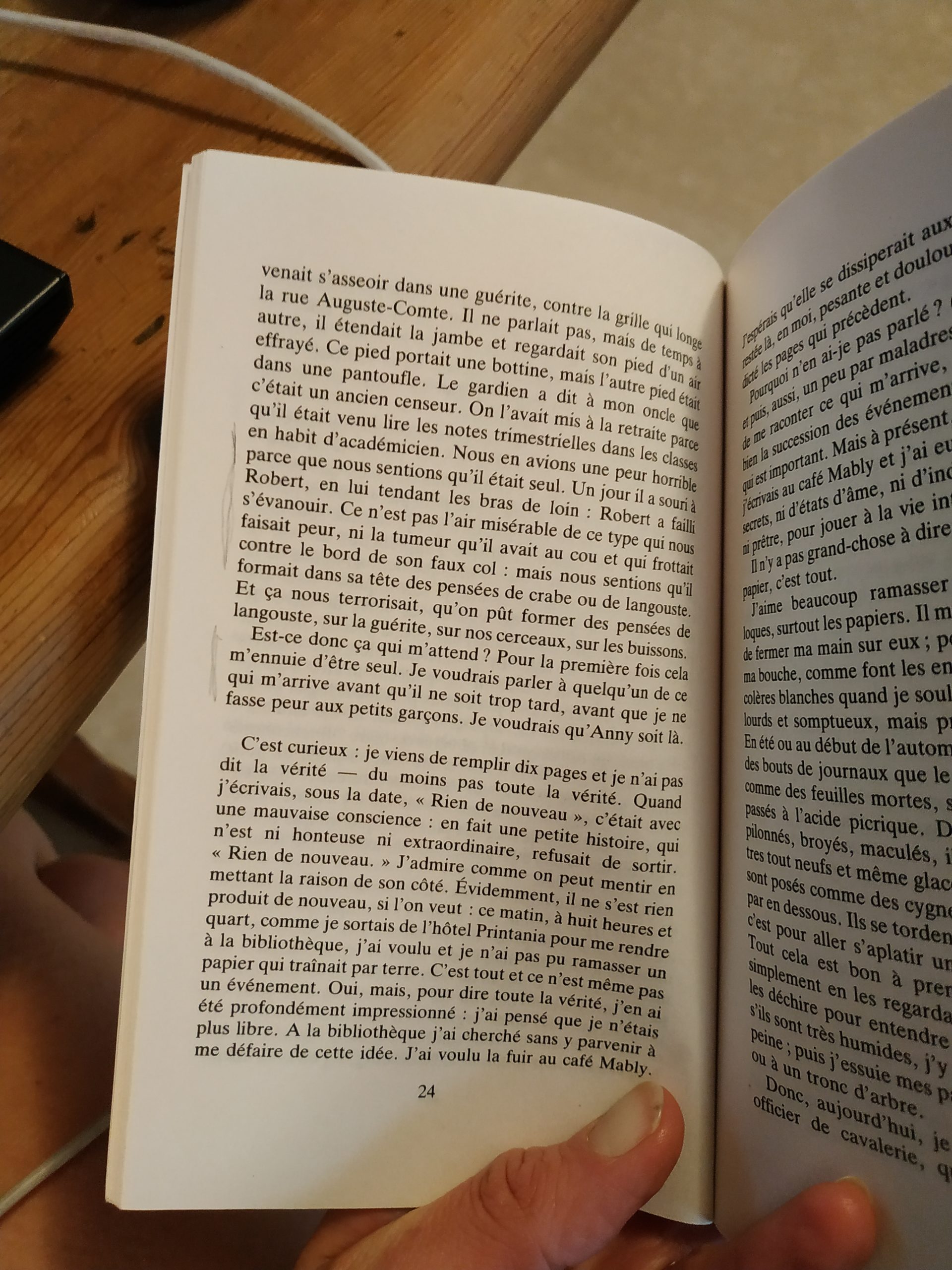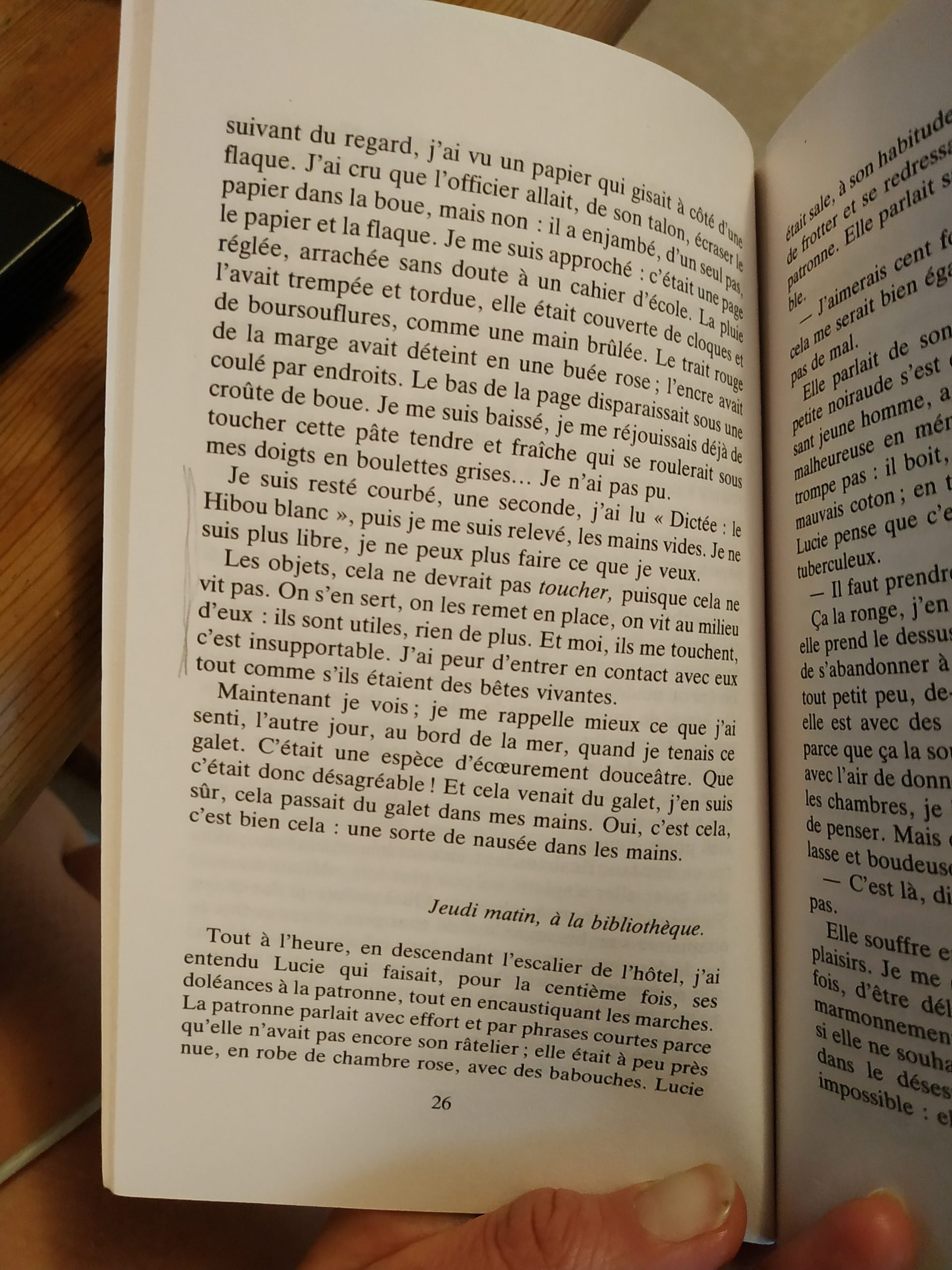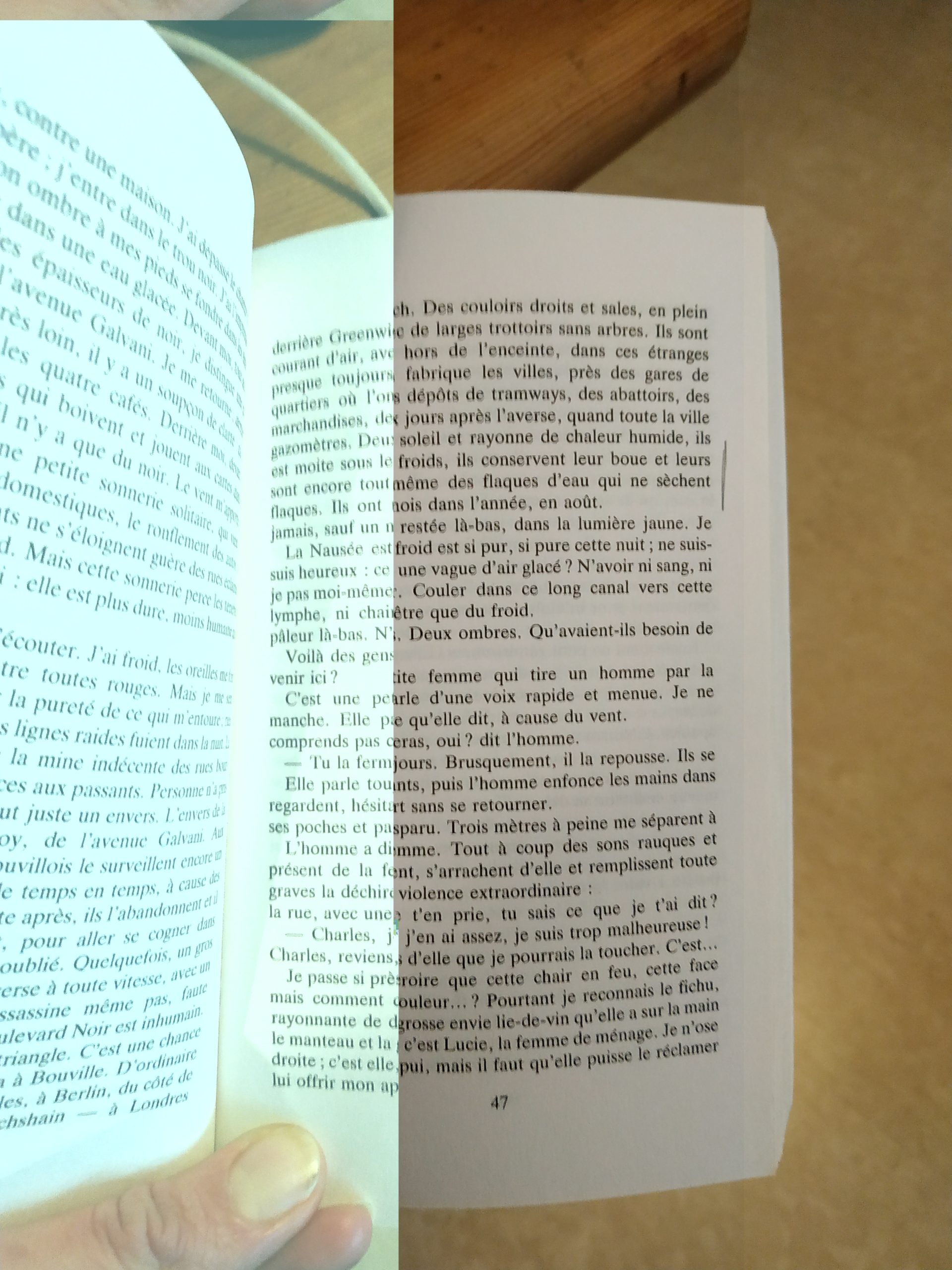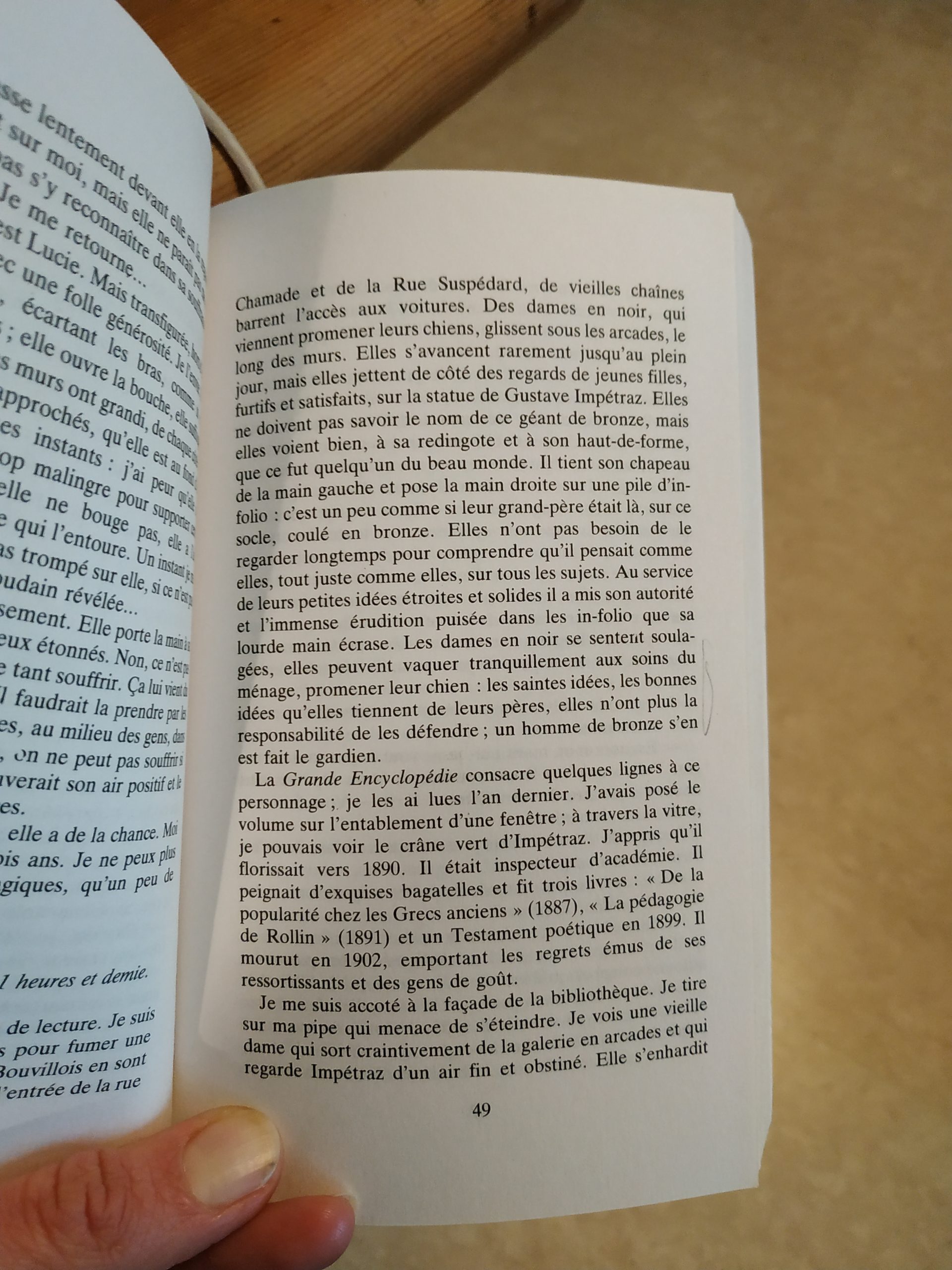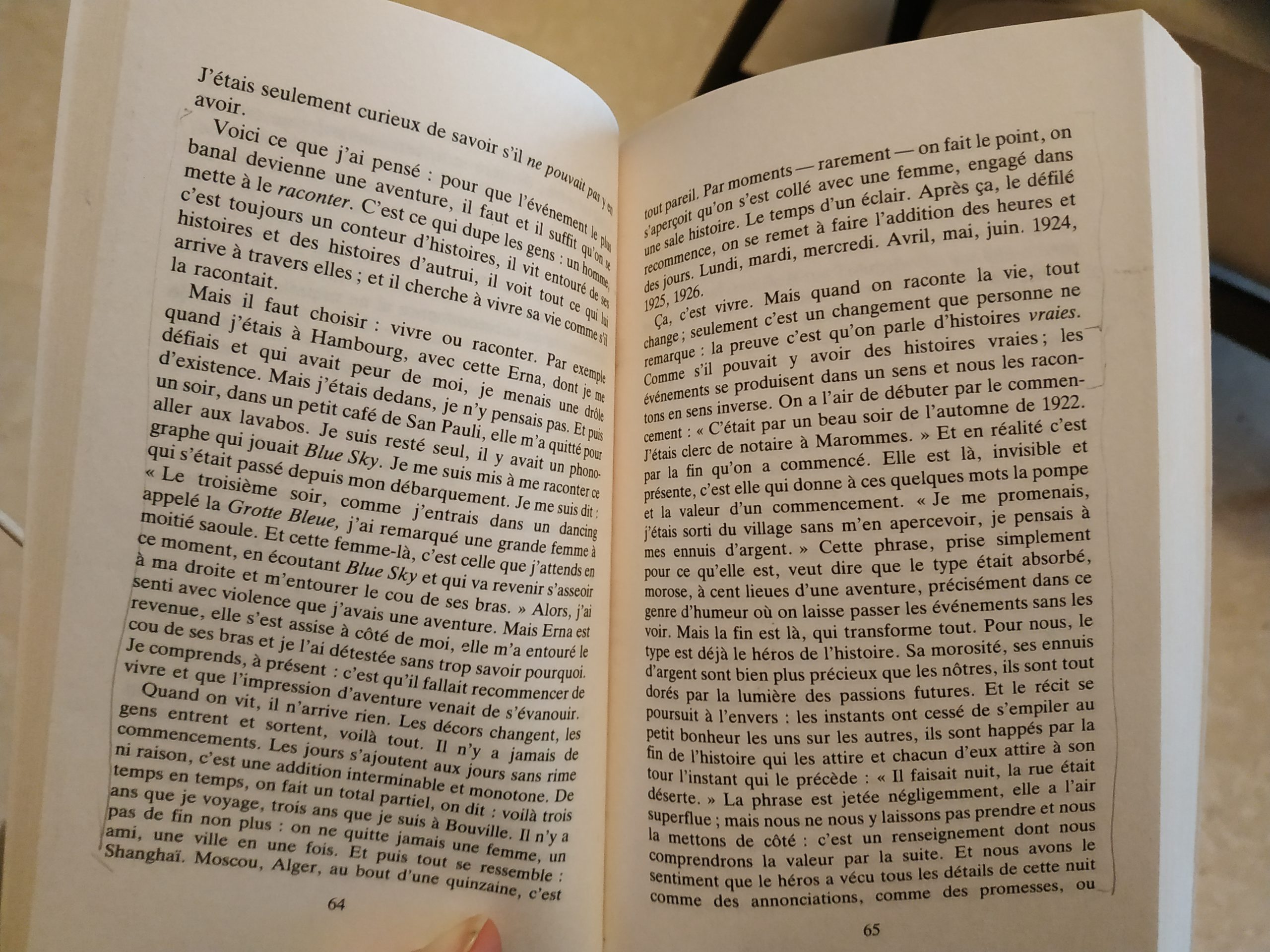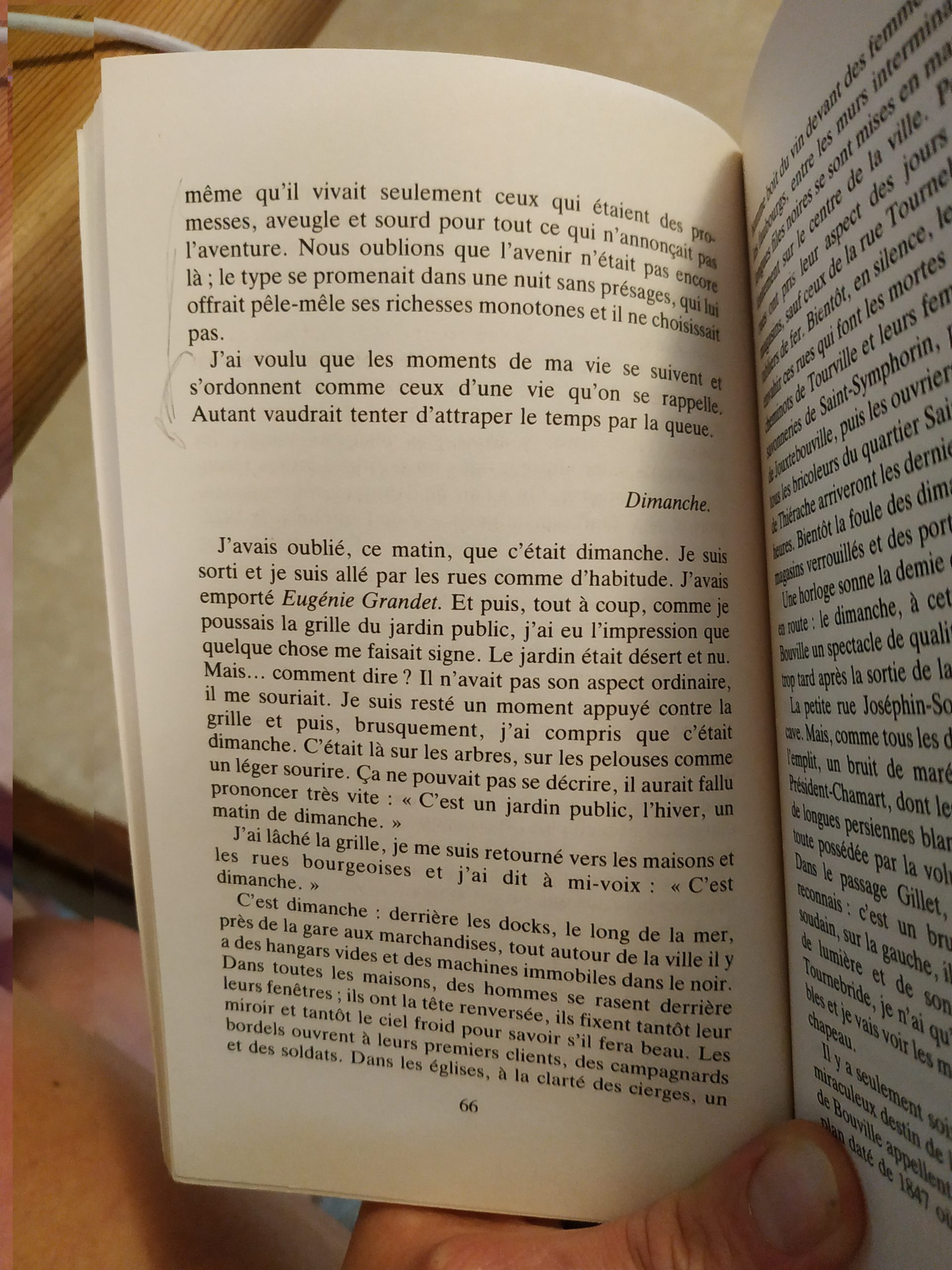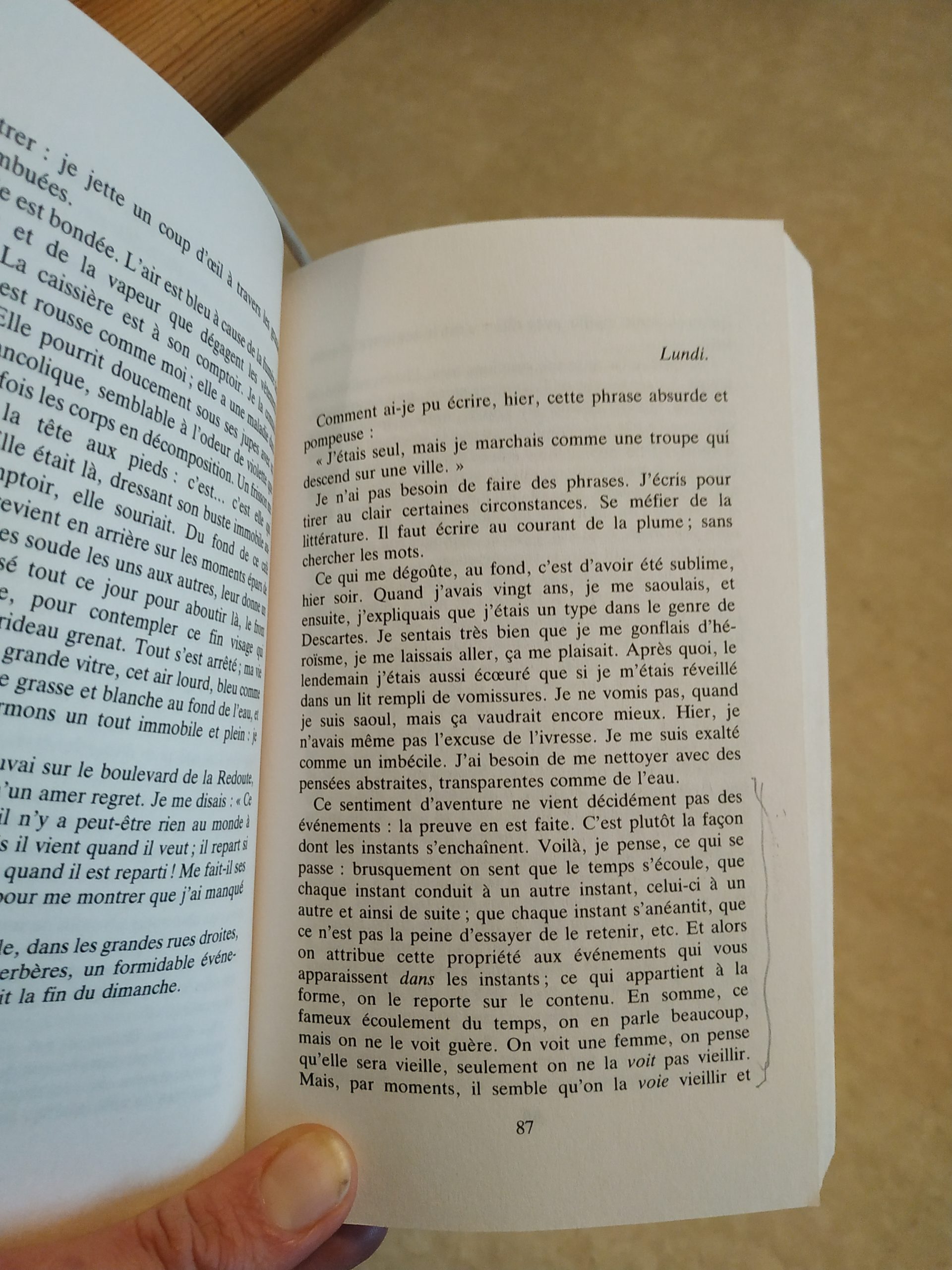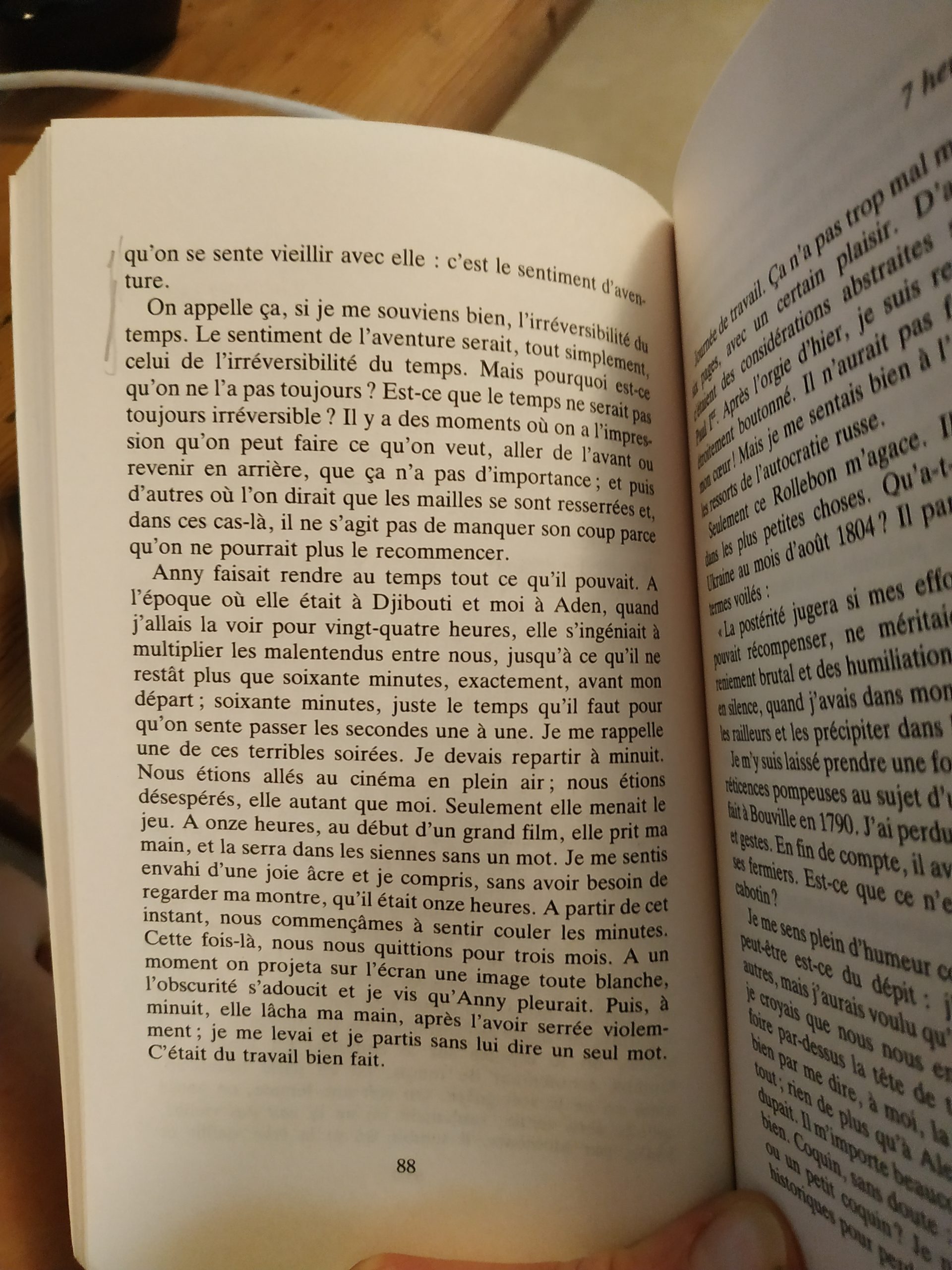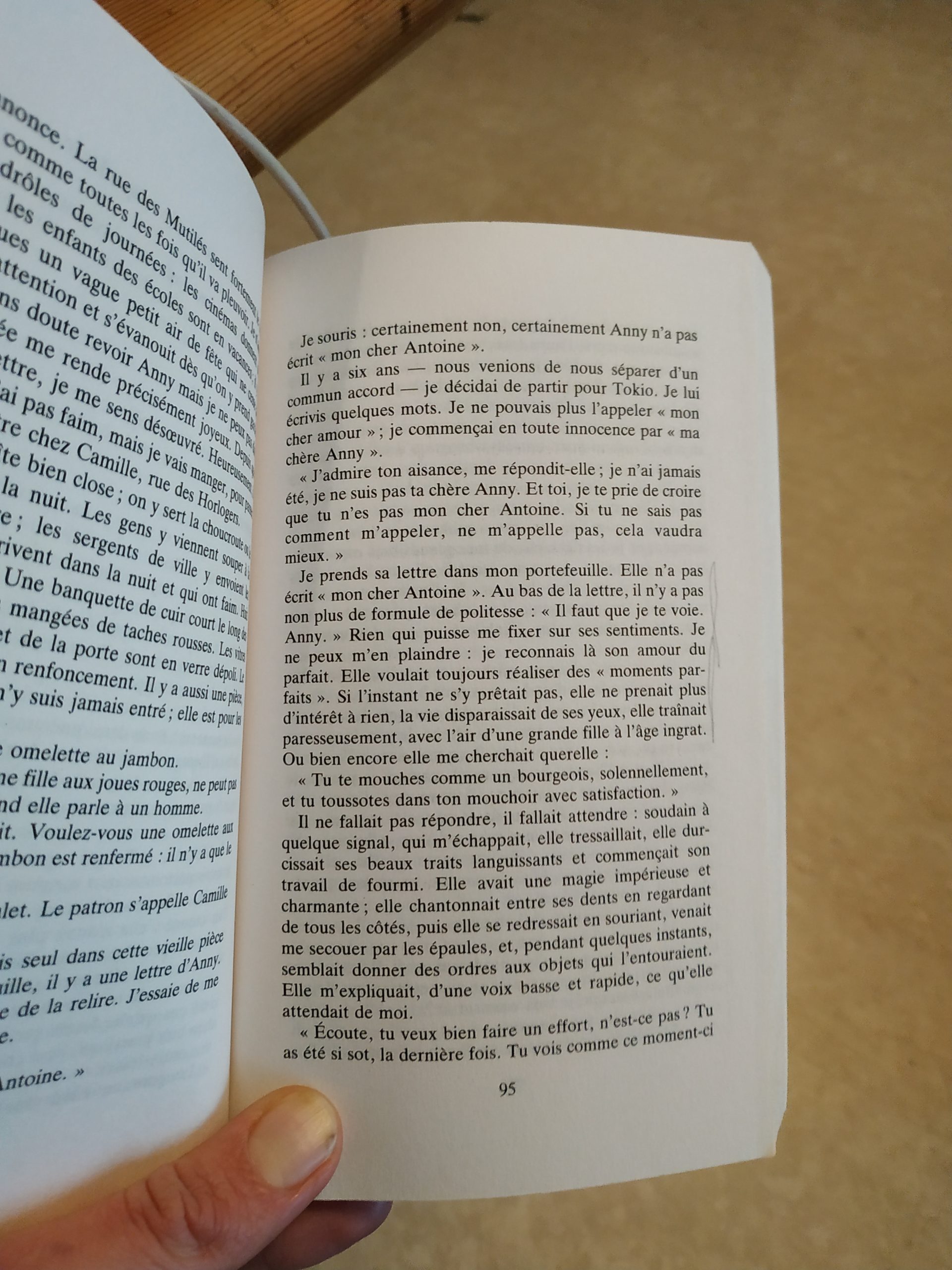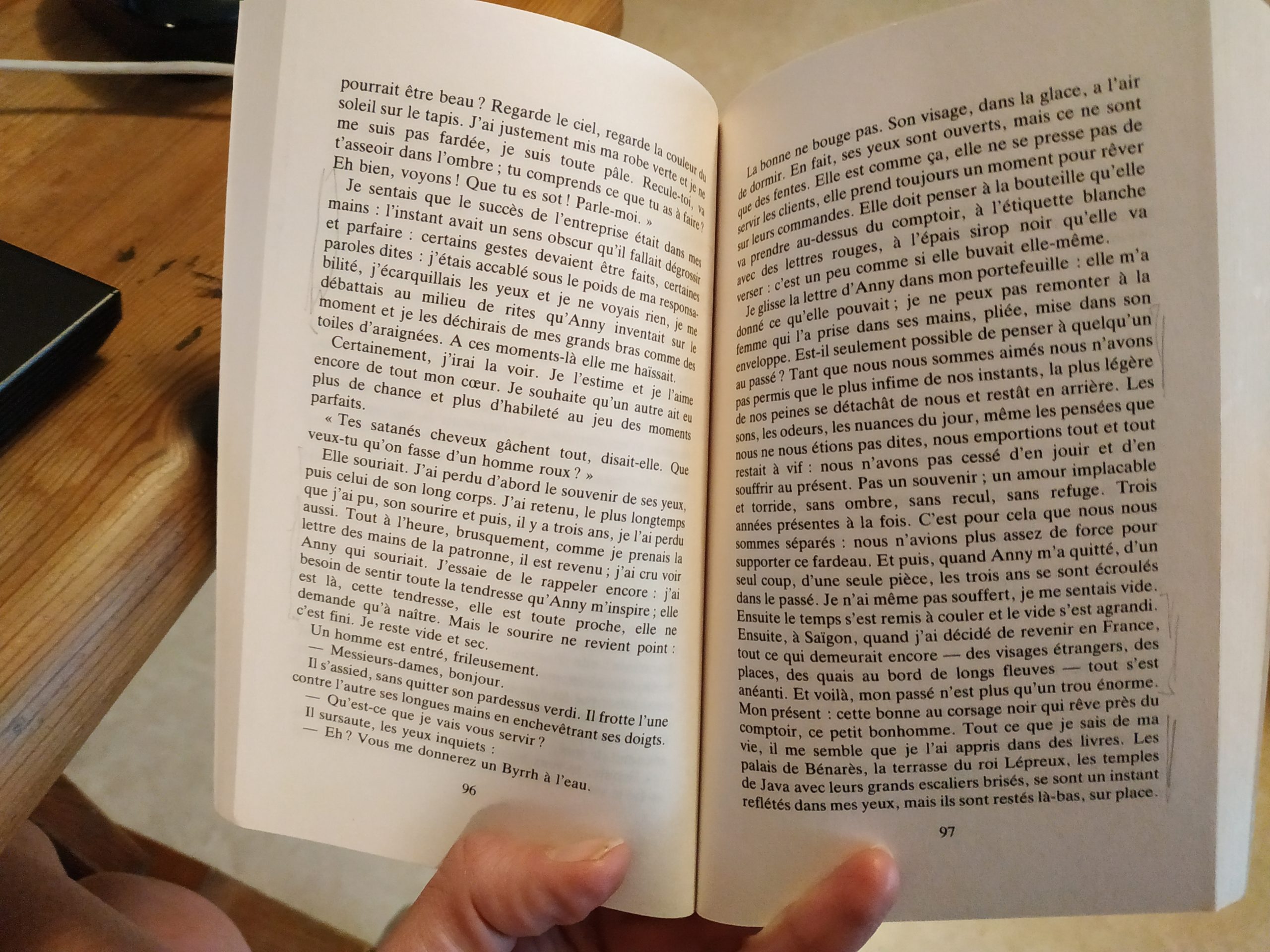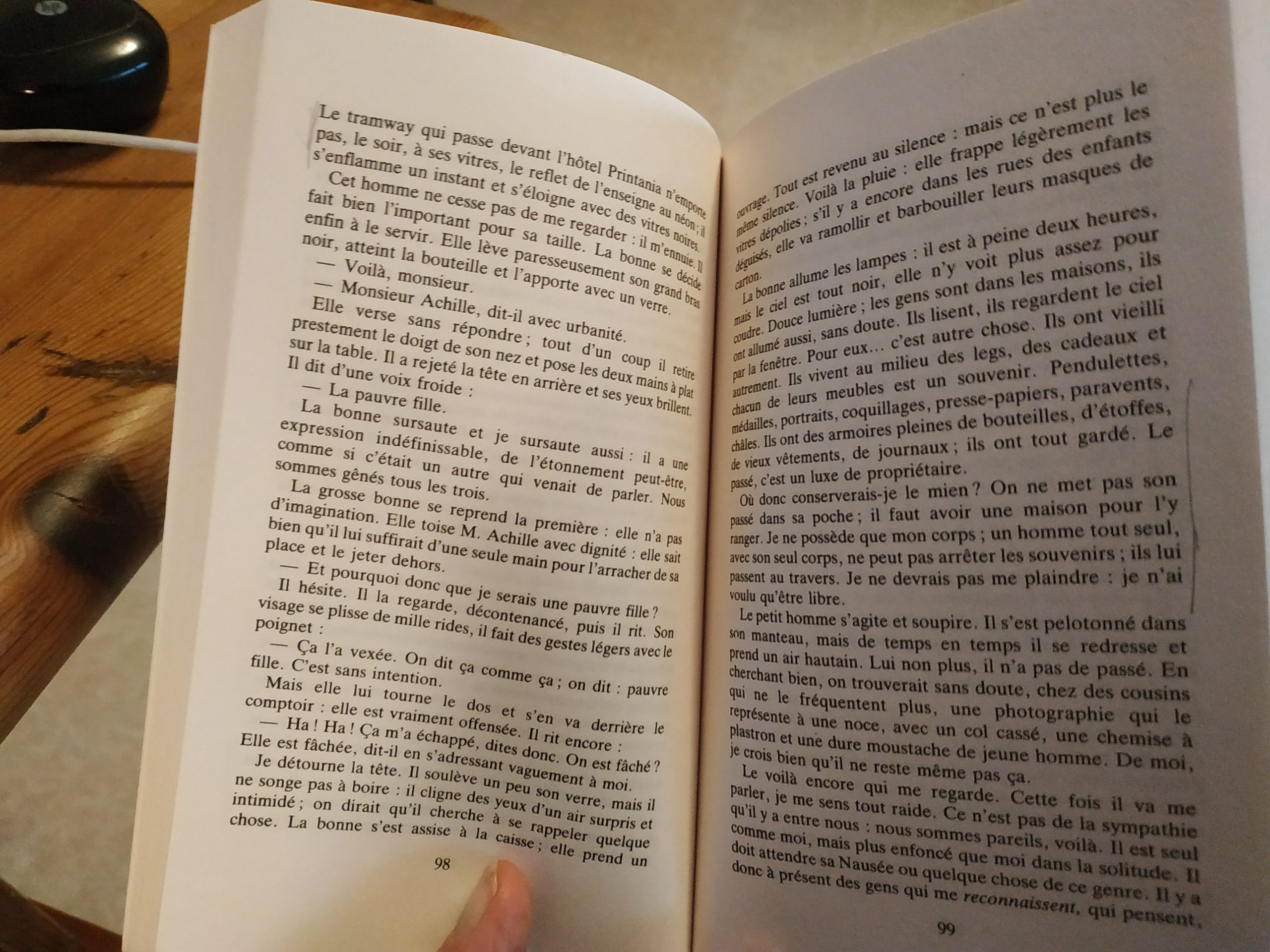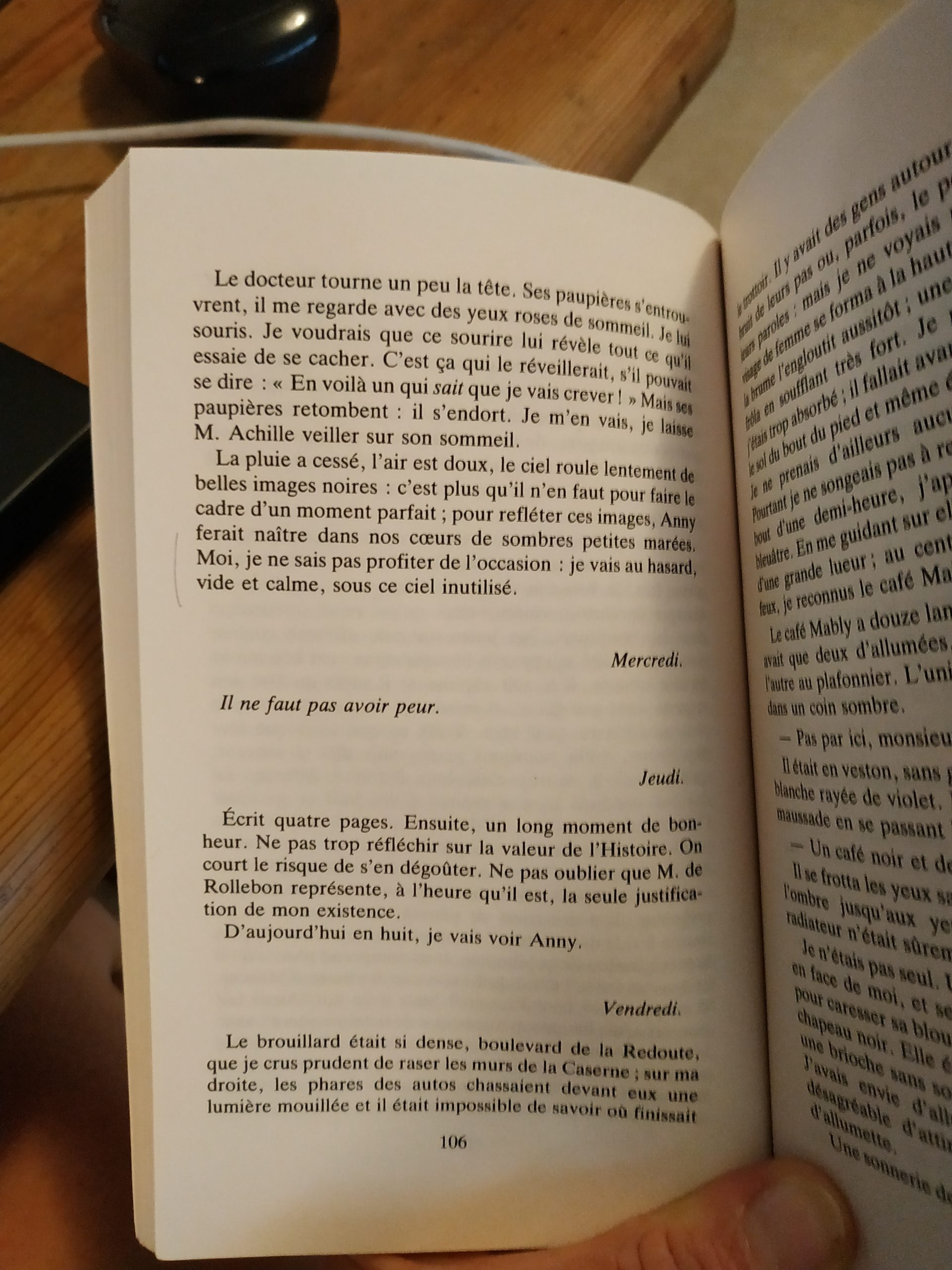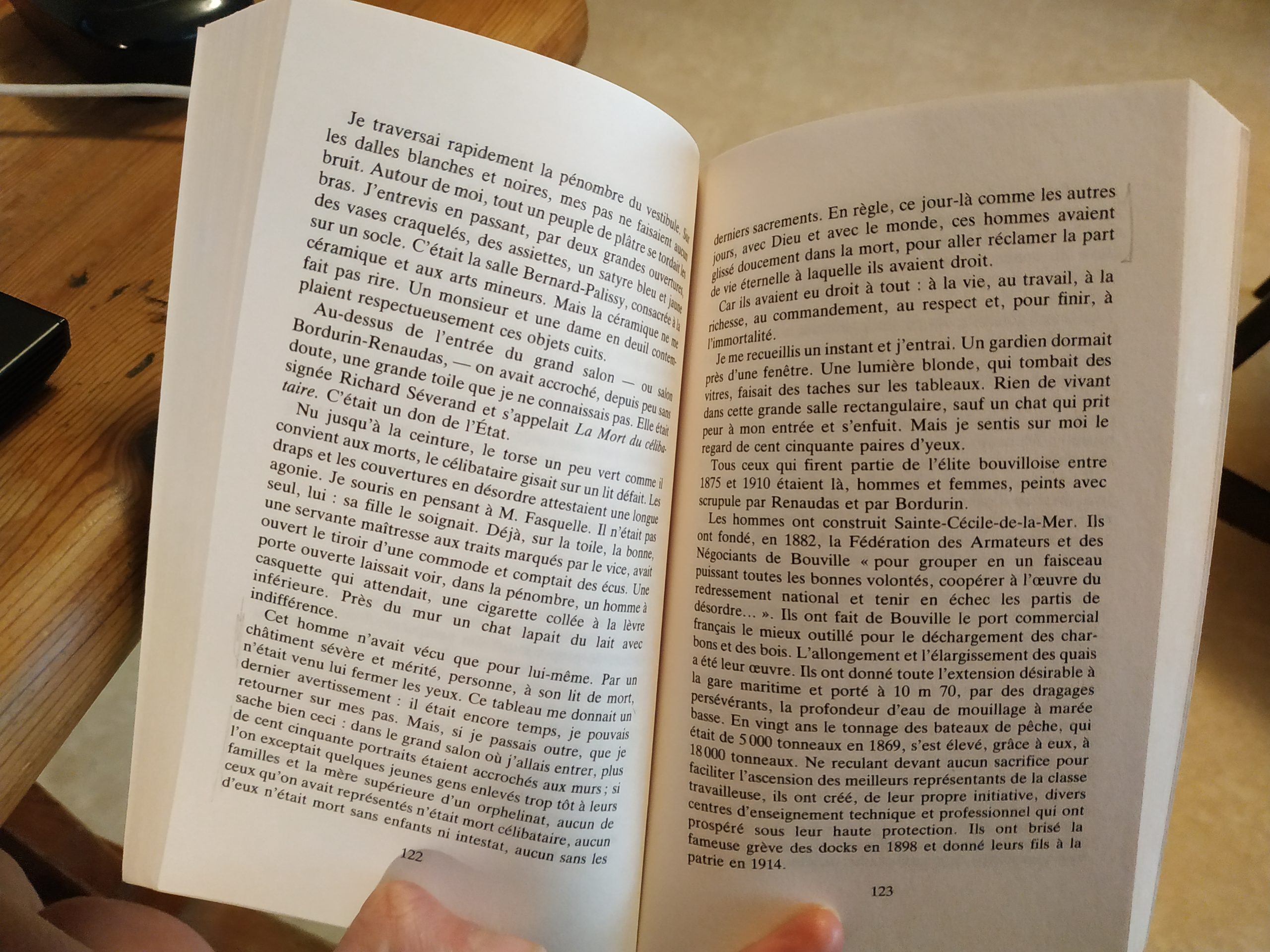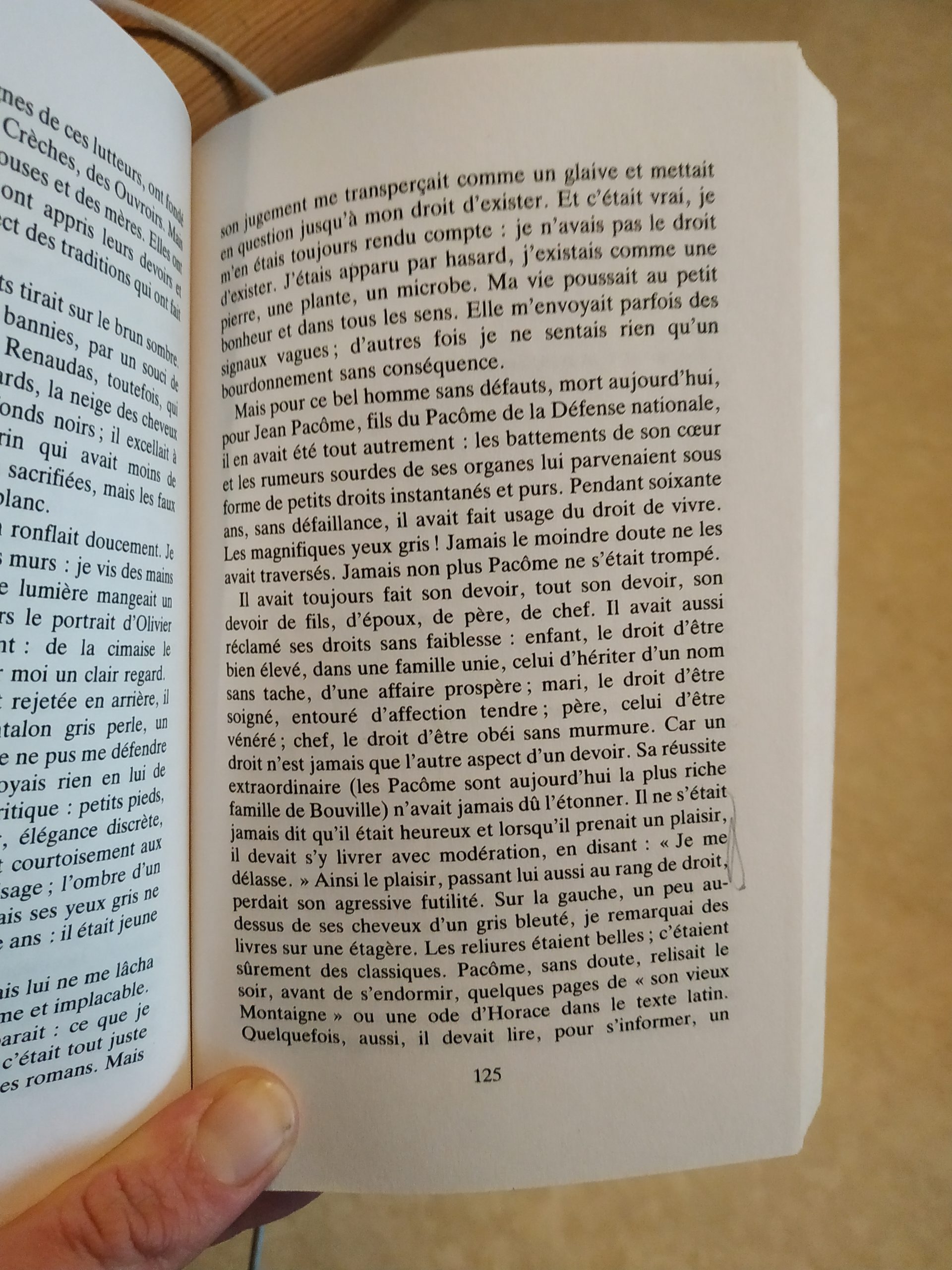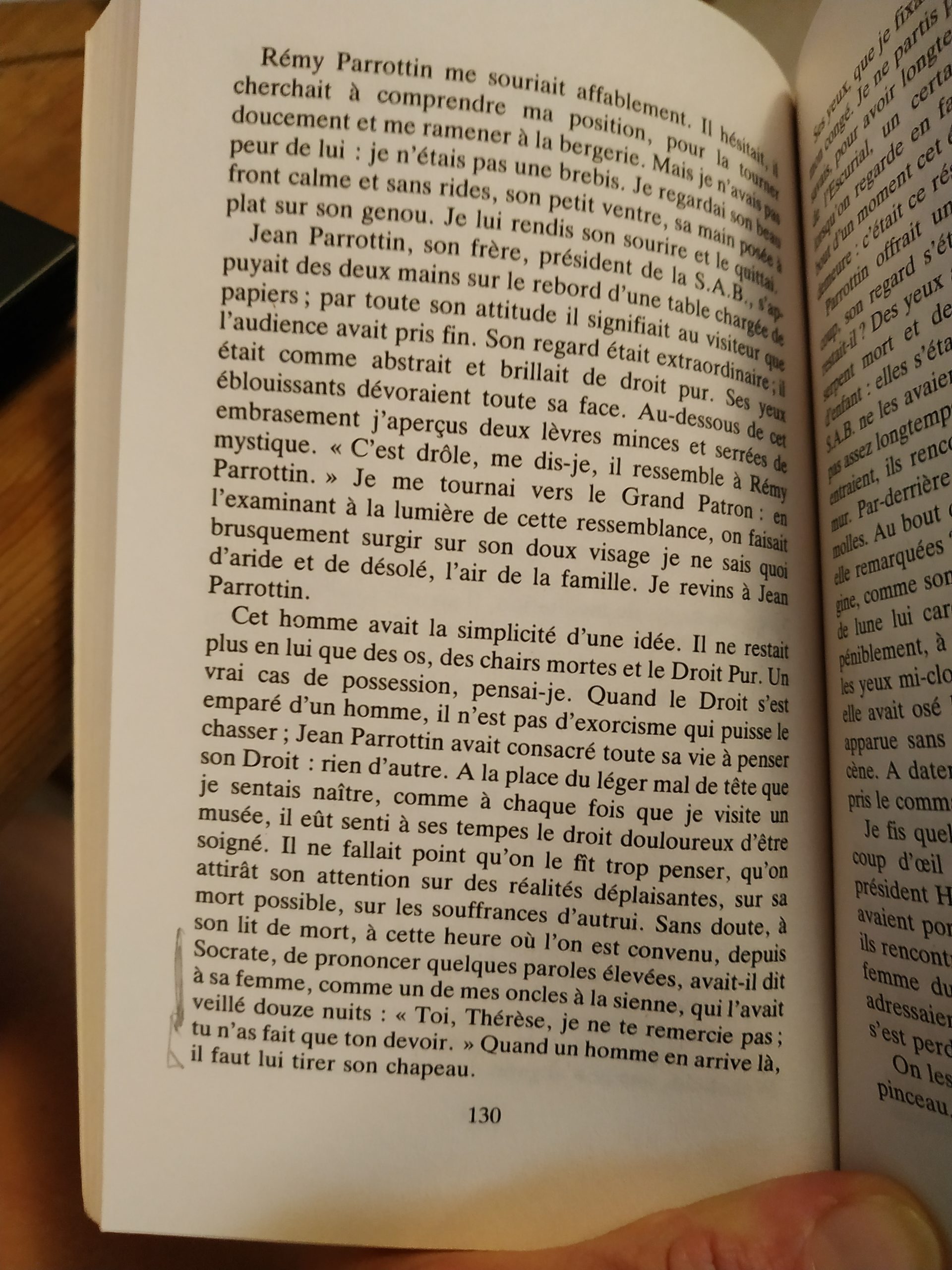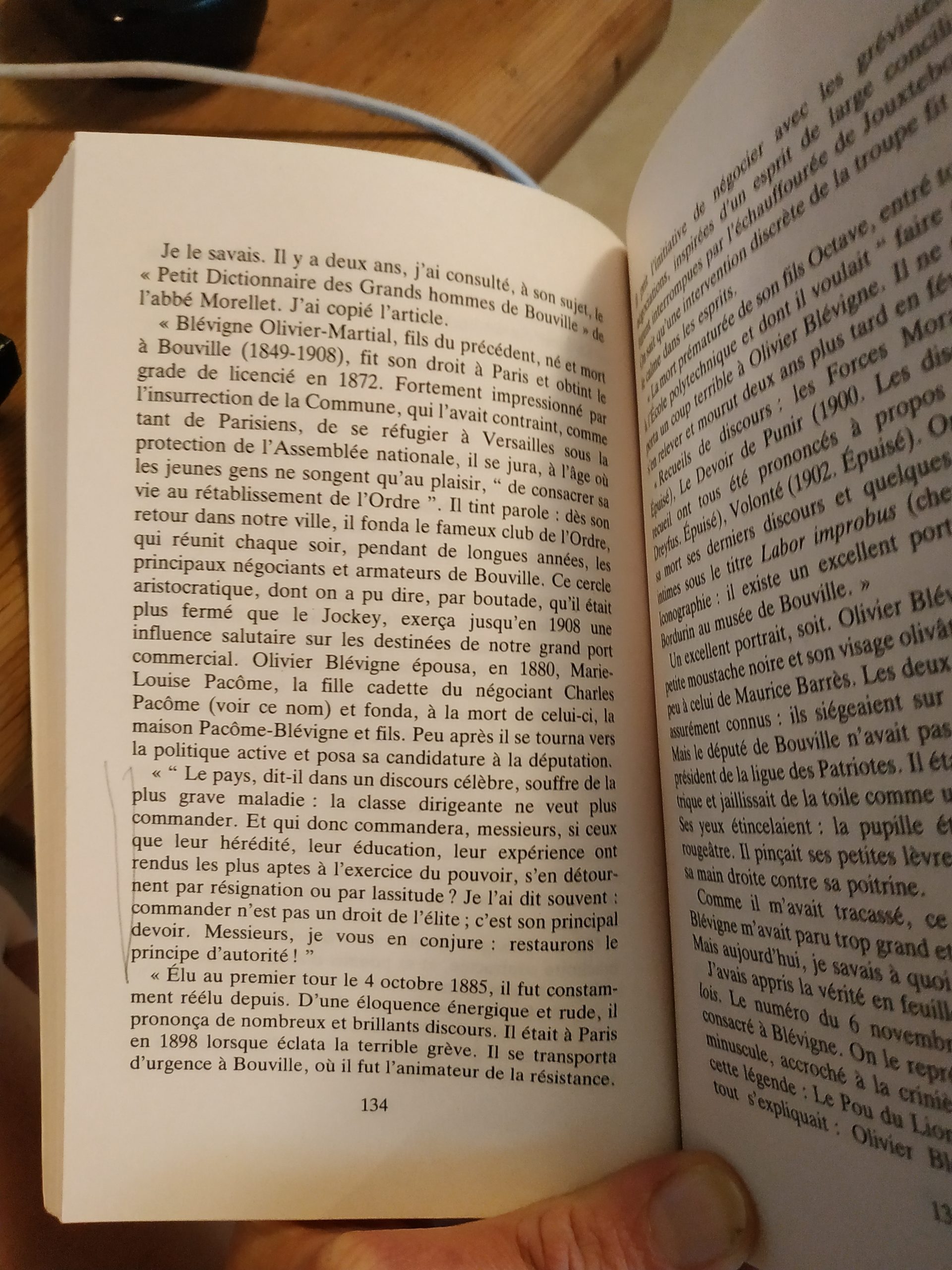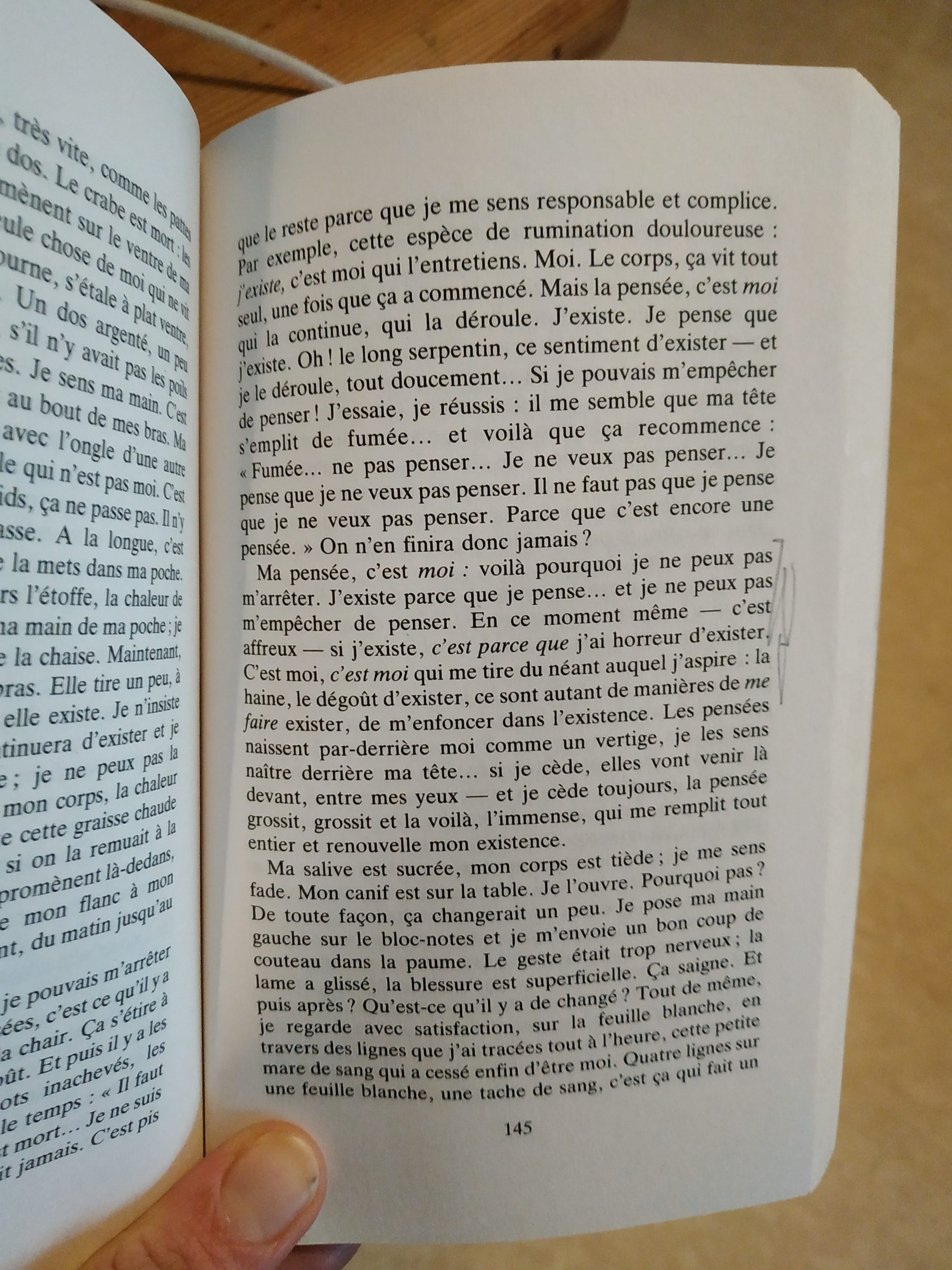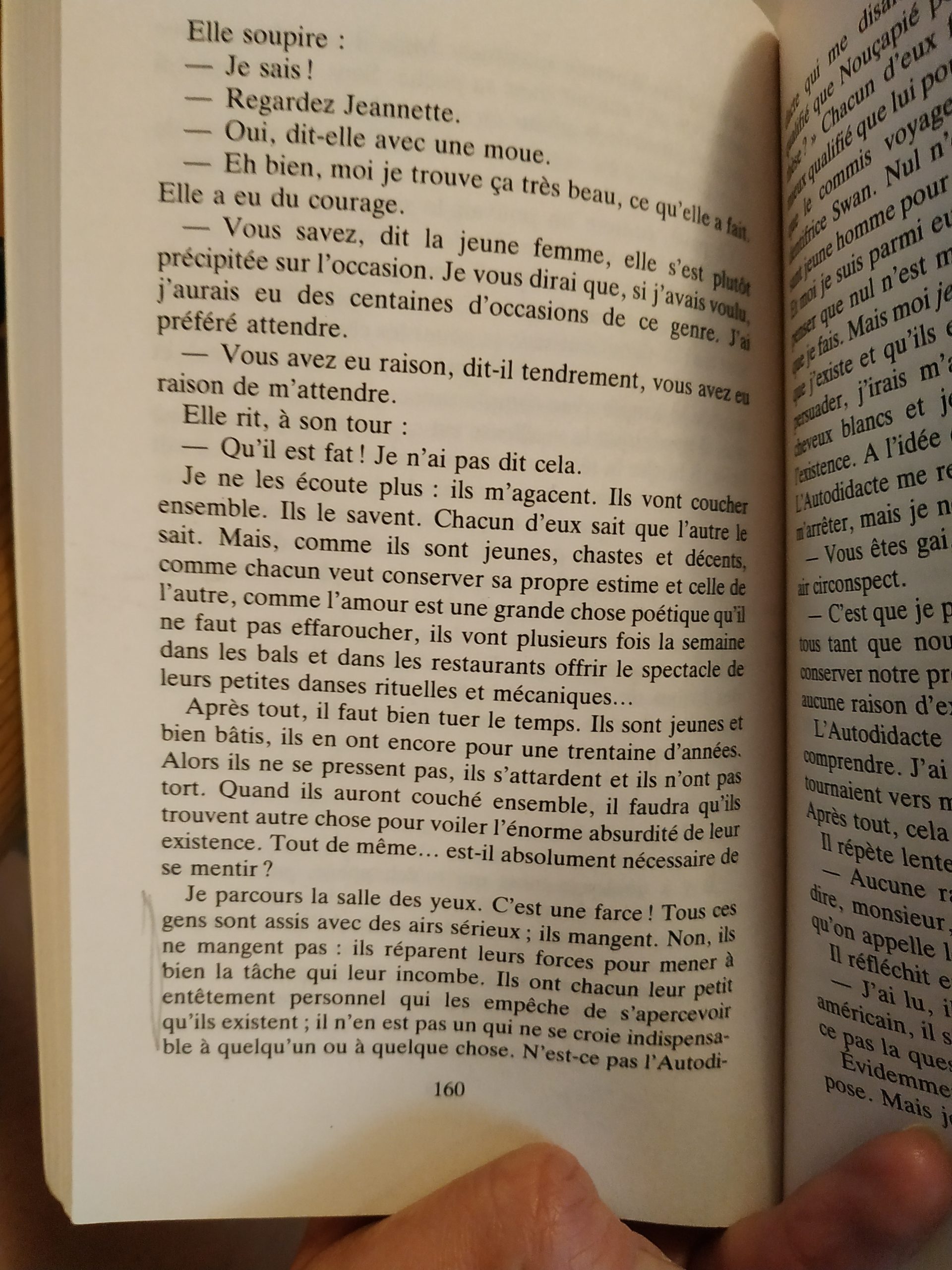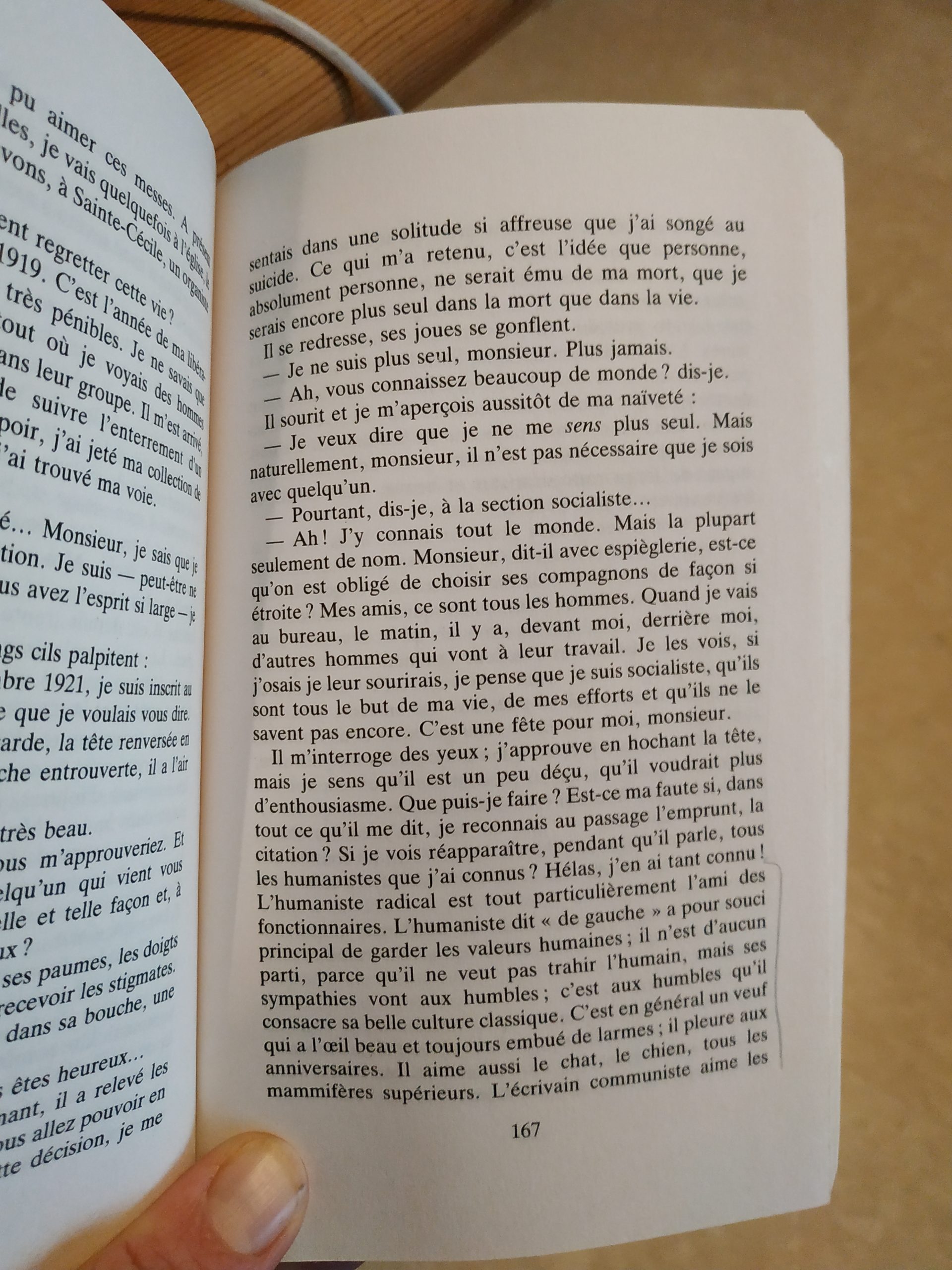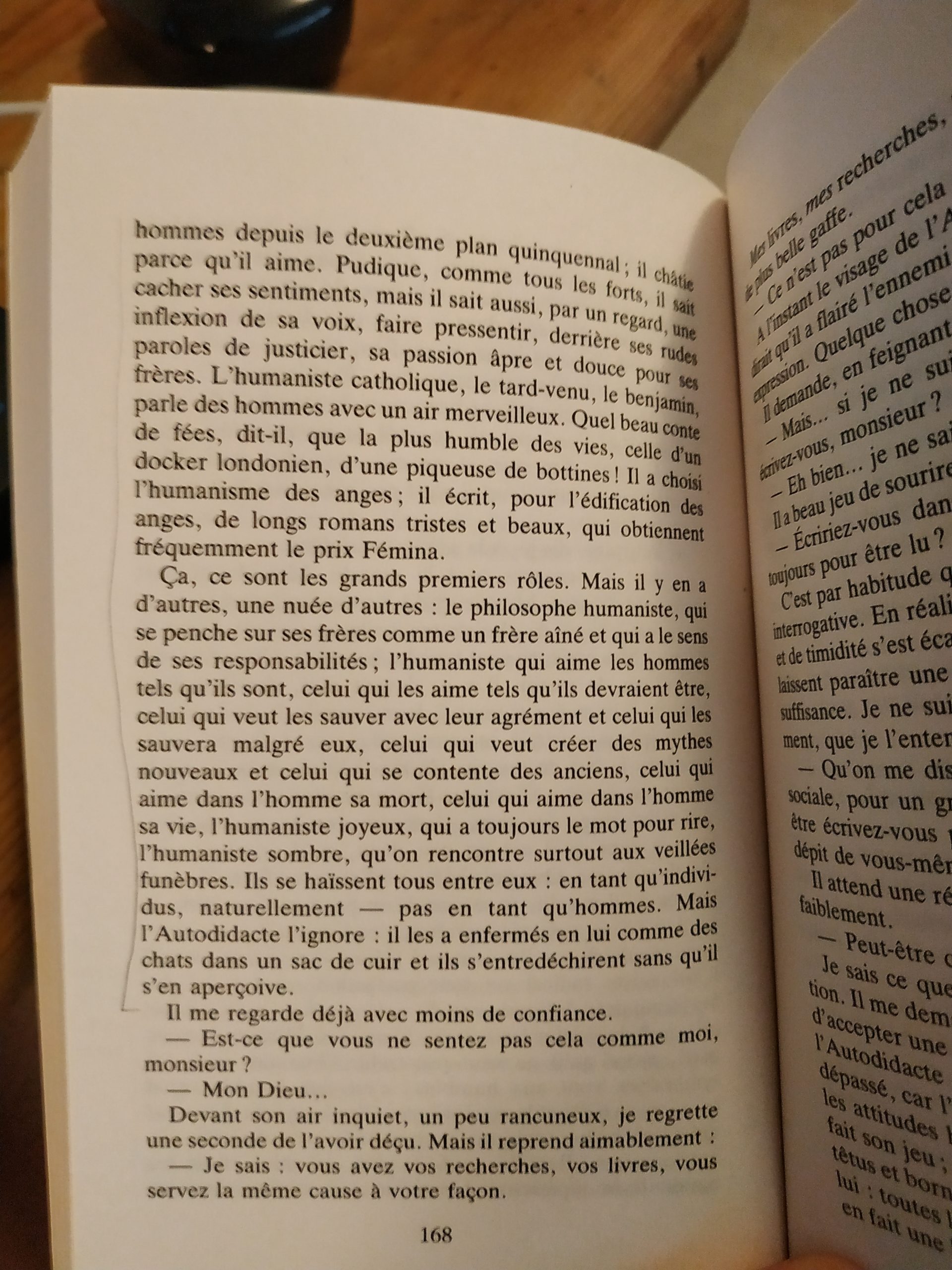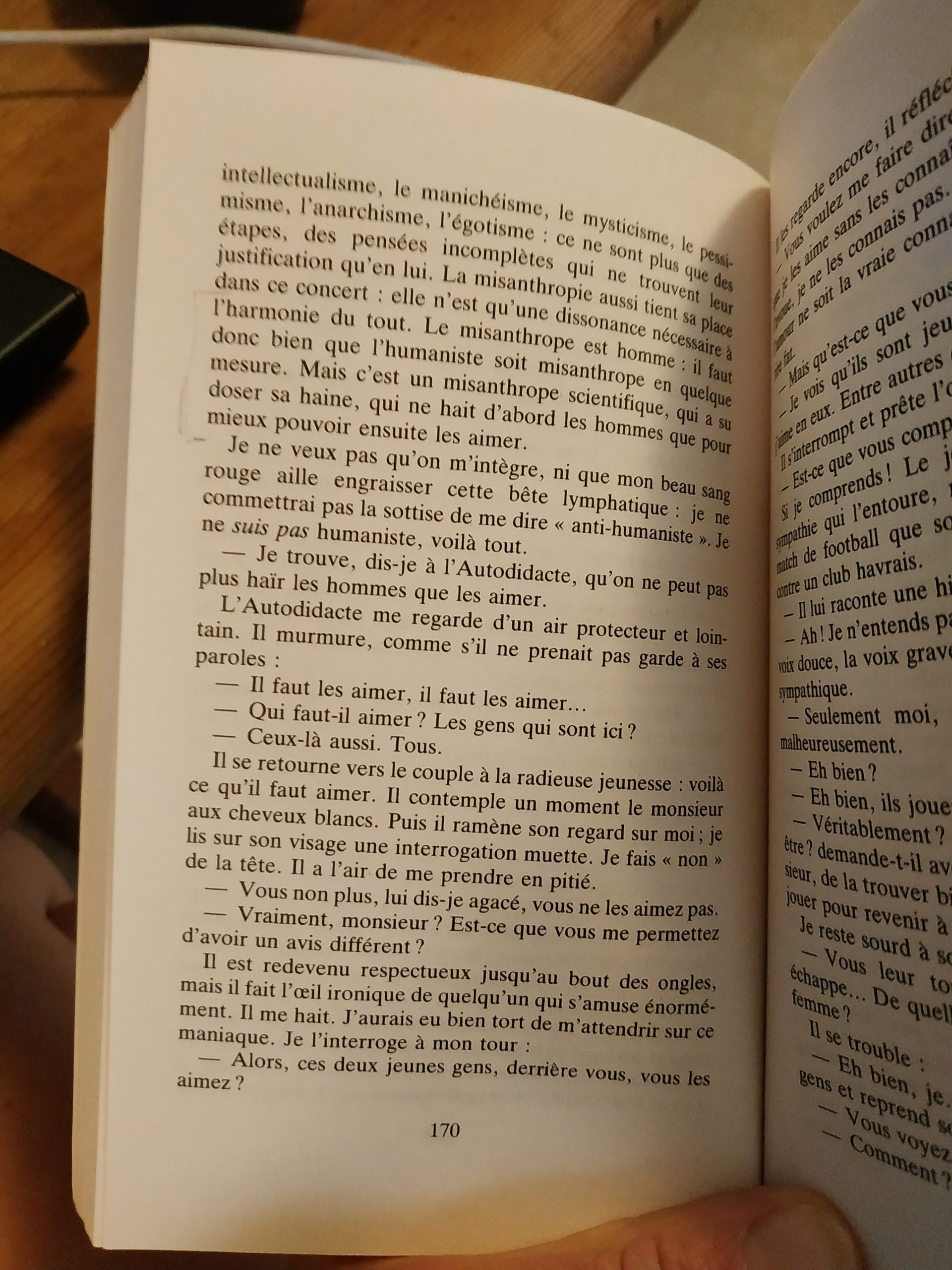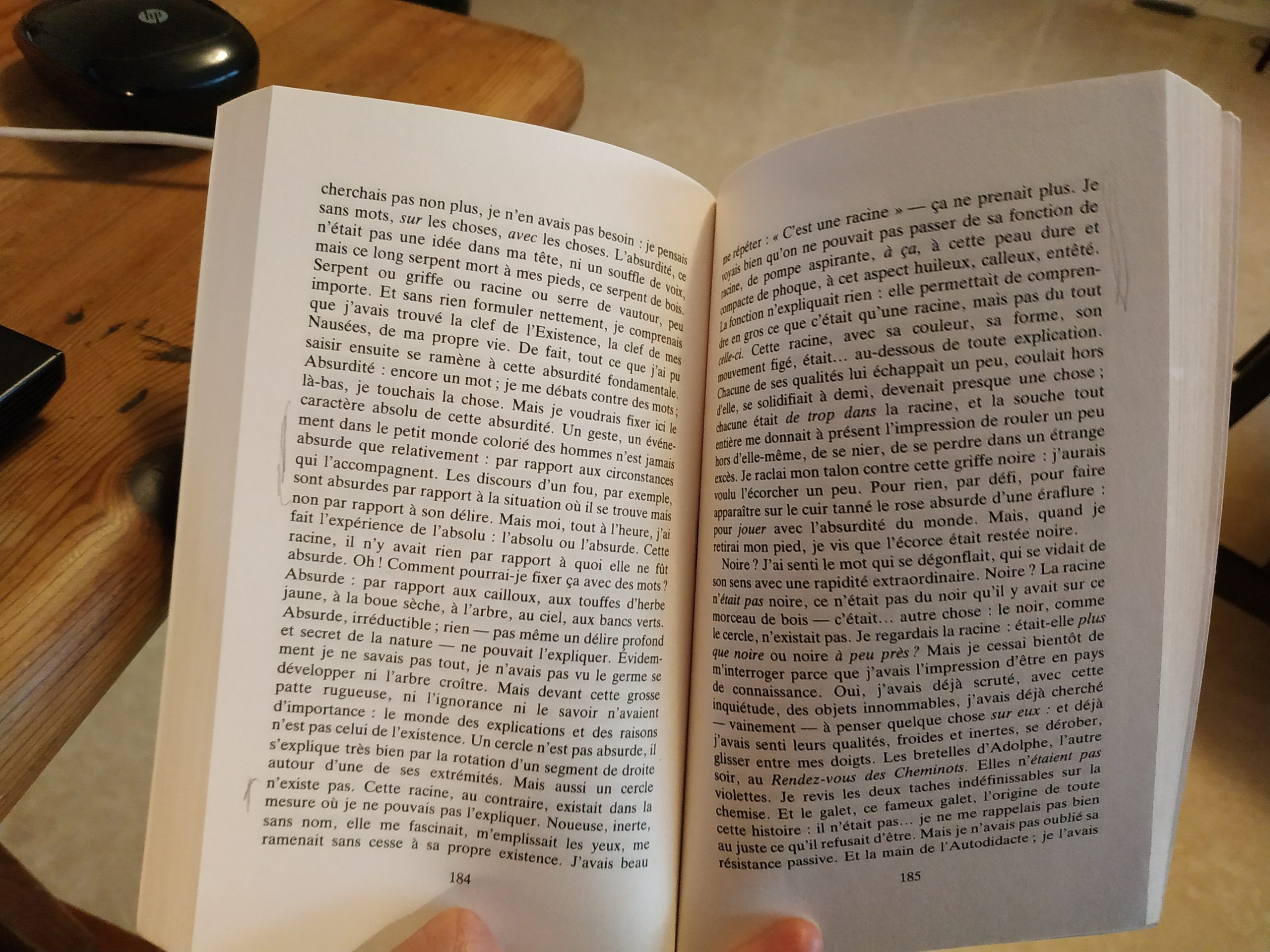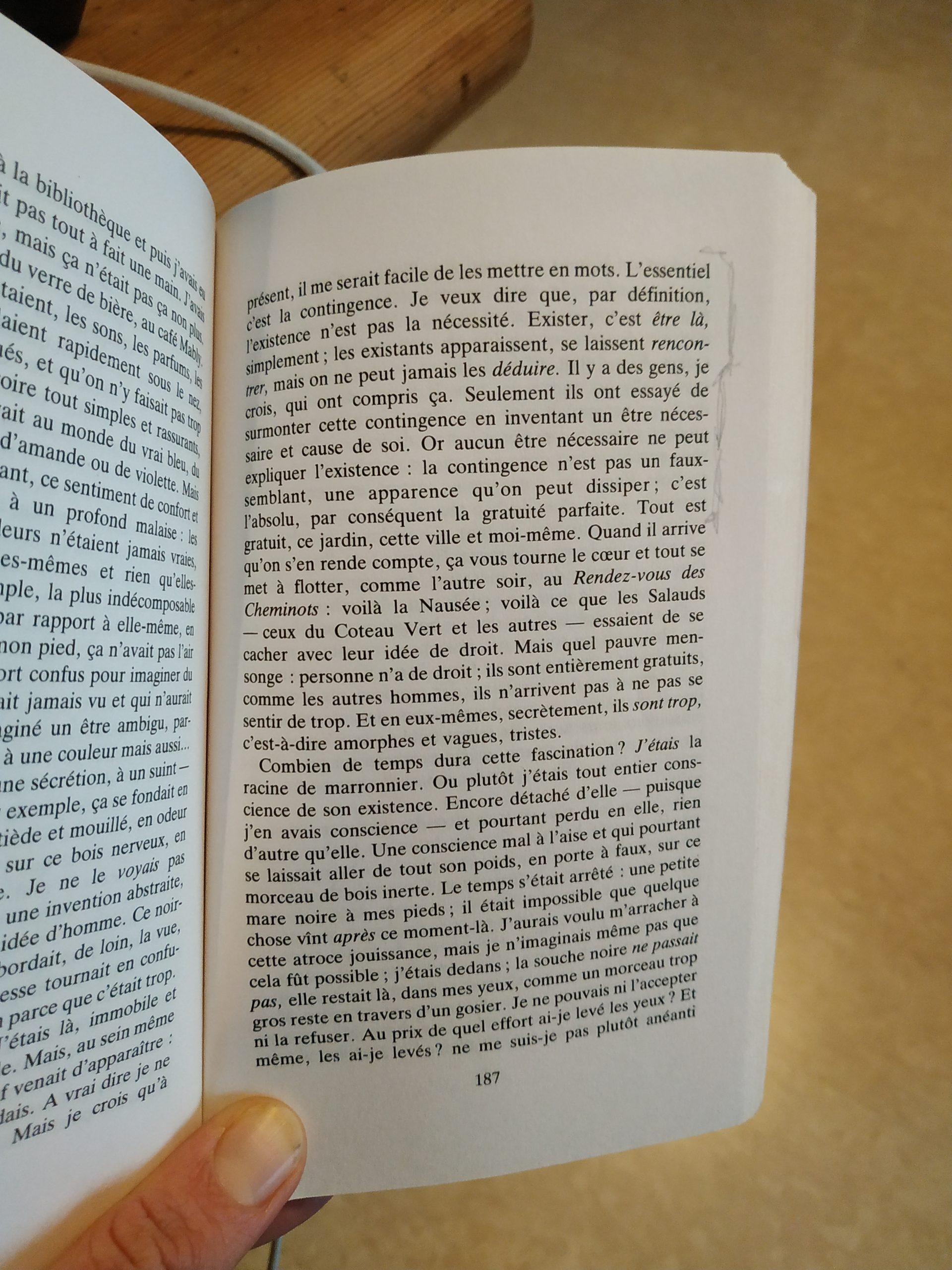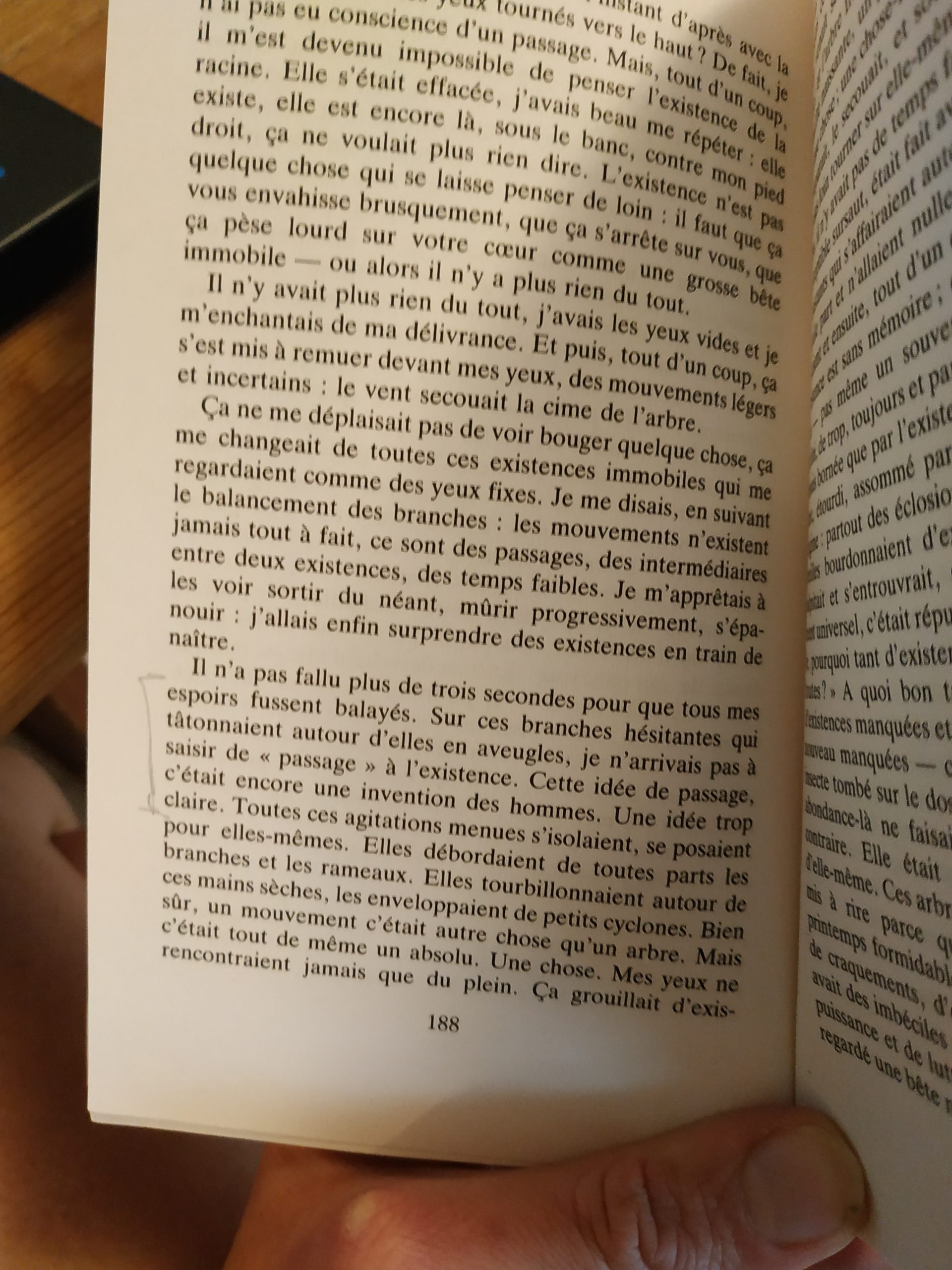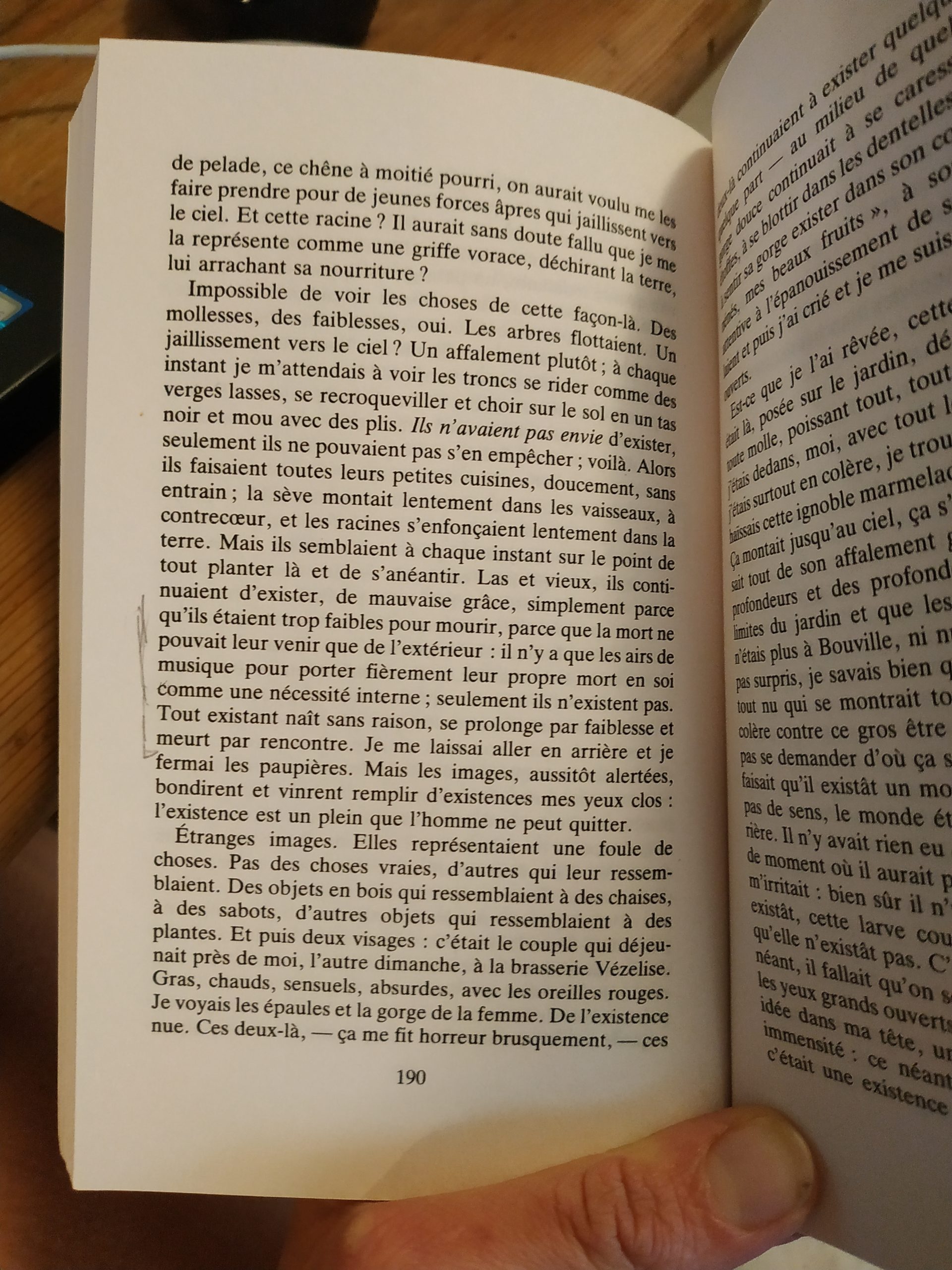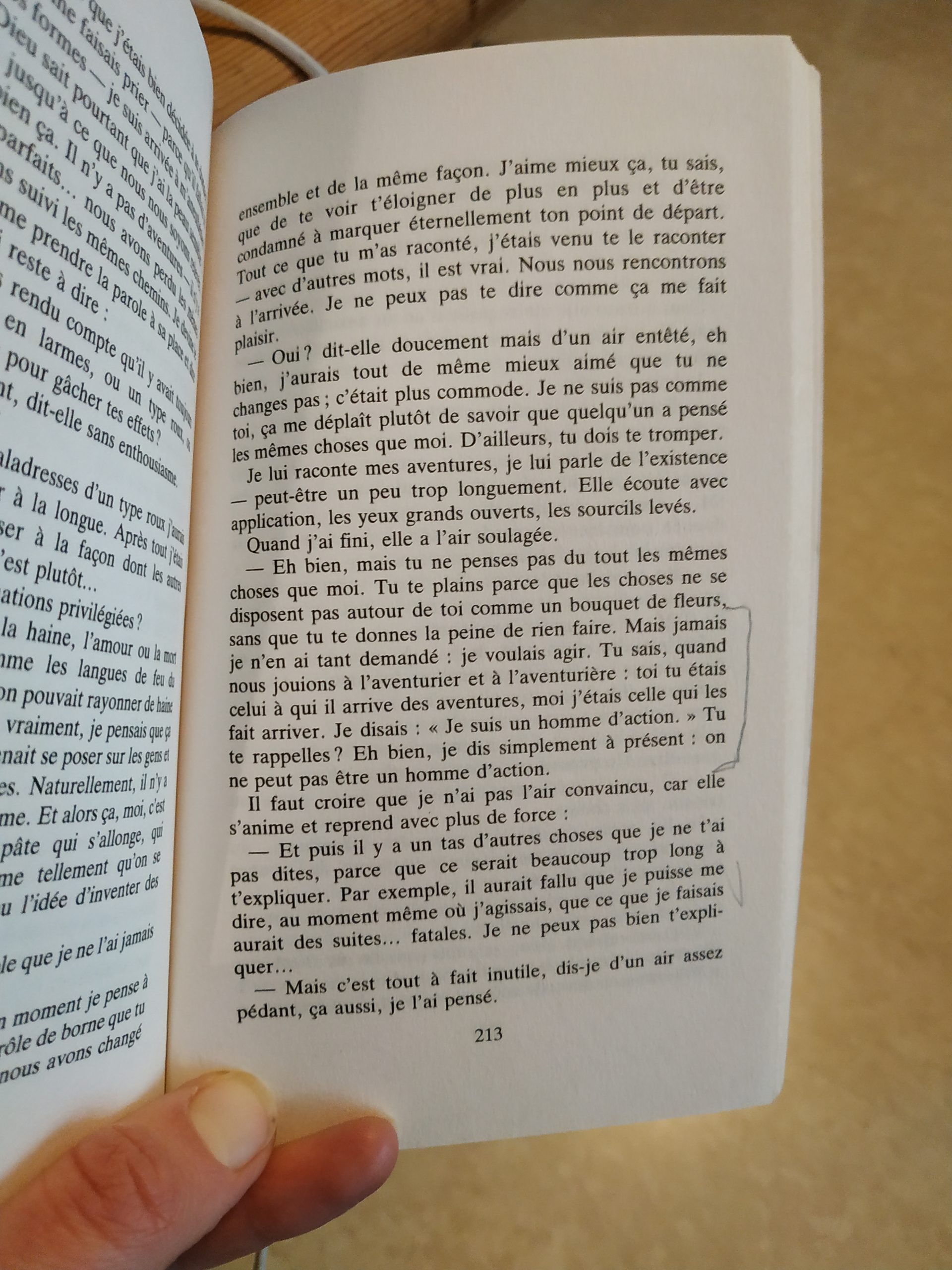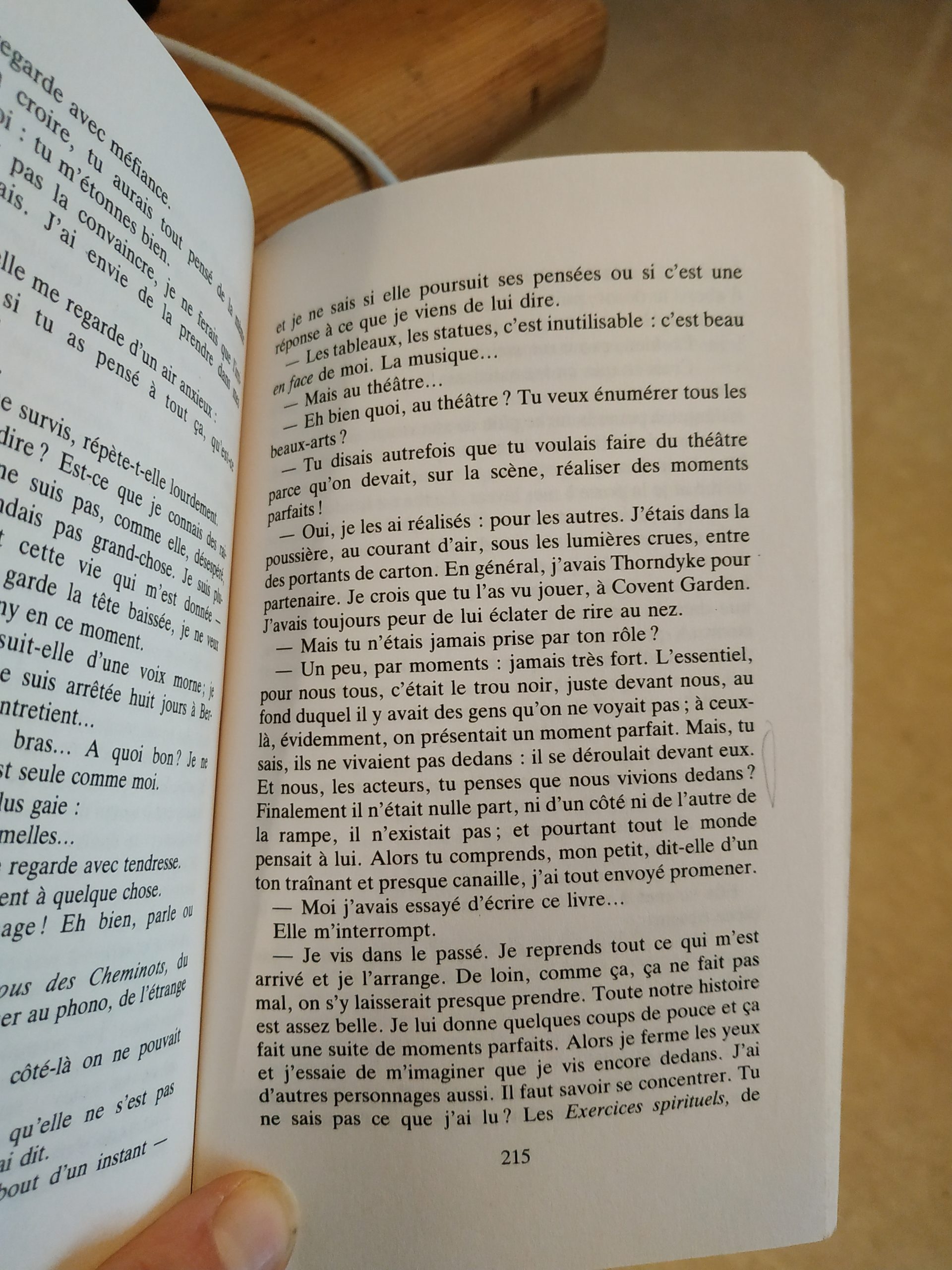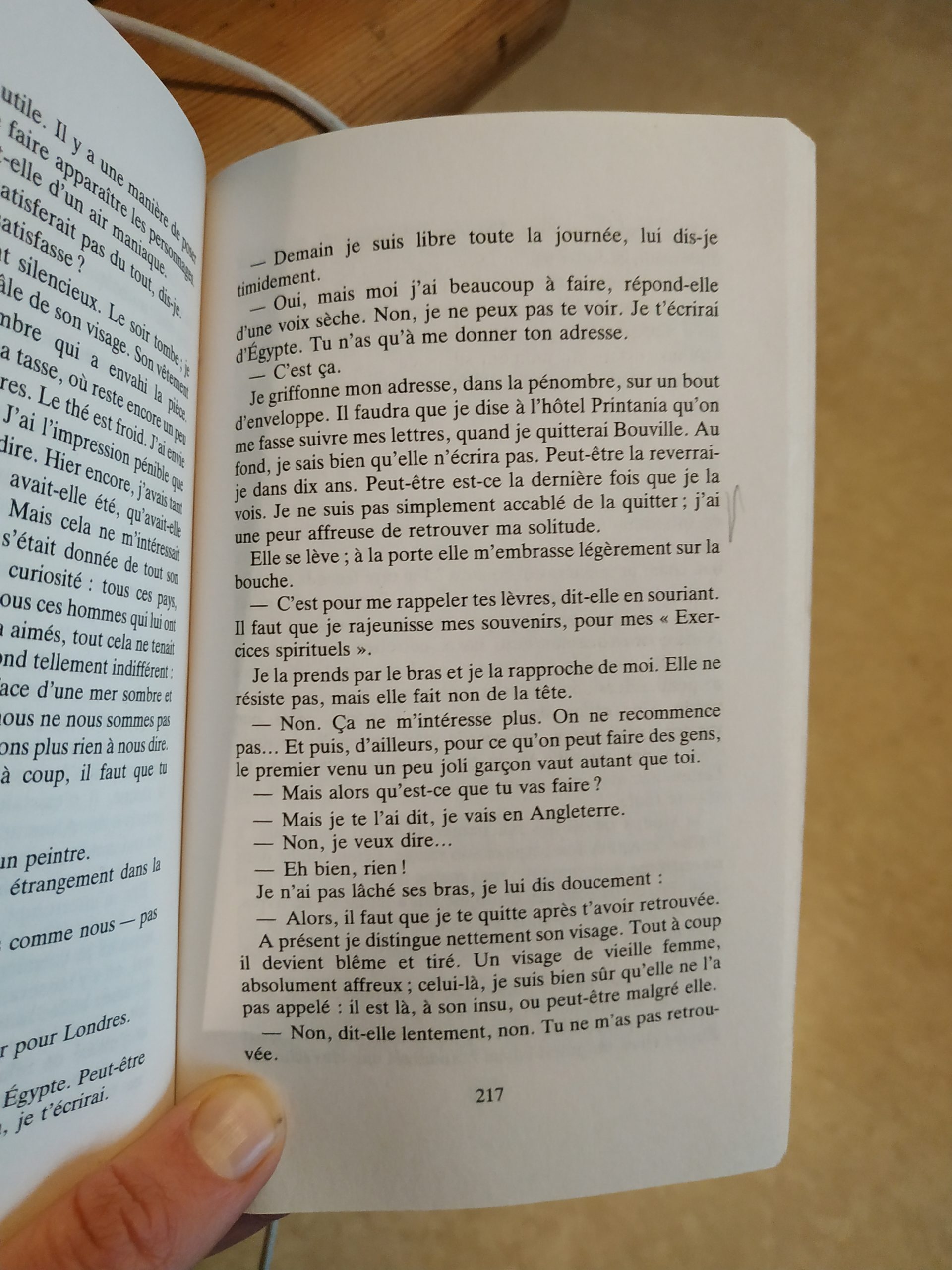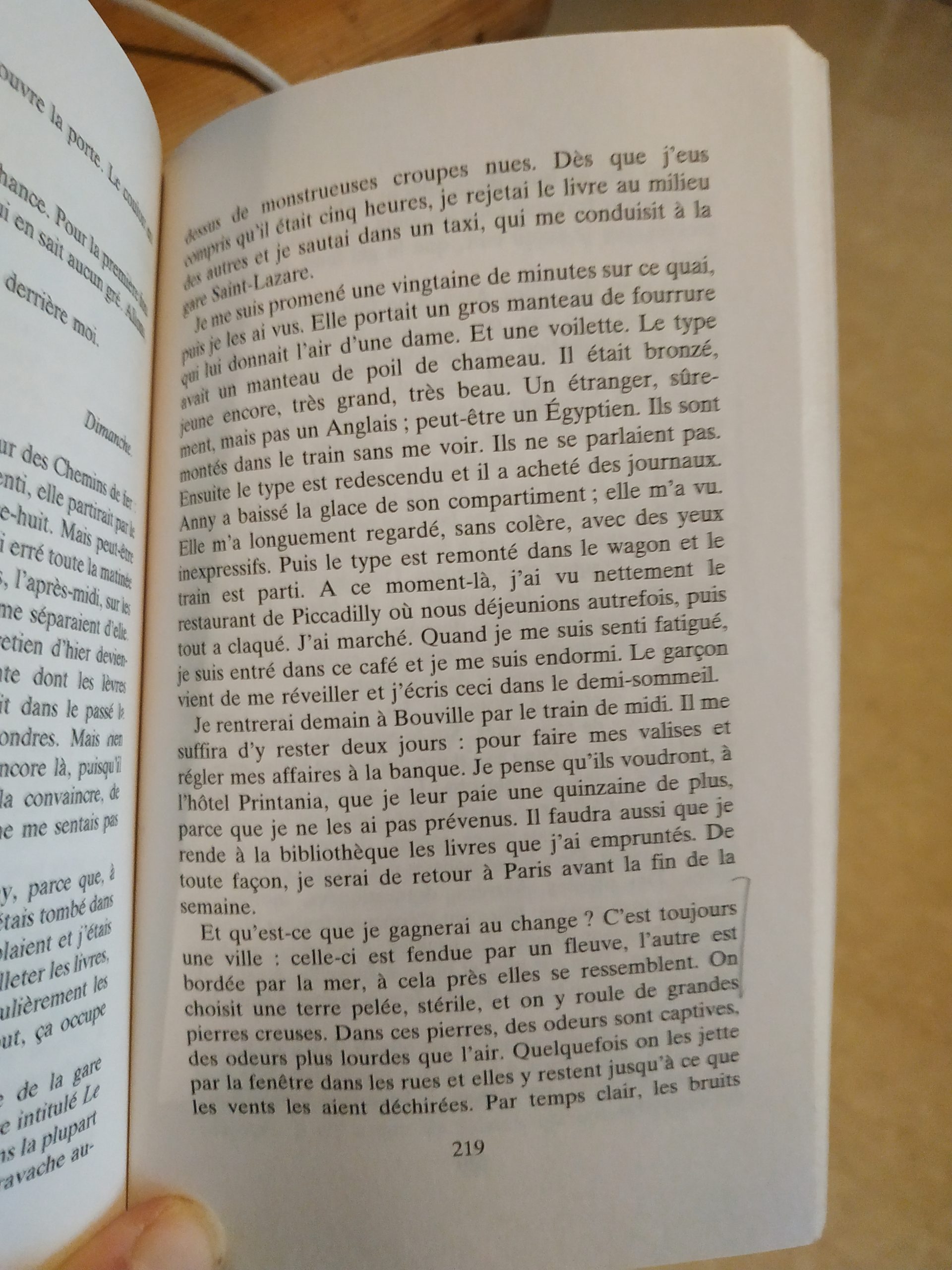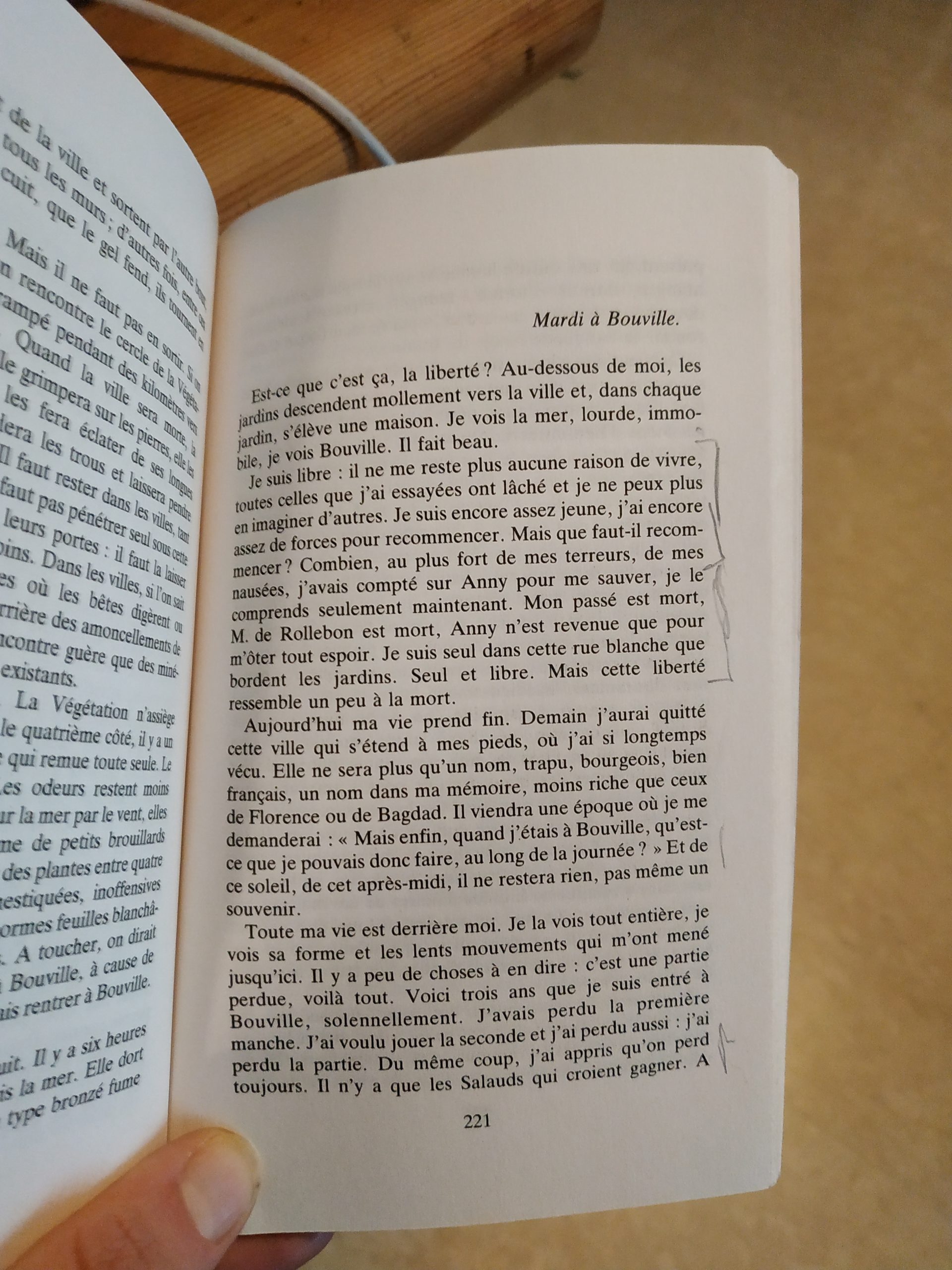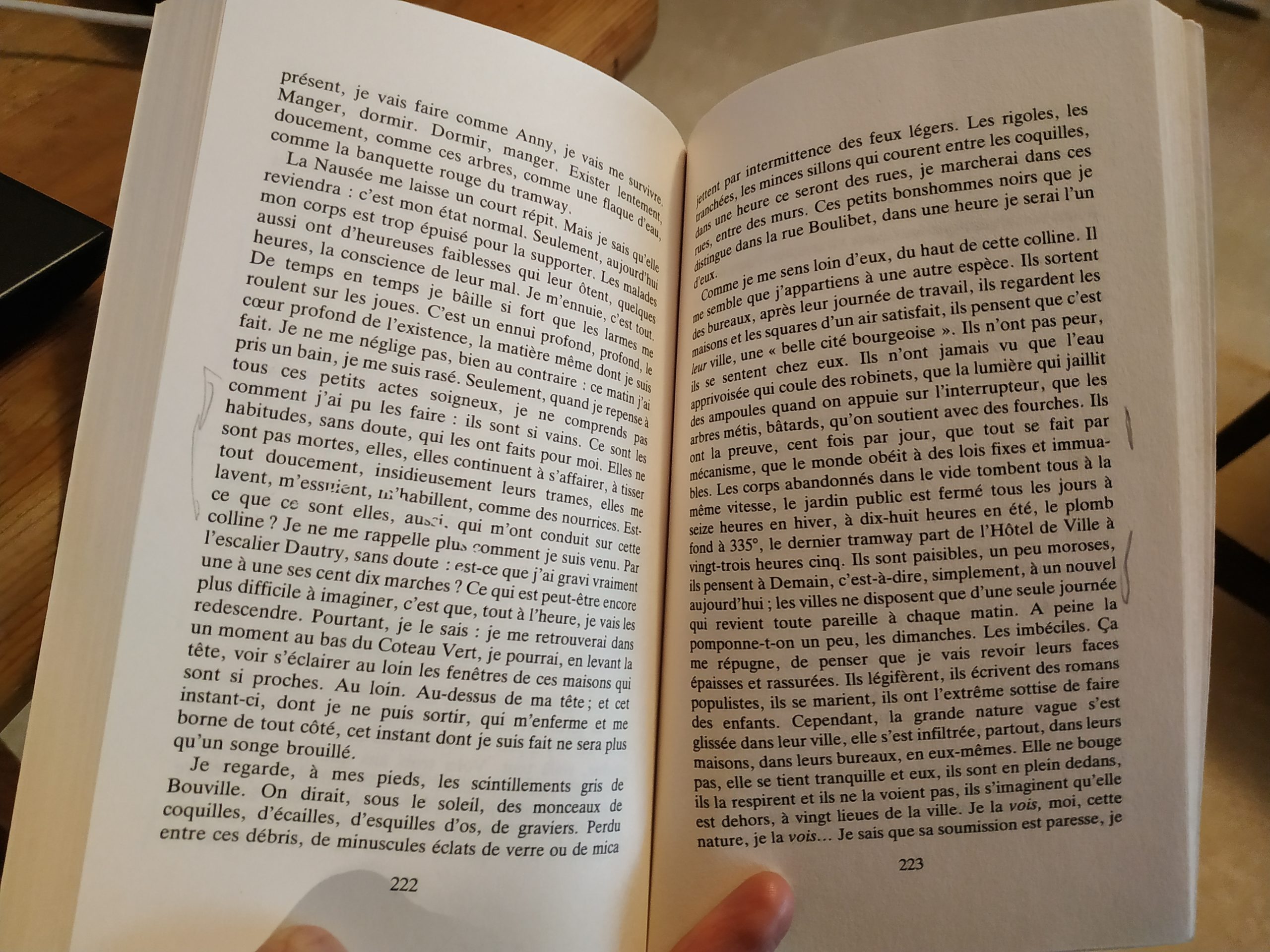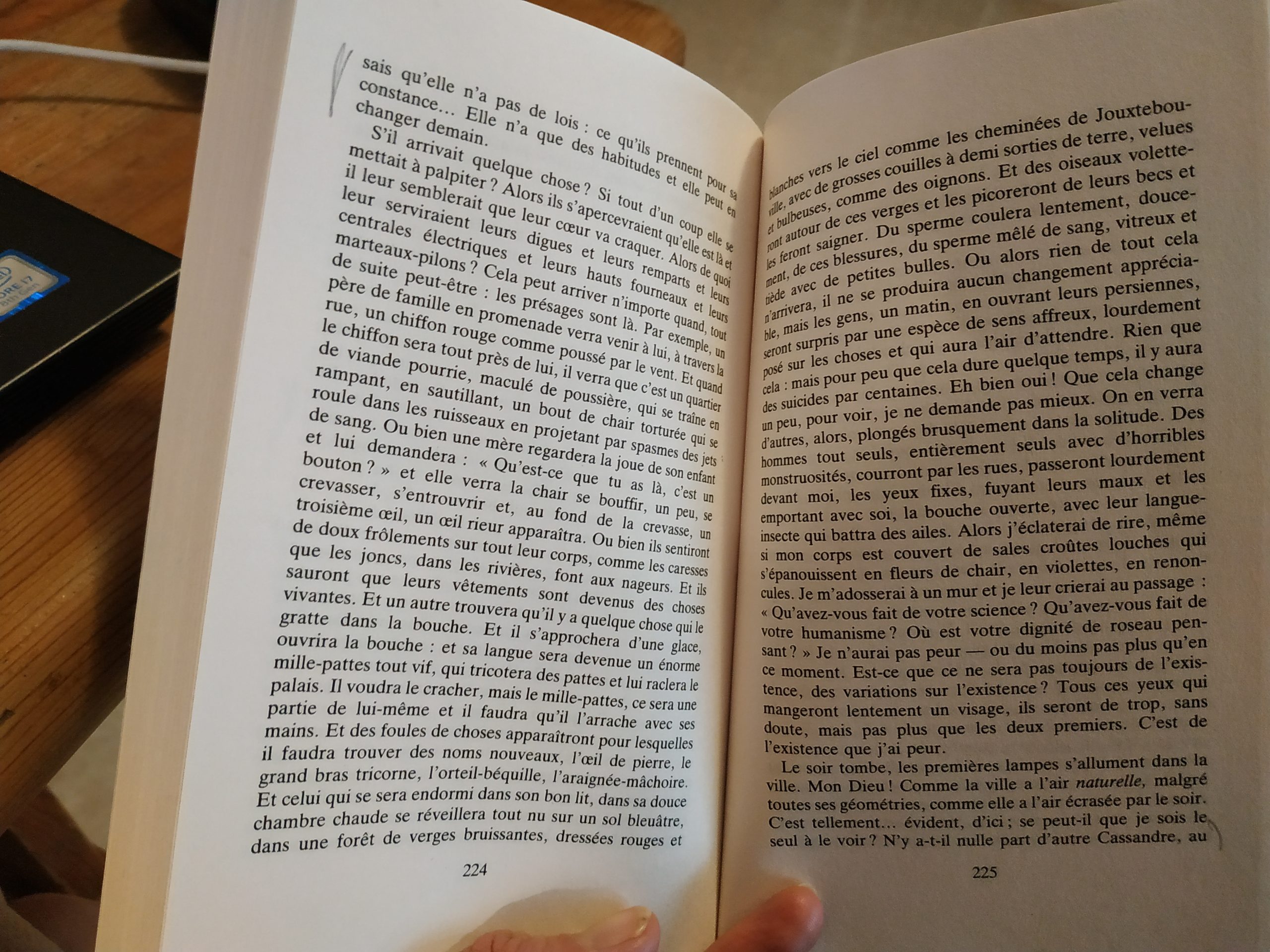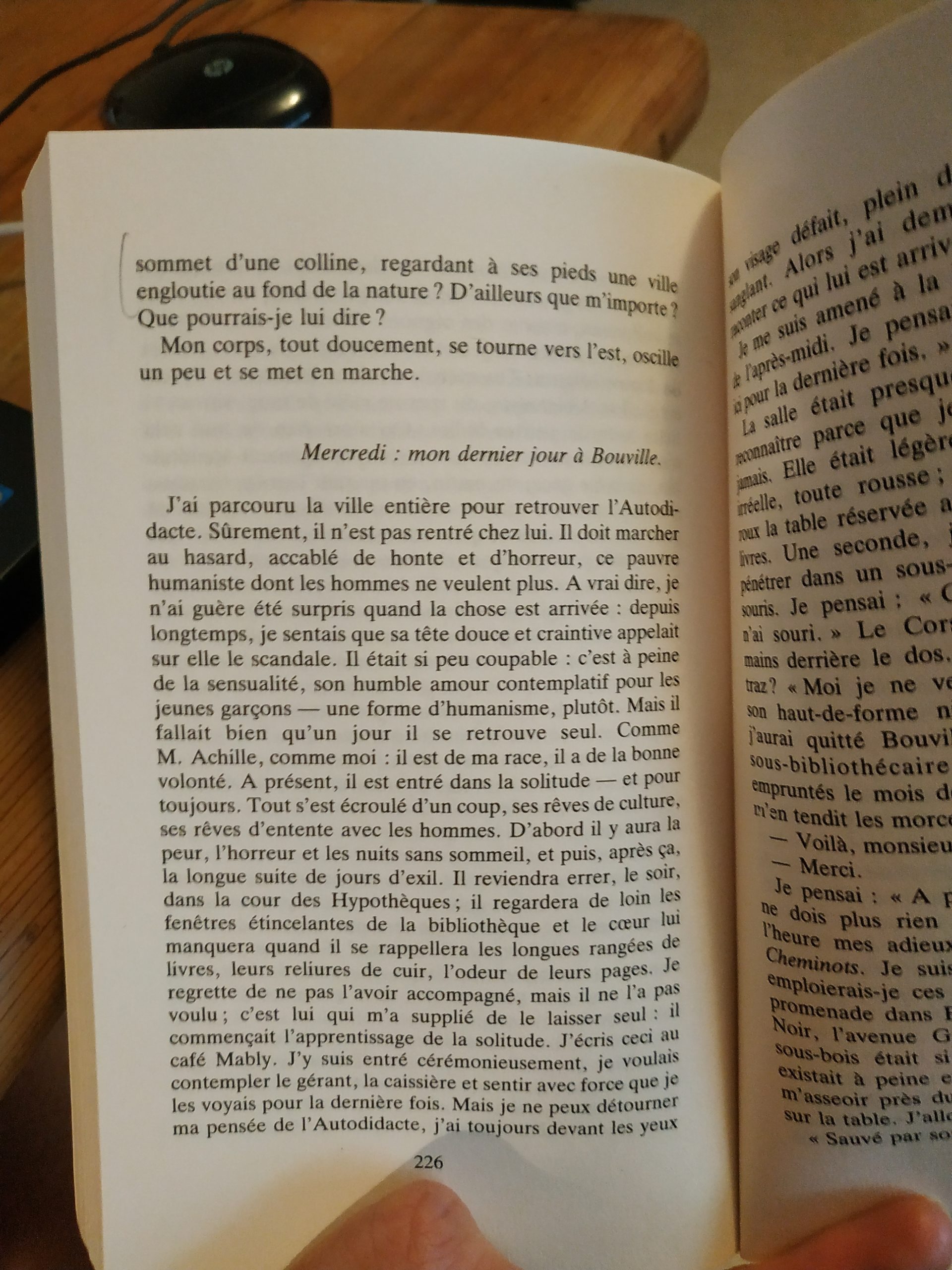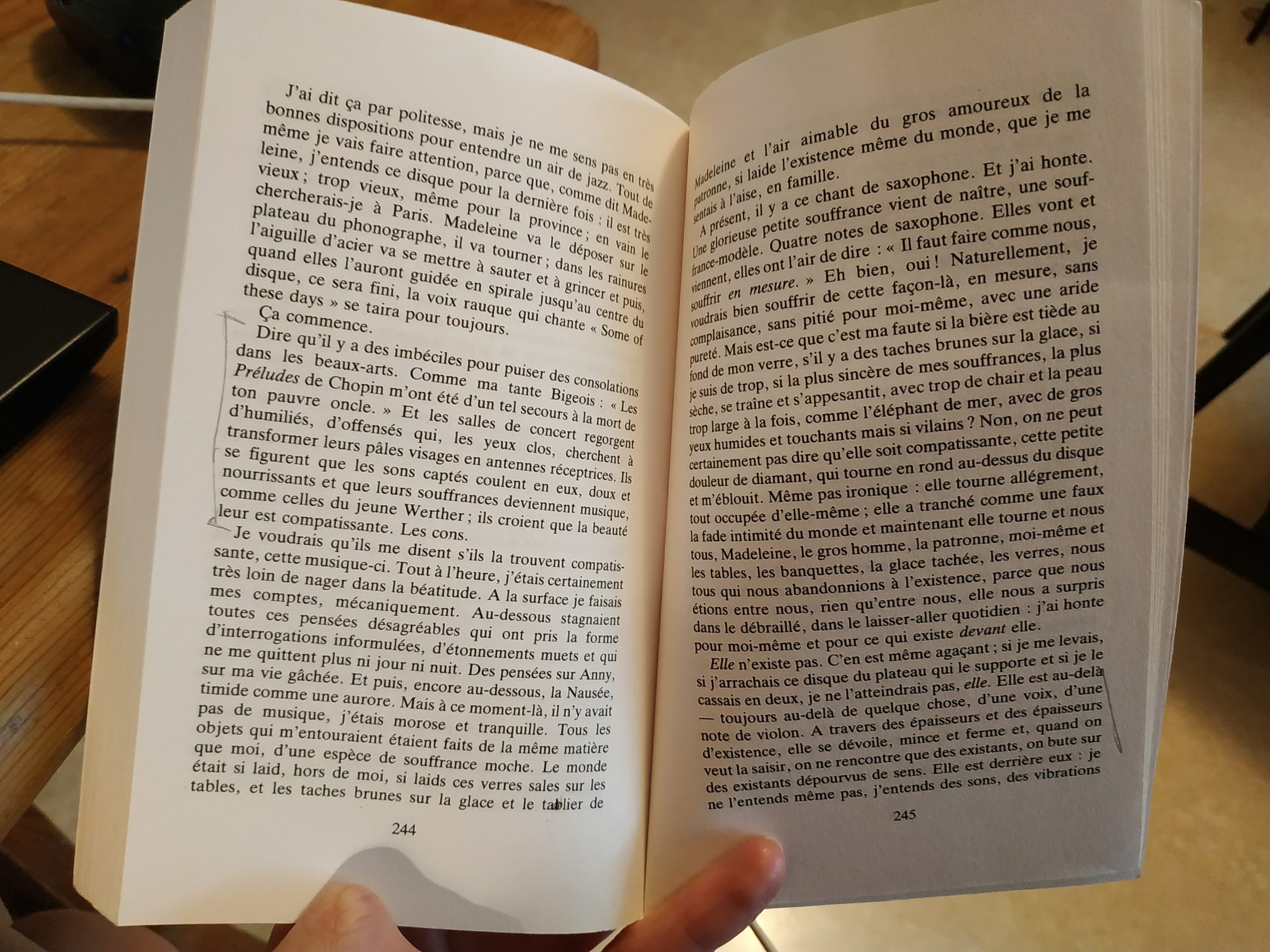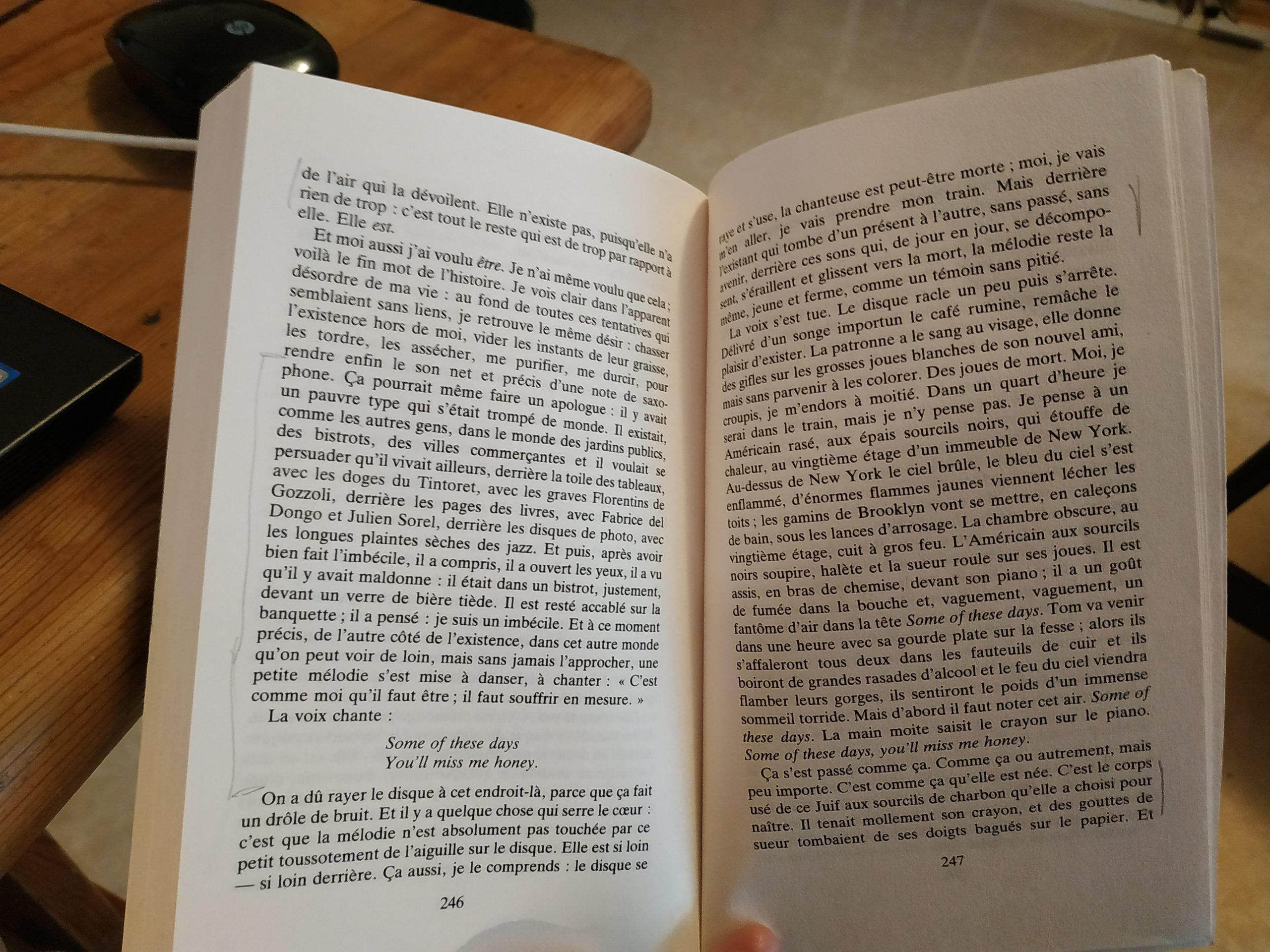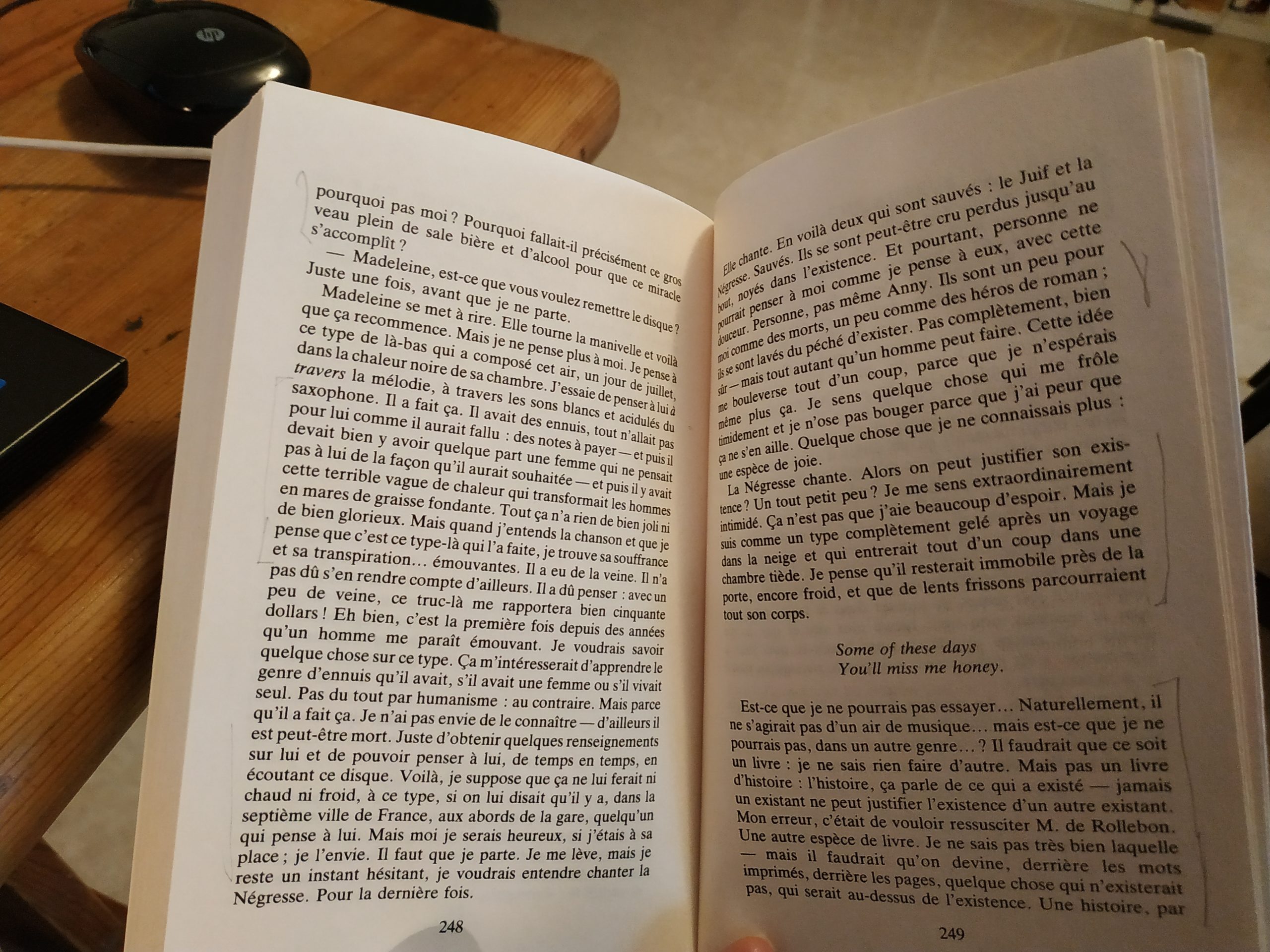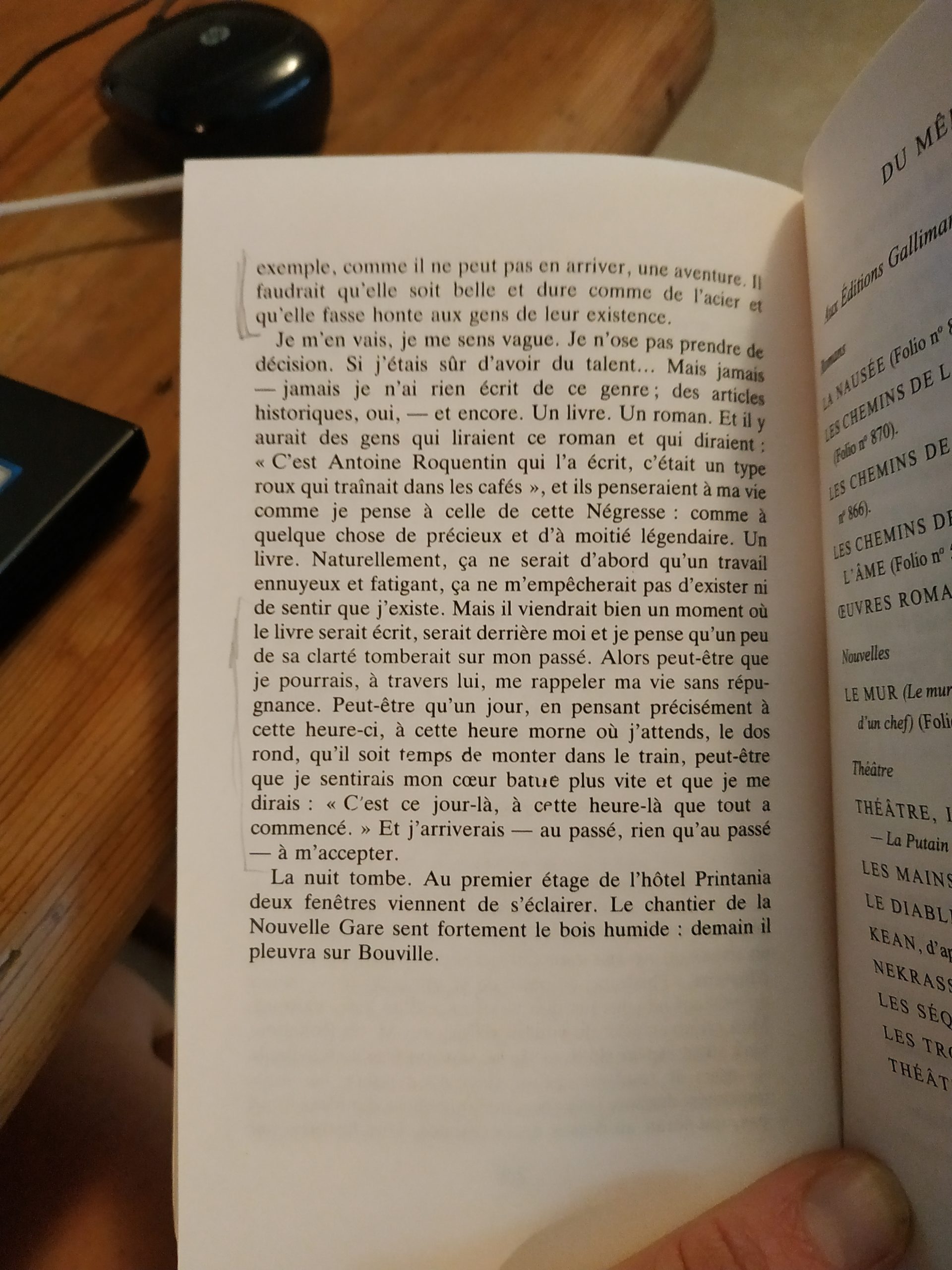Quand on est seul, on ne sait même plus ce que c’est que raconter : la vraisemblance disparaît en même temps que les amis. Les événements aussi, on les laisse couler ; on voit surgir brusquement des gens qui parlent et qui s’en vont, on plonge dans des histoires sans queue ni tête : on ferait un exécrable témoin.
p. 22
Le gardien a dit à mon oncle que c’était un ancien censeur. On l’avait mis à la retraite parce qu’il était venu lire les notes trimestrielles dans les classes en habit d’académicien. Nous en avions une peur horrible parce que nous sentions qu’il était seul. Un jour il a souri à Robert, en lui tendant les bras de loin : Robert a failli s’évanouir. Ce n’est pas l’air misérable de ce type qui nous faisait peur, ni la tumeur qu’il avait au cou et qui frottait contre le bord de son faux col : maus nous sentions qu’il formait dans sa tête des pensées de crabe ou de langouste. Et ça nous terrorisait, qu’on pût former des pensées de langouste, sur la guérite, sur nos cerceaux, sur les buissons.
Est-ce donc ça qui m’attend&nbp;? Pour la première fois cela m’ennuie d’être seule. Je voudrais parler à quelqu’un de ce qui m’arrive avant qu’il ne soit trop tard, avant que je ne fasse peur aux petits garçons. Je voudrais qu’Anny soit là.p. 24
Je suis resté courbé, une seconde, j’ai lu « Dictée : le Hibou blanc », puis je me suis relevé, les mains vides. Je ne suis plus libre, je ne peux plus faire ce que je veux.
Les objets, cela ne devrait pas toucher, puisque cela ne vit pas. On s’en sert, on les remet en place, on vit au milieu d’eux : ils sont utiles, rien de plus. Et moi, ils me touchent, c’est insupportable. J’ai peur d’entrer en contact avec eux tout comme s’ils étaient des bêtes vivantes.p. 26
Le boulevard Noir est inhumain. Comme un minéral. Comme un triangle. C’est une chance qu’il y ait un boulevard comme ça à Bouville. D’ordinaire on n’en trouve que dans les capitales, à Berlin, du côté de Neukölln ou encore vers Friedrichshain – à Londres derrière Greenwich. Des couloirs droits et sales, en plein courant d’air, avec de larges trottoirs sans arbres. Ils sont presque toujours hors de l’enceinte, dans ces étranges quartiers où l’on fabrique les villes, près des gares de marchandises, des dépôts de tramways, des abattoirs, des gazomètres. Deux jours après l’averse, quand toute la ville est moite sous le soleil et rayonne de chaleur humide, ils sont encore tout froids, ils conservent leur boue et leurs flaques. Ils ont même des flaques d’eau qui ne sèchent jamais, sauf un mois dans l’année, en août.
p. 46-47
Des dames en noir, qui viennent promener leurs chiens, glissent sous les arcades, le long des murs. Elles s’avancent rarement jusqu’au plein jour, mais elles jettent de côté des regards de jeunes filles, furtifs et satisfaits, sur la statue de Gustave Impétraz. Elles ne doivent pas savoir le nom de ce géant de bronze, mais elles voient bien, à sa redingote et à son haut-de-forme, que ce fut quelqu’un du beau monde. Il tient son chapeau de la main gauche et pose la main droite sur une pile d’in-folio : cest un peu comme si leur grand-père était là, sur ce socle, coulé en bronze. Elles n’ont pas besoin de le regarder longtemps pour comprendre qu’il pensait comme elles, tout juste comme elles, sur tous les sujets. Au service de leurs petites idées étroites et solides il a mis son autorité et l’immense érudition puisée dans les in-folio que sa lourde main écrase. Les dames en noir se sentent soulagées, elles peuvent vaquer tranquillement aux soins du ménage, promener leur chien : les saintes idées, les bonnes idées qu’elles tiennent de leurs pères, elle n’ont plus la responsabilité de les défendre ; un homme de bronze s’en est fait le gardien.
p. 49
Voici ce que j’ai pensé : pour que l’événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu’on se mette à le raconter. C’est ce qui dupe les gens : un homme, c’est toujours un conteur d’histoires, il vit entouré de ses histoires et des histoires d’autrui, il voit tout ce qui lui arrive à travers elles ; et il cherche à vivre sa vie comme s’il la racontait.
Mais il faut choisir : vivre ou raconter. Par exemple quand j’étais à Hambourg, avec cette Erna, dont je me défiais et qui avait peur de moi, je menais une drôle d’existence. Mais j’étais dedans, je n’y pensais pas. Et puis un soir, dans un petit café de San Pauli, elle m’a quitté pour aller aux lavabos. Je suis resté seul, il y avait un phonographe qui jouait Blue Sky. Je me suis mis à me raconter ce qui s’était passé depuis mon débarquement. Je me suis dit : « Le troisième soir, comme j’entrais dans un dancing appelé la Grotte Bleue, j’ai remarqué une grande femme à moitié saoule. Et cette femme-là, c’est celle que j’attends en ce moment, en écoutant Blue Sky et qui va revenir s’asseoir à ma droite et m’entourer le cou de ses bras. » Alors, j’ai senti avec violence que j’avais une aventure. Mais Erna est revenue, elle s’est assise à côté de moi, elle m’a entouré le cou de ses bras et je l’ai détestée sans trop savoir pourquoi. Je comprends, à présent : c’est qu’il fallait recommencer de vivre et que l’impression d’aventure venait de s’évanouir.
Quand on vit, il n’arrive rien. Les décors changent, les gens entrent et sortent, voilà tout. Il n’y a jamais de commencements. Les jours s’ajoutent aux jours sans rime ni raison, c’est une addition interminable et monotone. De temps en temps, on fait un total partiel, on dit : voilà trois ans que je voyage, trois ans que je suis à Bouville. Il n’y a pas de fin non plus : on ne quitte jamais une femme, un ami, une ville en une fois. Et puis tout se ressemble : Shanghaï, Moscou, Alger, au bout d’une quinzaine, c’est tout pareil. Par moments – rarement – on fait le point, on s’aperçoit qu’on s’est collé avec une femme, engagé dans une sale histoire. Le temps d’un éclair. Après ça, le défilé recommence, on se remet à faire l’addition des heures et des jours. Lundi, mardi, mercredi. Avril, mai, juin. 1924, 1925, 1926.
Ça, c’est vivre. Mais quand on raconte la vie, tout change ; seulement c’est un changement que personne ne remarque : la preuve c’est qu’on parle d’histoires vraies. Comme s’il pouvait y avoir des histoires vraies ; les événements se produisent dans un sens et nous les racontons en sens inverse. On a l’air de débuter par le commencement : « C’était par un beau soir de l’automne 1922. J’étais clerc de notaire à Marommes. » Et en réalité c’est par la fin qu’on a commencé. Elle est là, invisible et présente, c’est elle qui donne à ces quelques mots la pompe et la valeur d’un commencement. « Je me promenais, j’étais sorti du village sans m’en apercevoir, je pensais à mes ennuis d’argent. » Cette phrase, prise simplement pour ce qu’elle est, veut dire que le type était absorbé, morose, à cent lieues d’une aventure, précisément dans ce genre d’humeur où on laisse passer les événements sans les voir. Mais la fin est là, qui transforme tout. Pour nous, le type est déjà le héros de l’histoire. Sa morosité, ses ennuis d’argent sont bien plus précieux que les nôtres, ils sont tout dorés par la lumière des passions futures. Et le récit se poursuit à l’envers : les instants ont cessé de s’empiler au petit bonheur les uns sur les autres, ils sont happés par la fin de l’histoire qui les attire et chacun d’eux attire à son tour l’instant qui le précède : « Il faisait nuit, la rue était déserte. » La phrase est jetée négligemment, elle a l’air superflue ; mais nous ne nous y laissons pas pendre et nous la mettons de côté : c’est un renseignement dont nous comprendrons la valeur par la suite. Et nous avons le sentiment que le héros a vécu tous les détail de cette nuit comme des annonciations, comme des promesses, ou même qu’il vivait seulement ceux qui étaient des promesses, aveugle et sourd pour tout ce qui n’annonçait pas l’aventure. Nous oublions que l’avenir n’était pas encore là ; le type se promenait dans une nuit sans présages, qui lui offrait pêle-mêle ses richesses monotones et il ne choisissait pas.
J’ai voulu que les moments de ma vie se suivent et s’ordonnent comme ceux d’une vie qu’on se rappelle. Autant vaudrait tenter d’attraper le temps par la queue.p. 64-66
Ce sentiment d’aventure ne vient décidément pas des événements : la preuve en est faite. C’est plutôt la façon dont les instants s’enchaînent. Voilà, je pense, ce qui se passe : brusquement on sent que le temps s’écoule, que chaque instant conduit à un autre instant, celui-ci à un autre et ainsi de suite ; que chaque instant s’anéantit, que ce n’est pas la peine d’essayer de le retenir, etc. Et alors on attribue cette propriété aux événements qui vous apparaissent dans les instants ; ce qui appartient à la forme, on le reporte sur le contenu. En somme, ce fameux écoulement du temps, on en parle beaucoup, mais on ne le voit guère. On voit une femme, on pense qu’elle sera vieille, seulement on ne la voit pas vieillir. Mais, par moments, il semble qu’on la voie vieillir et qu’on se sente vieillir avec elle : c’est le sentiment d’aventure.
On appelle ça, si je me souviens bien, l’irréversibilité du temps. Le sentiment de l’aventure serait, tout simplement, celui de l’irréversibilité du temps. Mais pourquoi est-ce qu’on ne l’a pas toujours ? Est-ce que le temps ne serait pas toujours irréversible ? Il y a des moments où on a l’impression qu’on peut faire ce qu’on veut, aller de l’avant ou revenir en arrière, que ça n’a pas d’importance ; et puis d’autres où l’on dirait que les mailles se sont resserrées et, dans ces cas-là, il ne s’agit pas de manquer son coup parce qu’on ne pourrait plus le recommencer.p. 88
Je prends sa lettre dans mon portefeuille. Elle n’a pas écrit « mon cher Antoine ». Au bas de la lettre, il n’y a pas non plus de formule de politesse : « Il faut que je te voie. Anny. » Rien qui puisse me fixer sur ses sentiments. Je ne peux m’en plaindre : je reconnais là son amour du parfait. Elle voulait toujours réaliser des « moments parfaits ». Si l’instant ne s’y prêtait pas, elle ne prenait plus d’intérêt à rien, la vie disparaissait de ses yeux, elle traînait paresseusement, avec l’air d’une grande fille à l’âge ingrat. Ou bien encore elle me cherchait querelle :
« Tu te mouches comme un bourgeois, solennellement, et tu toussotes dans ton mouchoir avec satisfaction. »
Il ne fallait pas répondre, il fallait attendre : soudain à quelque signal, qui m’échappait, elle tressaillait, elle durcissait ses beaux traits languissants et commençait son travail de fourmi. Elle avait une magie impérieuse et charmante ; elle chantonnait entre ses dents en regardant de tous les côtés, puis elle se redressait en souriant, venait me secouer par les épaules, et, pendant quelques instants, semblait donner des ordres aux objets qui l’entouraient. Elle m’expliquait, d’une voix basse et rapide, ce qu’elle attendait de moi.
« Ecoute, si tu veux bien faire un effort, n’est-ce pas ? Tu as été si sot, la dernière fois. Tu vois comme ce moment-ci pourrait être beau ? Regarde le ciel, regarde la couleur du soleil sur le tapis. J’ai justement mis ma robe verte et je ne me suis pas fardée, je suis toute pâle. Recule-toi, va t’asseoir dans l’ombre ; tu comprends ce que tu as à faire ? Eh bien, voyons ! Que tu es sot ! Parle-moi. »
Je sentais que le succès de l’entreprise était dans mes mains : l’instant avait un sens obscur qu’il fallait dégrossir et parfaire : certains gestes devaient être faits, certaines paroles dites : j’étais accablé sous le poids de ma responsabilité, j’écarquillais les yeux et je ne voyais rien, je me débattais au milieu de rites qu’Anny inventait sur le moment et je les déchirais de mes grands bras comme des toiles d’araignées. A ces moments-là elle me haïssait.p. 95-96
Et puis, quand Anny m’a quitté, d’un seul coup, d’une seule pièce, les trois ans se sont écroulés dans le passé. Je n’ai même pas souffert, je me sentais vide. Ensuite le temps s’est remis à couler et le vide s’est agrandi. Ensuite, à Saïgon, quand j’ai décidé de revenir en France, tout ce qui demeurait encore – des visages étrangers, des places, des quais au bord de longs fleuves – tout s’est anéanti. Et voilà, mon passé n’est plu qu’un trou énorme. Mon présent : cette bonne au corsage noir qui rêve près du comptoir, ce petit bonhomme. Tout ce que je sais de ma vie, il me semble que je l’ai appris dans les livres. Les palais de Bénarès, la terrasse du roi Lépreux, les temples de Java avec leurs grands escaliers brisés, se sont un instant reflétés dans mes yeux, mais ils sont restés là-bas, sur place. Le tramway qui passe devant l’hôtel Printania n’emporte pas, le soir, à ses vitres, le reflet de l’enseigne au néon ; il s’enflamme un instant et s’éloigne avec des vitres noires.
p. 97-98
Ils vivent au milieu des legs, des cadeaux et chacun de leurs meubles est un souvenir. Pendulettes, médailles, portraits, coquillages, presse-papiers, paravents, châles. Ils ont des armoires pleines de bouteilles, d’étoffes, de vieux vêtements, de journaux ; ils ont tout gardé. Le passé, c’est un luxe de propriétaire.
Où donc conserverais-je le mien ? On ne met pas son passé dans sa poche ; il faut avoir une maison pour l’y ranger. Je ne possède que mon corps ; un homme tout seul, avec son seul corps, ne peut pas arrêter les souvenirs ; ils lui passent au travers. Je ne devrais pas me plaindre : je n’ai voulu qu’être libre.p. 99
La pluie a cessé, l’air est doux, le ciel roule lentement de belles images noires : c’est plus qu’il n’en faut pour faire le cadre d’un moment parfait ; pour refléter ces images, Anny ferait naître dans nos cœurs de sombres petites marées. Moi, je ne sais pas profiter de l’occasion : je vais au hasard, vide et calme, sous ce ciel inutilisé.
p. 106
Cet homme n’avait vécu que pour lui-même. Par un châtiment sévère et mérité, personne, à son lit de mort, n’était venu lui fermer les yeux. Ce tableau me donnait un dernier avertissement : il était encore temps, je pouvais retourner sur mes pas. Mais, si je passais outre, que je sache bien ceci : dans le grand salon où j’allais entrer, plus de cent cinquante portraits étaient accrochés aux murs ; si l’on exceptait quelques jeunes gens enlevés trop tôt à leurs familles et la mère supérieure d’un orphelinat, aucun de ceux qu’on avait représentés n’était mort célibataire, aucun d’eux n’était mort sans enfants ni intestat, aucun sans les derniers sacrements. En règle, ce jour-là comme les autres, avec Dieu et avec le monde, ces hommes avaient glissé doucement dans la mort, pour aller réclamer la part de vie éternelle à laquelle ils avaient droit.
p. 122-123
Il avait toujours fait son devoir, tout son devoir, son devoir de fils, d’époux, de père, de chef. Il avait aussi réclamé ses droits sans faiblesse :enfant, le droit d’être bien élevé, dans une famille unie, celui d’hériter d’un nom sans tache, d’une affaire prospère ; mari, le droit d’être soigné, entouré d’affection tendre ;père, celui d’être vénéré ;chef, le droit d’être obéi sans murmure. Car un droit n’est jamais que l’autre aspect d’un devoir. Sa réussite extraordinaire (les Pacôme ont aujourd’hui la plus riche famille de Bouville) n’avait jamais dû l’étonner. Il ne s’était jamais dit qu’il était heureux et lorsqu’il prenait un plaisir, il devait s’y livrer avec modération, en disant : « Je me délasse. » Ainsi le plaisir, passant lui aussi au rang de droit, perdait son agressive futilité.
p. 125
Sans doute, à son lit de mort, à cette heure où l’on est convenu, depuis Socrate, de prononcer quelques paroles élevées, avait-il dit à sa femme, comme un de mes oncles à la sienne, qui l’avait veillé douze nuits : « Toi, Thérèse, je ne te remercie pas ; tu n’as fait que ton devoir. » Quand un homme en arrive là, il faut lui tirer son chapeau.
p. 130
« Le pays, dit-il dans un discours célèbre, souffre de la plus grave maladie : la classe dirigeante ne veut plus commander. Et qui donc commandera, messieurs, si ceux que leur hérédité, leur éducation, leur expérience ont rendus les plus aptes à l’exercice du pouvoir, s’en détournent par résignation ou par lassitude ? Je l’ai dit souvent : commander n’est pas un droit de l’élite ; c’est son principal devoir. Messieurs, je vous en conjure : restaurons le principe d’autorité ! »
p. 134
Ma pensée, c’est moi : voilà pourquoi je ne peux pas m’arrêter. J’existe parce que je pense… et je ne peux pas m’empêcher de penser. En ce moment même – c’est affreux – si j’existe c’est parce que j’ai horreur d’exister. C’est moi, c’est moi qui me tire du néant auquel j’aspire : la haine, le dégoût d’exister, ce sont autant de manières de me faire exister, de m’enfoncer dans l’existence. Les pensées naissent par-derrière moi comme un vertige, je les sens naître derrière ma tête… si je cède, elles vont venir là devant, entre mes yeux – et je cède toujours, la pensée grossit, grossit et la voilà, l’immense, qui me remplit tout entier et renouvelle mon existence.
p. 145
Je parcours la salle des yeux. C’est une farce ! Tous ces gens sont assis avec des airs sérieux ; ils mangent. Non, ils ne mangent pas : ils réparent leurs forces pour mener à bien la tâche qui leur incombe. Ils ont chacun leur petit entêtement personnel qui les empêche de s’apercevoir qu’ils existent ; il n’en est pas un qui ne se croie indispensable à quelqu’un ou à quelque chose.
p. 160
L’humaniste radical est tout particulièrement l’ami des fonctionnaires. L’humaniste dit « de gauche » a pour souci principal de garder ses valeurs humaines ; il n’est d’aucun parti, parce qu’il ne veut pas trahir l’humain, mais ses sympathies vont aux humbles ; c’est aux humbles qu’il consacre sa belle culture classique. C’est en général un veuf qui a l’œil beau et toujours embué de larmes ; il pleure aux anniversaires. Il aime aussi le chat, le chien, tous les mammifères supérieurs. L’écrivain communiste aime les hommes depuis le deuxième plan quinquennal ; il châtie parce qu’il aime. Pudique, comme tous les forts, il sait cacher ses sentiments, mais il sait aussi, par un regard, une inflexion de sa voix, faire pressentir, derrière ses rudes paroles de justicier, sa passion âpre et douce pour ses frères. L’humaniste catholique, le tard-venu, le benjamin, parle des hommes avec un air merveilleux. Quel beau conte de fées, dit-il, que la plus humble des vies, celle d’un docker londonien, d’une piqueuse de bottines ! Il a choisi l’humanisme des anges ; il écrit, pour l’édification des anges, de longs romans tristes et beaux, qui obtiennent fréquemment le prix Fémina.
Ca, ce sont les grands premiers rôles. Mais il y en a d’autres, une nuée d’autres : le philosophe humaniste, qui se penche sur ses frères comme un frère aîné et qui a le sens de ses responsabilités ; l’humaniste qui aime les hommes tels qu’ils sont, celui qui les aime tels qu’ils devraient être, celui qui veut les sauver avec leur agrément et celui qui les sauvera malgré eux, celui qui veut créer des mythes nouveaux et celui qui se contente des anciens, celui qui aime dans l’homme sa mort, celui qui aime dans l’homme sa vie, l’humaniste joyeux, qui a toujours le mot pour rire, l’humaniste sombre, qu’on rencontre surtout aux veillées funèbres. Ils se haïssent tous entre eux : en tant qu’individus, naturellement – pas en tant qu’hommes. Mais l’Autodidacte l’ignore : il les a enfermés en lui comme des chats dans un sac de cuir et ils s’entredéchirent sans qu’il s’en aperçoive.p. 167-168
– Peut-être que vous êtes misanthrope ?
Je sais ce que dissimule ce fallacieux effort de conciliation. Il me demande peu de chose, en somme : simplement d’accepter une étiquette. Mais c’est un piège : si je consens l’Autodidacte triomphe, je suis aussitôt tourné, ressaisi, dépassé, car l’humanisme reprend et fond ensemble toutes les attitudes humaines. Si l’on s’oppose à lui de front, on fait son jeu ; il vit de ses contraires. Il est une race de gens têtus et bornés, de brigands, qui perdent à tout coup contre lui : toutes leurs violences, leurs pires excès, il les digère, il en fait une lymphe blanche et mousseuse. Il a digéré l’anti-intellectualisme, le manichéisme, le mysticisme, le pessimisme, l’anarchisme, l’égotisme : ce ne sont plus que des étapes, des pensées incomplètes qui ne trouvent leur justification qu’en lui. La misanthropie aussi tient sa place dans ce concert : elle n’est qu’une dissonance nécessaire à l’harmonie du tout. Le misanthrope est homme : il faut donc bien que l’humaniste soit misanthrope en quelque mesure. Mais c’est un misanthrope scientifique, qui a su doser sa haine, qui ne hait d’abord les hommes que pour mieux pouvoir ensuite les aimer.p. 170
Le mot d’Absurdité naît à présent sous ma plume ; tout à l’heure, au jardin, je ne l’ai pas trouvé, mais je ne le cherchais pas non pus, je n’en avais pas besoin : je pensais sans mots, sur les choses, avec les choses. L’absurdité, ce n’était pas une idée dans ma tête, ni un souffle de voix, mais ce long serpent mort à mes pieds, ce serpent de bois. Serpent ou griffe ou racine ou serre de vautour, peu importe. Et sans rien formuler nettement, je comprenais que j’avais trouvé la clef de l’Existence, la clef de mes Nausées, de ma propre vie. De fait, tout ce que j’ai pu saisir ensuite se ramène à cette absurdité fondamentale. Absurdité : encore un mot ; je me débats contre des mots ; là-bas, je touchais la chose. Mais je voudrais fixer ici le caractère absolu de cette absurdité. Un geste, un événement dans le petit monde colorié des hommes n’est jamais absurde que relativement : par rapport aux circonstances qui l’accompagnent. Les discours d’un fou, par exemple, sont absurdes par rapport à la situation où il se trouve mais non par rapport à son délire. Mais moi, tout à l’heure, j’ai fait l’expérience de l’absolu : l’absolu ou l’absurde. Cette racine, il n’y avait rien par rapport à quoi elle ne fût absurde. Oh ! Comment pourrai-je fixer ça avec des mots ? Absurde : par rapport aux cailloux, aux touffes d’herbe jaune, à la boue sèche, à l’arbre, au ciel, aux bancs verts. Absurde, irréductible ; rien – pas même un délire profond et secret de la nature – ne pouvait l’expliquer. Evidemment je ne savais pas tout, je n’avais pas vu le germe se développer ni l’arbre croître. Mais devant cette grosse patte rugueuse, ni l’ignorance ni le savoir n’avaient d’importance : le monde des explications et des raisons n’est pas celui de l’existence. Un cercle n’est pas absurde, il s’explique très bien par la rotation d’un segment de droite autour d’une de ses extrémités. Mais aussi un cercle n’existe pas. Cette racine, au contraire, existait dans la mesure où je ne pouvais pas l’expliquer. Noueuse, inerte, sans nom, elle me fascinait, m’emplissait les yeux, me ramenait sans cesse à sa propre existence. J’avais beau me répéter : « C’est une racine » – ça ne prenait plus. Je voyais bien qu’on ne pouvait pas passer de sa fonction de racine, de pompe aspirante, à ça, à cette peau dure et compacte de phoque, à cet aspect huileux, calleux, entêté. La fonction n’expliquait rien : elle permettait de comprendre en gros ce que c’était qu’une racine, mais pas du tout celle-ci. Cette racine, avec sa couleur, sa forme, son mouvement figé, était… au-dessous de toute explication. Chacune de ses qualités lui échappait un peu, coulait hors d’elle, se solidifiait à demi, devenait presque une chose ; chacune était de trop dans la racine, et la souche tout entière me donnait à présent l’impression de rouler hors d’elle-même, de se nier, de se perdre dans un étrange excès.
p. 183-185
L’essentiel c’est la contingence. Je veux dire que, par définition, l’existence n’est pas la nécessité. Exister, c’est être là, simplement ; les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. Il y a des gens, je crois, qui ont compris ça. Seulement ils ont essayé de surmonter cette contingence en inventant un être nécessaire et cause de soi. Or aucun être nécessaire ne peut expliquer l’existence : la contingence n’est pas un faux-semblant, une apparence qu’on peut dissiper ; c’est l’absolu, par conséquent la gratuité parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même.
p. 187
Et puis, tout d’un coup, ça s’est mis à remuer devant mes yeux, des mouvements légers et incertains : le vent secouait la cime de l’arbre.
Ca ne me déplaisait pas de voir bouger quelque chose, ça me changeait de toutes ces existences immobiles qui me regardaient comme des yeux fixes. Je me disais, en suivant le balancement des branches : les mouvement n’existent jamais tout à fait, ce sont des passages, des intermédiaires entre deux existences, des temps faibles. je m’apprêtais à les voir sortir du néant, mûrir progressivement, s’épanouir : j’allais enfin surprendre des existences en train de naître.
Il n’a pas fallu plus de trois secondes pour que tous mes espoirs fussent balayés. Sur ces branches hésitantes qui tâtonnaient autour d’elles en aveugles, je n’arrivais pas à saisir de « passage » à l’existence. Cette idée de passage, c’était encore une invention des hommes. Une idée trop claire. Toutes ces agitations menues s’isolaient, se posaient pour elles-mêmes. Elles débordaient de toutes parts les branches et les rameaux. Elles tourbillonnaient autour de ces mains sèches, les enveloppaient de petits cyclones. Bien sûr, un mouvement c’était autre chose qu’un arbre. Mais c’était tout de même un absolu. Une chose. Mes yeux ne rencontraient jamais que du plein. Ca grouillait d’existences, au bout des branches, d’existences qui se renouvelaient sans cesse et qui ne naissaient jamais. Le vent-existant venait se poser sur l’arbre comme une grosse mouche ; et l’arbre frissonnait. Mais le frisson n’était pas une qualité naissante, un passage de la puissance à l’acte ; c’était une chose, une chose-frisson se coulait dans l’arbre, s’en emparait, le secouait, et soudain l’abandonnait, s’en allait plus loin tourner sur elle-même. Tout était plein, tout en acte, il n’y avait pas de temps faible, tout, même le plus imperceptible sursaut, était fait avec de l’existence. Et tous ces existants qui s’affairaient autour de l’arbre ne venaient de nulle part et n’allaient nulle part. Tout d’un coup ils existaient et ensuite, tout d’un coup, ils n’existaient plus : l’existence est sans mémoire ; des disparus, elle ne garde rien – pas même un souvenir.p. 188-189
Les arbres flottaient. Un jaillissement vers le ciel ? Un affalement plutôt ; à chaque instant je m’attendais à voir les troncs se rider comme des verges lasses, se recroqueviller et choir sur le sol en un tas noir et mou avec des plis. Ils n’avaient pas envie d’exister, seulement ils ne pouvaient pas s’en empêcher ; voilà. Alors ils faisaient toutes leurs petites cuisines, doucement, sans entrain ; la sève montait lentement dans les vaisseaux, à contrecœur, et les racines s’enfonçaient lentement dans la terre. Mais ils semblaient à chaque instant sur le point de tout planter là et de s’anéantir. Las et vieux, ils continuaient d’exister, de mauvais grâce, simplement parce qu’ils étaient trop faibles pour mourir, parce que la mort ne pouvait leur venir que de l’extérieur : il n’y a que les airs de musique pour porter fièrement leur propre mort en soi comme une nécessité interne ; seulement ils n’existent pas. Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre.
p. 190
Tu te plains parce que les choses ne se disposent pas autour de toi comme un bouquet de fleurs, sans que tu te donnes la peine de rien faire. Mais jamais je n’en ai tant demandé : je voulais agir. Tu sais, quand nous jouions à l’aventurier et à l’aventurière : toi tu étais celui à qui il arrive des aventures, mois j’étais celle qui les fait arriver. Je disais : « Je suis un homme d’action. » Tu te rappelles ? Eh bien, je dis simplement à présent : on ne peut pas être un homme d’action.
p. 213
– Mais tu n’étais jamais prise par ton rôle ?
– Un peu, par moments : jamais très fort. L’essentiel, pour nous tous, c’était le trou noir, juste devant nous, au fond duquel il y avait des gens qu’on ne voyait pas ; à ceux-là, évidemment, on présentait un moment parfait. Mais, tu sais, ils ne vivaient pas dedans : il se déroulait devant eux. Et nous, les acteurs, tu penses que nous vivons dedans ? Finalement il n’était nulle part, ni d’un côté ni de l’autre de la rampe, il n’existait pas ; et pourtant tout le monde pensait à lui. Alors tu comprends, mon petit, dit-elle d’un ton traînant et presque canaille, j’ai tout envoyé promener.p. 215
Peut-être la reverrai-je dans dix ans. Peut-être est-ce la dernière fois que je la vois. Je ne suis pas simplement accablé de la quitter ; j’ai une peur affreuse de retrouver ma solitude.
p. 217
De toute façon, je serai de retour à Paris avant la fin de la semaine.
Et qu’est-ce que je gagnerai au change ? C’est toujours une ville : celle-ci est fendue par un fleuve, l’autre est bordée par la mer, à cela près elles se ressemblent. On choisit une terre pelée, stérile, et on y roule de grandes pierres creuses. Dans ces pierres, des odeurs sont captives, des odeurs plus lourdes que l’air. Quelquefois on les jette par la fenêtre dans les rues et elles y restent jusqu’à ce que le vent les ait déchirées. Par temps clair, les bruits entrent par un bout de la ville et sortent par l’autre bout, après avoir traversé tous les murs ; d’autres fois, entre ces pierres que le soleil cuit, que le gel fend, ils tournent en rond.p. 219-220
Je suis libre : il ne me reste plus aucune raison de vivre, toutes celles que j’ai essayées ont lâché et je ne peux plus en imaginer d’autres. Je suis encore assez jeune, j’ai encore assez de forces pour recommencer. Mais que faut-il recommencer ? Combien, au plus fort de mes terreurs, de mes nausées, j’avais compté sur Anny pour me sauver, je le comprends seulement maintenant. Mon passé est mort, M. de Rollebon est mort, Anny n’est revenue que pour m’ôter tout espoir. Je suis seul dans cette rue blanche que bordent les jardins. Seul et libre. Mais cette liberté ressemble un peu à la mort.
Aujourd’hui ma vie prend fin. Demain j’aurai quitté cette ville qui s’étend à mes pieds, où j’ai si longtemps vécu. Elle ne sera plus qu’un nom, trapu, bourgeois, bien français, un nom dans ma mémoire, moins riche que ceux de Florence ou de Bagdad. Il viendra une époque où je me demanderai : « Mais enfin, quand j’étais à Bouville, qu’est-ce que je pouvais donc faire, au long de la journée ? » Et de ce soleil, de cet après-midi, il ne restera rien, pas même un souvenir.
Toute ma vie est derrière moi. Je la vois tout entière, je vois sa forme et les lents mouvements qui m’ont mené jusqu’ici. Il y a peu de choses à en dire : c’est une partie perdue, voilà tout. Voici trois ans que je suis entré à Bouville, solennellement. J’avais perdu la première manche. J’ai voulu jouer la seconde et j’ai perdu aussi : j’ai perdu la partie. Du même coup, j’ai appris qu’on perd toujours. Il n’y a que les Salauds qui croient gagner. A présent, je vais faire comme Anny, je vais me survivre. Manger, dormir. Dormir, manger. Exister lentement, doucement, comme ces arbres, comme une flaque d’eau, comme la banquette rouge du tramway.
La Nausée me laisse un court répit. Mais je sais qu’elle reviendra : c’est mon état normal. Seulement, aujourd’hui, mon corps est trop épuisé pour la supporter. Les malades aussi ont d’heureuses faiblesses qui leur ôtent, quelques heures, la conscience de leur mal. Je m’ennuie, c’est tout. De temps en temps je bâille si fort que les larmes me roulent sur les joues. C’est un ennui profond, profond, le cœur profond de l’existence, la matière même dont je suis fait. Je ne me néglige pas, bien au contraire : ce matin j’ai pris un bain, je me suis rasé. Seulement, quand je repense à tous ces petits actes soigneux, je ne comprends pas comment j’ai pu les faire : ils sont si vains. Ce sont les habitudes, sans doute, qui les ont faits pour moi. Elles ne sont pas mortes, elles, elles continuent à s’affairer, à tisser tout doucement, insidieusement leurs trames, elles me lavent, m’essuient, m’habillent, comme des nourrices. Est-ce que ce sont elles, aussi, qui m’ont conduit sur cette colline ?p. 221-222
Comme je me sens loin d’eux, du haut de cette colline. Il me semble que j’appartiens à une autre espèce. Ils sortent des bureaux, après leur journée de travail, ils regardent les maisons et les squares d’un air satisfait, ils pensent que c’est leur ville, une « belle cité bourgeoise ». Ils n’ont pas peur, ils se sentent chez eux. Ils n’ont jamais vu que l’eau apprivoisée qui coule des robinets, que la lumière qui jaillit des ampoules quand on appuie sur l’interrupteur, que les arbres métis, bâtards, qu’on soutient avec des fourches. Ils ont la preuve, cent fois par jour, que tout se fait par mécanisme, que le monde obéit à des lois fixes et immuables. Les corps abandonnés dans le vide tombent tous à la même vitesse, le jardin public est fermé tous les jours à seize heures en hiver, à dix-huit heures en été, le plomb fond à 335°, le dernier tramway part de l’Hôtel de Ville à vingt-trois heures cinq. Ils sont paisibles, un peu moroses, ils pensent à Demain, c’est-à-dire, simplement, à un nouvel aujourd’hui ; les villes ne disposent que d’une seule journée qui revient toute pareille à chaque matin. A peine la pomponne-t-on un peu, les dimanches. Les imbéciles. Ça me répugne, de penser que je vais revoir leurs faces épaisses et rassurées. Ils légifèrent, ils écrivent des romans populistes, ils se marient, ils ont l’extrême sottise de faire des enfants. Cependant, la grande nature vague s’est glissée dans leur ville, elle s’est infiltrée, partout, dans leurs maisons, dans leurs bureaux, en eux-mêmes. Elle ne bouge pas, elle se tient tranquille et eux, ils sont en plein dedans, ils la respirent et ils ne la voient pas, ils s’imaginent qu’elle est dehors, à vingt lieues de la ville. Je la vois, moi, cette nature, je la vois… Je sais que sa soumission est paresse, je sais qu’elle n’a pas de lois : ce qu’ils prennent pour sa constance… Elle n’a que des habitudes et elle peut en changer demain.
p. 223-224
Le soir tombe, les premières lampes s’allument dans la ville. Mon Dieu ! Comme la ville a l’air naturelle, malgré toutes ses géométries, comme elle a l’air écrasée par le soir. C’est tellement… évident, d’ici ; se peut-il que je sois le seul à la voir ? N’y a-t-il nulle part d’autre Cassandre, au sommet d’une colline, regardant à ses pieds une ville engloutie au fond de la nature ? D’ailleurs que m’importe ? Que pourrais-je lui dire ?
p. 225-226
Madeleine va le déposer sur le plateau du phonographe, il va tourner ; dans les rainures l’aiguille d’acier va se mettre à sauter et à grincer et puis, quand elles l’auront guidée en spirale jusqu’au centre du disque, ce sera fini, la voix rauque qui chante « Some of these days » se taira pour toujours.
Ça commence.
Dire qu’il y a des imbéciles pour puiser des consolations dans les beaux-arts. Comme ma tante Bigeois : « Les Préludes de Chopin m’ont été d’un tel secours à la mort de ton pauvre oncle. » Et les salles de concert regorgent d’humiliés, d’offensés qui, les yeux clos, cherchent à transformer leurs pâles visages en antennes réceptrices. Ils se figurent que les sons captés coulent en eux, doux et nourrissants et que leurs souffrances deviennent musique, comme celles du jeune Werther ; ils croient que la beauté leur est compatissante. Les cons.
Je voudrais qu’ils me disent s’ils la trouvent compatissante, cette musique-ci. Tout à l’heure, j’étais certainement très loin de nager dans la béatitude. A la surface je faisais mes comptes, mécaniquement. Au-dessous stagnaient toutes ces pensées désagréables qui ont pris la forme d’interrogations informulées, d’étonnements muets et qui ne me quittent plus ni jour ni nuit. Des pensées sur Anny, sur ma vie gâchée. Et puis, encore au-dessous, la Nausée, timide comme une aurore. Mais à ce moment, il n’y avait pas de musique, j’étais morose et tranquille. Tous les objets qui m’entouraient étaient faits de la même matière que moi, d’une espèce de souffrance moche. Le monde était si laid, hors de moi, si laids ces verres sales sur les tables, et les taches brunes sur la glace et le tablier de Madeleine et l’air aimable du gros amoureux de la patronne, si laide l’existence même du monde, que je me sentais à l’aise, en famille.
A présent, il y a ce chant de saxophone. Et j’ai honte. Une glorieuse petite souffrance vient de naître, une souffrance-modèle. Quatre notes de saxophone. Elles vont et viennent, elles ont l’air de dire : « Il faut faire comme nous, souffrir en mesure. » Eh bien, oui ! Naturellement, je voudrais bien souffrir de cette façon-là, en mesure, sans complaisance, sans pitié pour moi-même, avec une aride pureté. Mais est-ce que c’est ma faute si la bière est tiède au fond de mon verre, s’il y a des taches brunes sur la glace, si je suis de trop, si la plus sincère de mes souffrances, la plus sèche, se traîne et s’appesantit, avec trop de chair et la peau trop large à la fois, comme l’éléphant de mer, avec de gros yeux humides et touchants mais si vilains ? Non, on ne peut certainement pas dire qu’elle soit compatissante, cette petite douleur de diamant, qui tourne en rond au-dessus du disque et m’éblouit. Même pas ironique : elle tourne allégrement tout occupée d’elle-même ; elle a tranché comme une faux la fade intimité du monde et maintenant elle tourne et nous tous, Madeleine, le gros homme, la patronne, moi-même et les tables, les banquettes, la glace tachée, les verres, nous tous qui nous abandonnions à l’existence, parce que nous étions entre nous, rien qu’entre nous, elles nous a surpris dans le débraillé, dans le laisser-aller quotidien : j’ai honte pour moi-même et pour ce qui existe devant elle.
Elle n’existe pas. C’en est même agaçant ; si je me levais, si j’arrachais ce disque du plateau qui le supporte et si je le cassais en deux, je ne l’atteindrais pas, elle. Elle est au-delà – toujours au-delà de quelque chose, d’une voix, d’une note de violon. A travers des épaisseurs et des épaisseurs d’existence, elle se dévoile, mince et ferme et, quand on veut la saisir, on ne rencontre que des existants, on bute sur des existants dépourvus de sens. Elle est derrière eux : je ne l’entends même pas, j’entends des sons, des vibrations de l’air qui la dévoilent. Elle n’existe pas, puisqu’elle n’a rien de trop : c’est tout le reste qui est de trop par rapport à elle. Elle est.
Et moi aussi j’ai voulu être. Je n’ai voulu que cela ; voilà le fin mot de l’histoire. Je vois clair dans l’apparent désordre de ma vie : au fond de toutes ces tentatives qui semblaient sans liens, je retrouve le même désir : chasser l’existence hors de moi, vider les instants de leur graisse, les tordre, les assécher, me purifier, me durcir, pour rendre enfin le son net et précis d’une note de saxophone. Ca pourrait même faire un apologue : il y avait un pauvre type qui s’était trompé de monde. Il existait, comme les autres gens, dans le monde des jardins publics, des bistrots, des villes commerçantes et il boulait se persuader qu’il vivait ailleurs, derrière la toile des tableaux, avec les doges du Tintoret, avec les graves Florentins de Gozzoli, derrière les pages des livres, avec Fabrice del Dongo et Julien Sorel, derrière les disques de photo, avec les longues plaintes sèches des jazz. Et puis, après avoir bien fait l’imbécile, il a compris, il a ouvert les yeux, il a vu qu’il y avait maldonne : il était dans un bistrot, justement, devant un verre de bière tiède. Il est resté accablé sur la banquette ;il a pensé : je suis un imbécile. Et à ce moment précis, de l’autre côté de l’existence, dans cet autre monde qu’on peut voir de loin, mais sans jamais l’approcher, une petite mélodie s’est mise à danser, à chanter : « C’est comme moi qu’il faut être ; il faut souffrir en mesure. »
La voix chante :Some of these days
You’ll miss me honey.On a dû rayer le disque à cet endroit-là, parce que ça fait un drôle de bruit. Et il y a quelque chose qui serre le cœur : c’est que la mélodie n’est absolument pas touchée par ce petit toussotement de l’aiguille sur le disque. Elle est si loin – si loin derrière. Ça aussi, je le comprends : le disque se raye et s’use, la chanteuse est peut-être morte ; moio, je vais m’en aller, je vais prendre mon train. Mais derrière l’existant qui tombe d’un présent à l’autre, sans passé, sans avenir, derrière ces sons qui, de jour en jour, se décomposent, s’éraillent et glissent vers la mort, la mélodie reste la même, jeune et ferme, comme un témoin sans pitié.
La voix s’est tue. Le disque racle un peu puis s’arrête. Délivré d’un songe importun le café rumine, remâche le plaisir d’exister. La patronne a le sang au visage, elle donne des gifles sur les grosses joues blanches de son nouvel ami, mais sans parvenir à les colorer. Des joues de mort. Moi je croupis, je m’endors à moitié. Dans un quart d’heure je serai dans le train, mais je n’y pense pas. Je pense à un Américain rasé, aux épais sourcils noirs, qui étouffe de chaleur, au vingtième étage d’un immeuble de New York. Au-dessus de New York le ciel brûle, le bleu du ciel s’est enflammé, d’énormes flammes jaunes viennent lécher les toits ; les gamins de Brooklyn vont se mettre, en caleçons de bain, sous les lances d’arrosage. La chambre obscure, au vingtième étage, cuit à gros feu. L’Américain aux sourcils noirs soupire, halète et la sueur roule sur ses joues. Il est assis, en bras de chemise, devant son piano ; il a un goût de fumée dans la bouche et, vaguement, vaguement, un fantôme d’air dans la tête Some of these days. Tom va venir dans une heure avec sa gourde plate sur la fesse ; alors ils s’affaleront tous les deux dans les fauteuils de cuir et ils boiront de grandes rasades d’alcool et le feu du ciel viendra flamber leurs gorges, ils sentiront le poids d’un immense sommeil torride. Mais d’abord il faut noter cet air. Some of these days. La main moite saisit le crayon sur le piano. Some of these days, you’ll miss me honey.
Ca s’est passé comme ça. Comme ça ou autrement, mais peu importe. C’est comme ça qu’elle est née. C’est le corps usé de ce Juif aux sourcils de charbon qu’elle a choisi pour naître. Il tenait mollement son crayon, et des gouttes de sueur tombaient de ses doigts bagués sur le papier. Et pourquoi pas moi ? Pourquoi fallait-il précisément ce gros veau plein de sale bière et d’alcool pour que ce miracle s’accomplît ?
– Madeleine, est-ce que vous voulez remettre le disque ? Juste une fois, avant que je ne parte.
Madeleine se met à rire. Elle tourne la manivelle et voilà que ça recommence. Mais je ne pense plus à moi. Je pense à ce type là-bas qui a composé cet air, un jour de juillet, dans la chaleur noire de sa chambre. J’essaie de penser à lui à travers la mélodie, à travers les sons blancs et acidulés du saxophone. Il a fait ça. Il avait des ennuis, tout n’allait pas pour lui comme il aurait fallu : des notes à payer – et puis il devait bien y avoir quelque part une femme qui ne pensait pas à lui de la façon qu’il aurait souhaitée – et puis il y avait cette terrible vague de chaleur qui transformait les hommes en mares de graisse fondante. Tout ça n’a rien de bien joli ni de bien glorieux. Mais quand j’entends la chanson et que je pense que c’est ce type-là qui l’a faite, je trouve sa souffrance et sa transpiration… émouvantes. Il a eu de la veine. Il n’a pas dû s’en rendre compte d’ailleurs. Il a dû penser : avec un peu de veine, ce truc-là me rapportera bien cinquante dollars !p. 244-248
Elle chante. En voilà deux qui sont sauvés : le Juif et la Négresse. Sauvés. Ils se sont peut-être cru perdus jusqu’au bout, noyés dans l’existence. Et pourtant, personne ne pourrait penser à moi comme je pense à eux, avec cette douceur. Personne, pas même Anny. Ils sont un peu pour moi comme des morts, un peu comme des héros de roman ; ils se sont lavés du péché d’exister. Pas complètement, bien sûr – mais tout autant qu’un homme peut faire.
p. 249
Est-ce que je ne pourrais pas essayer… Naturellement, il ne s’agirait pas d’un air de musique… mais est-ce que je ne pourrais pas, dans un autre genre…? IL faudrait que ce soit un livre : je ne sais rien faire d’autre. Mais pas un livre d’histoire : l’histoire, ça parle de ce qui a existé – jamais un existant ne peut justifier l’existence d’un autre existant. Mon erreur, c’était de vouloir ressusciter M. de Rollebon. Une autre espèce de livre. Je ne sais pas bien laquelle – mais il faudrait qu’on devine, derrière les mots imprimés, derrière les pages, quelque chose qui n’existerait pas, qui serait au-dessus de l’existence. Une histoire, par exemple, comme il ne peut pas en arriver, une aventure. Il faudrait qu’elle soit belle et dure comme de l’acier et qu’elle fasse honte aux gens de leur existence.
(…)
Naturellement, ça ne serait d’abord qu’un travail ennuyeux et fatigant, ça ne m’empêcherait pas d’exister ni de sentir que j’existe. Mais il viendrait bien un moment où le livre serait écrit, serait derrière moi et je pense qu’un peu de sa clarté tomberait sur mon passé. Alors peut-être que je pourrais, à travers lui, me rappeler ma vie sans répugnance. Peut-être qu’un jour, en pensant précisément à cette heure-ci, à cette heure morne où j’attends, le dos rond, qu’il soit temps de monter dans le train, peut-être que je sentirais mon cœur battre plus vite et que je me dirais : « C’est ce jour-là, à cette heure-là, que tout a commencé. » Et j’arriverais – au passé, rien qu’au passé – à m’accepter.p. 249-250