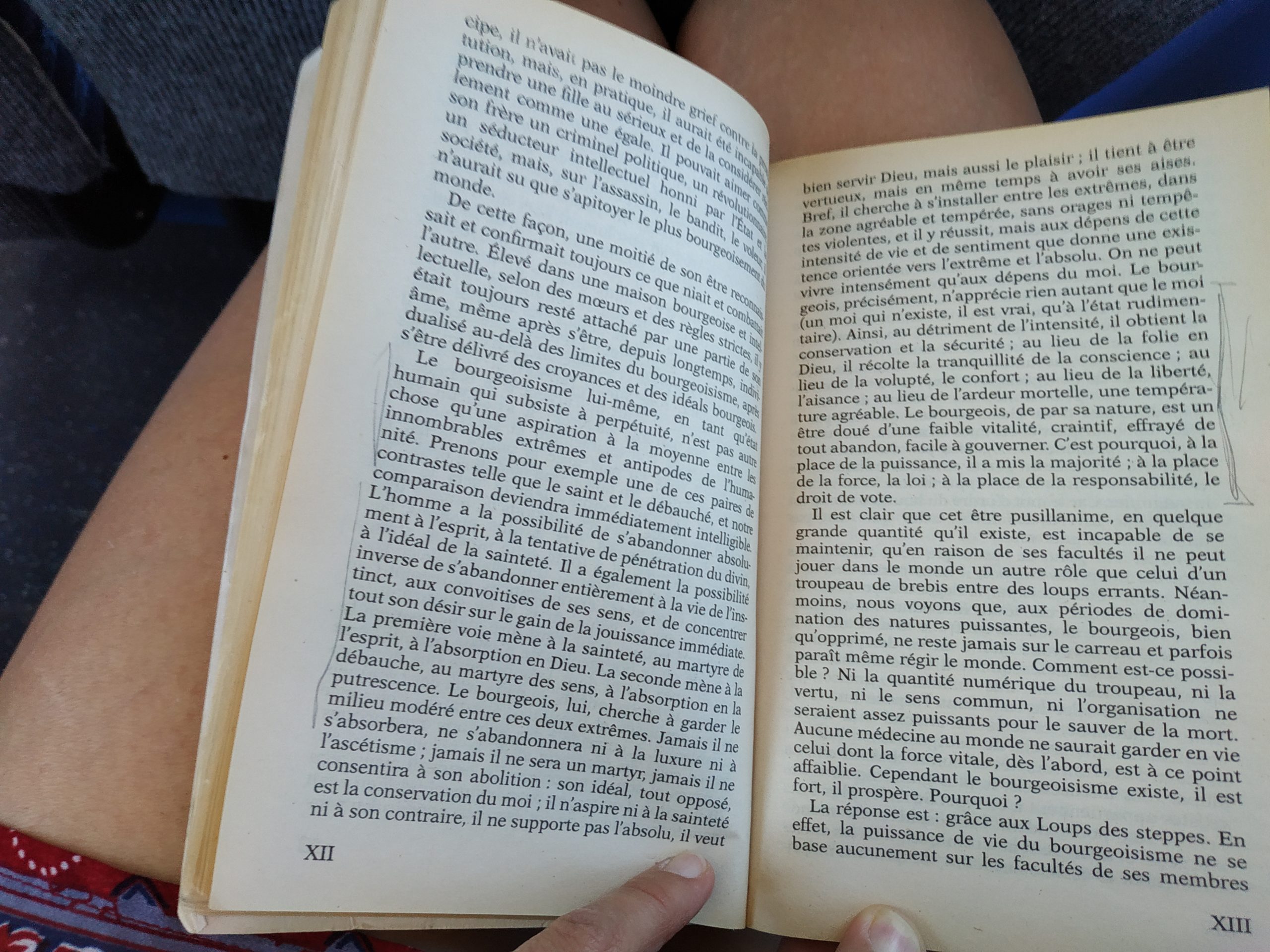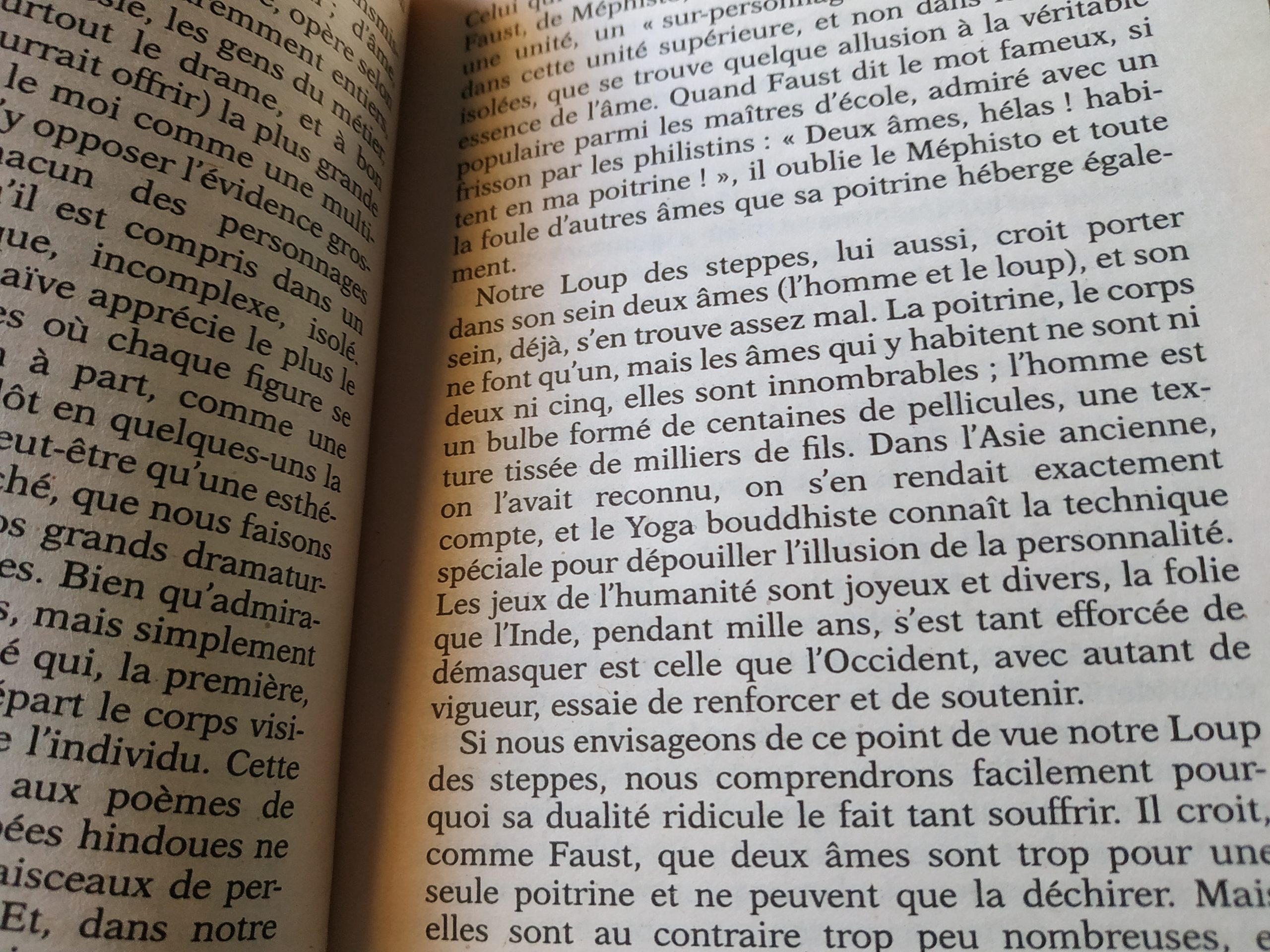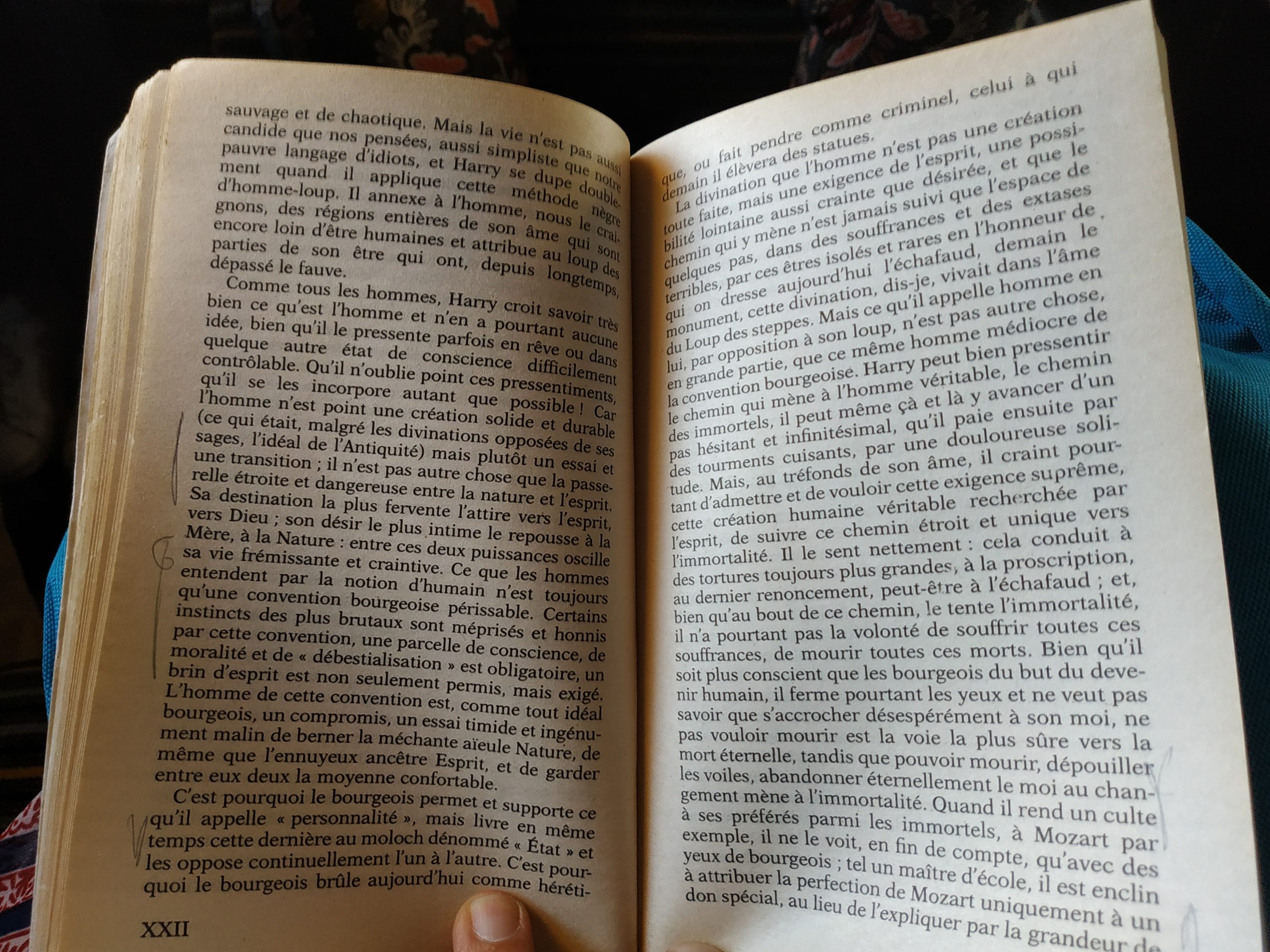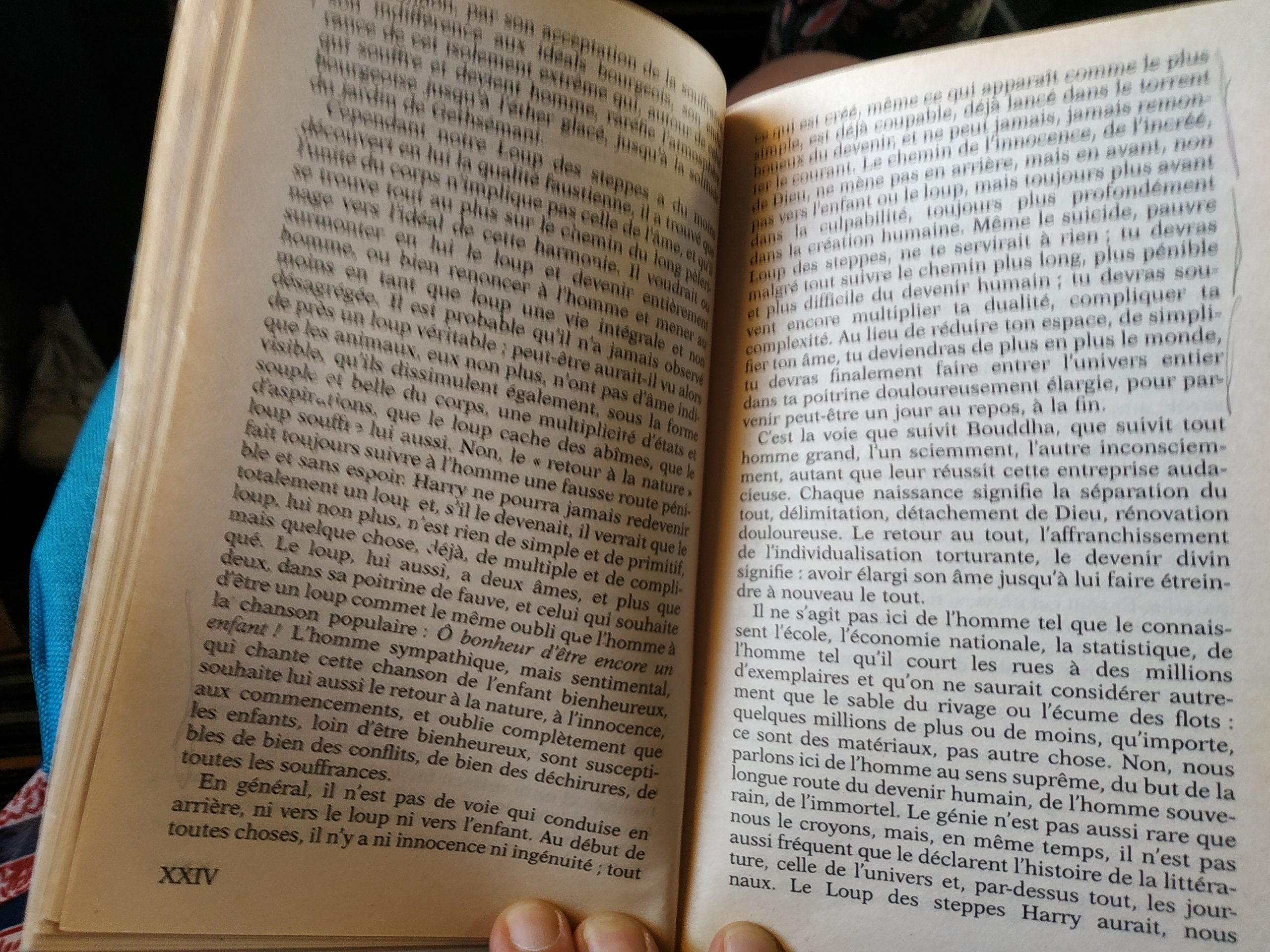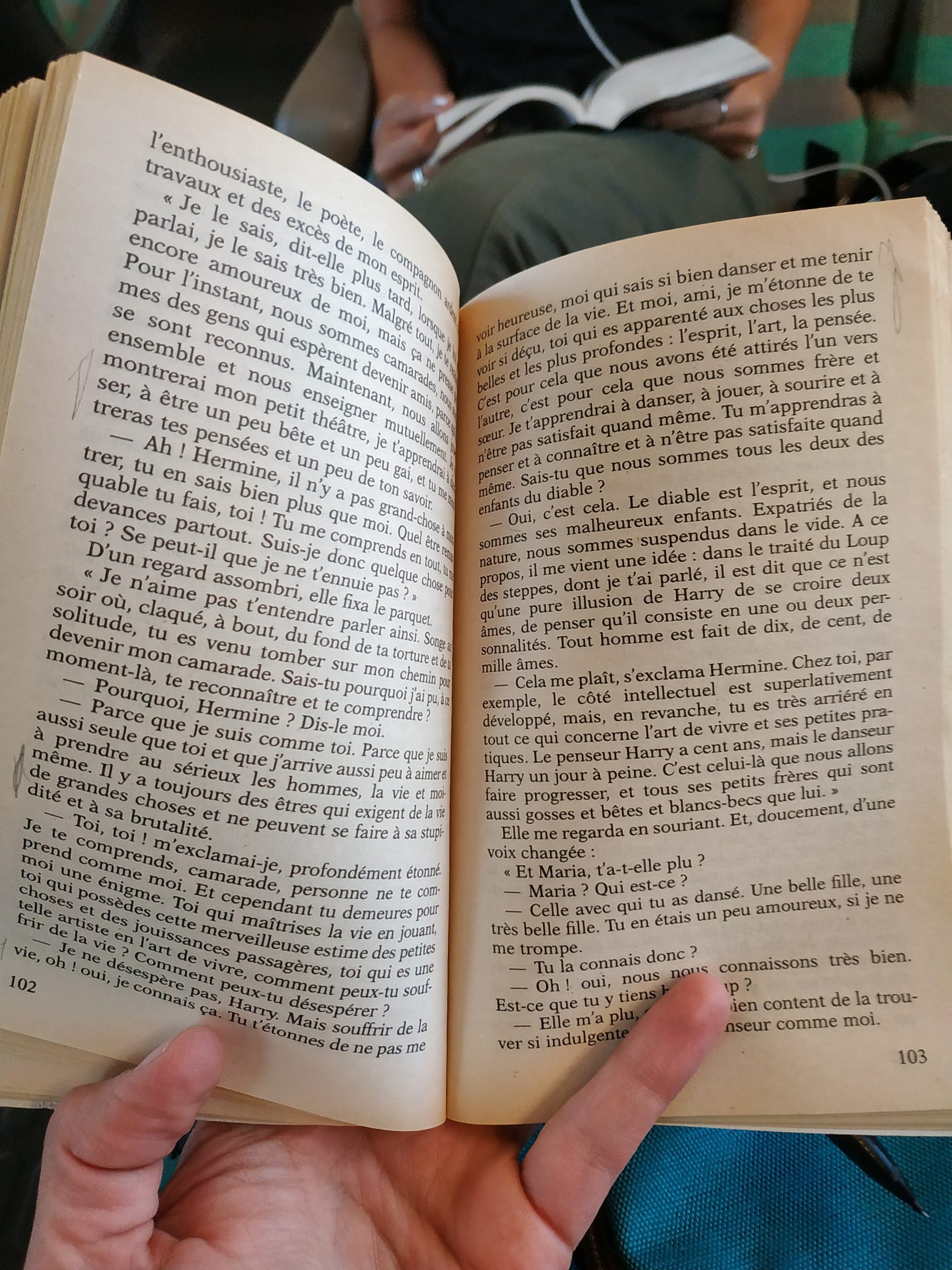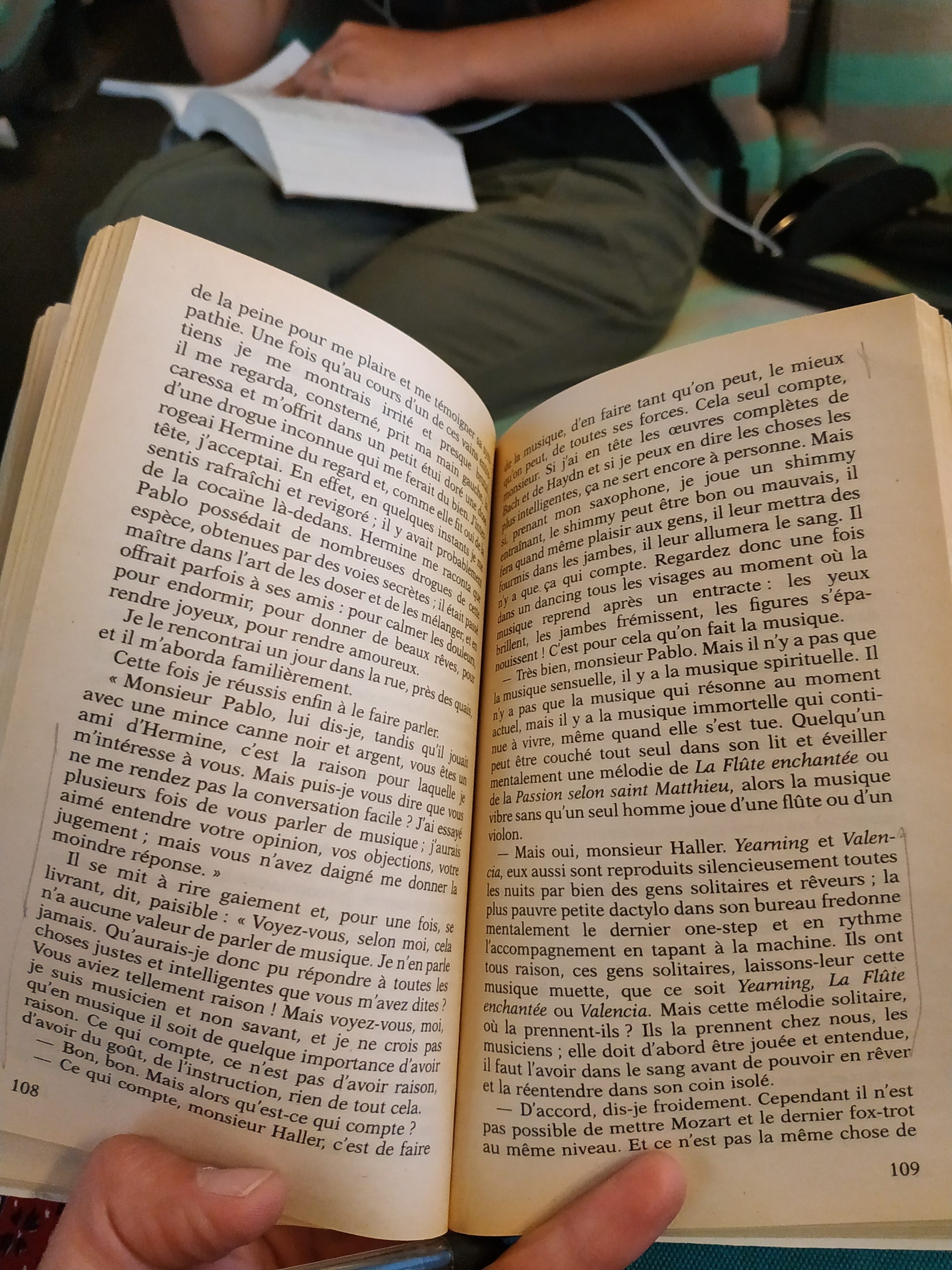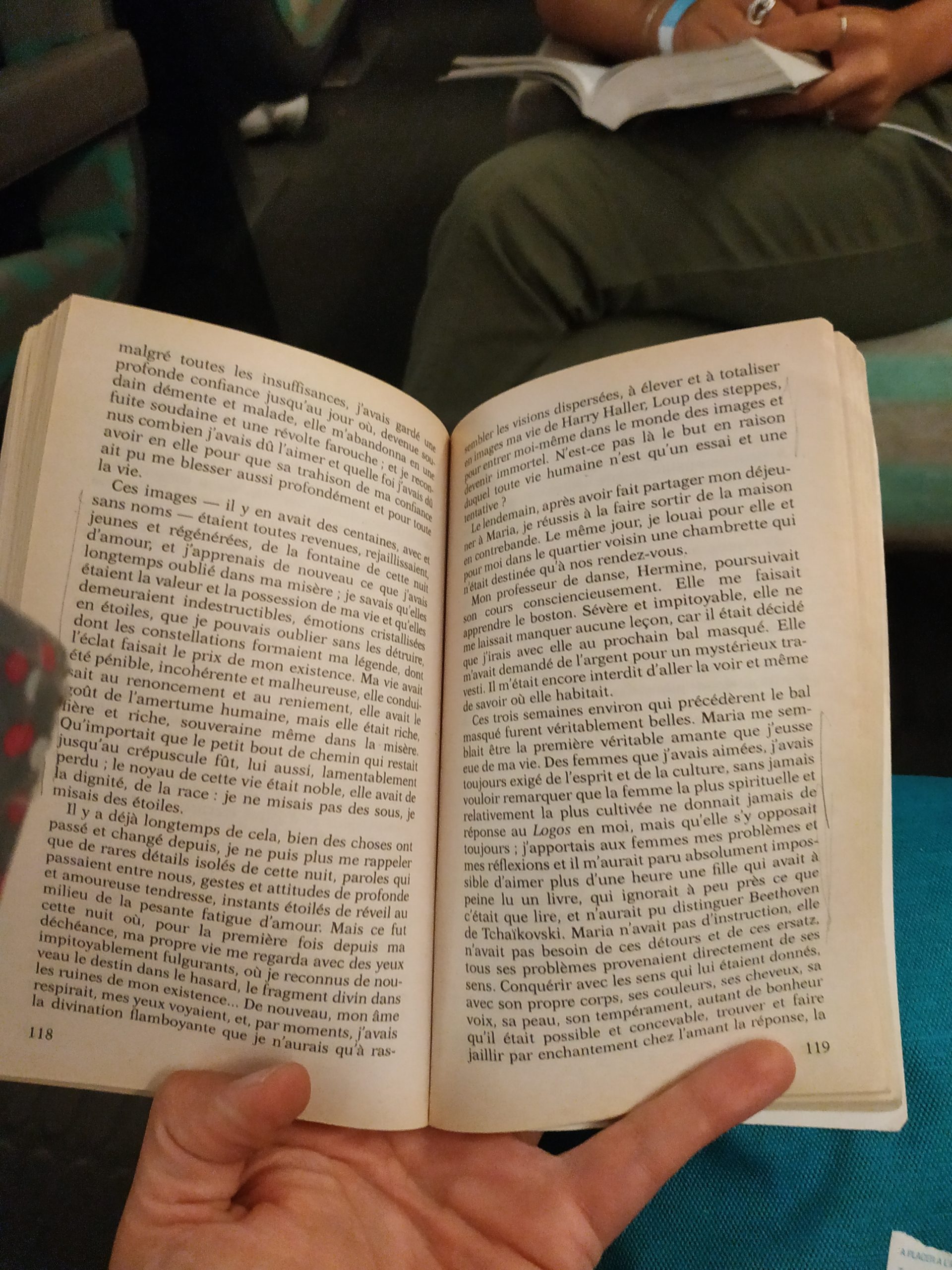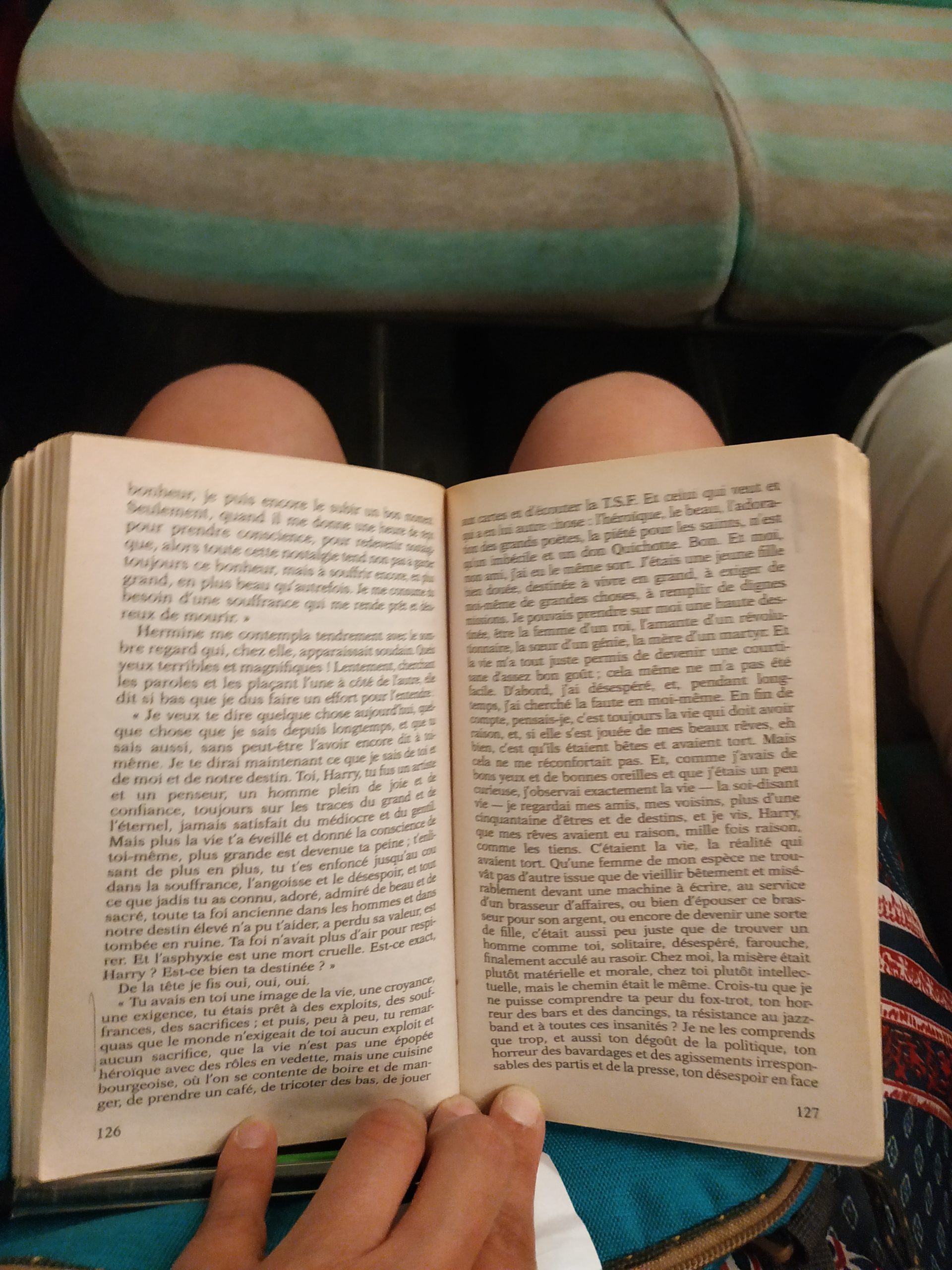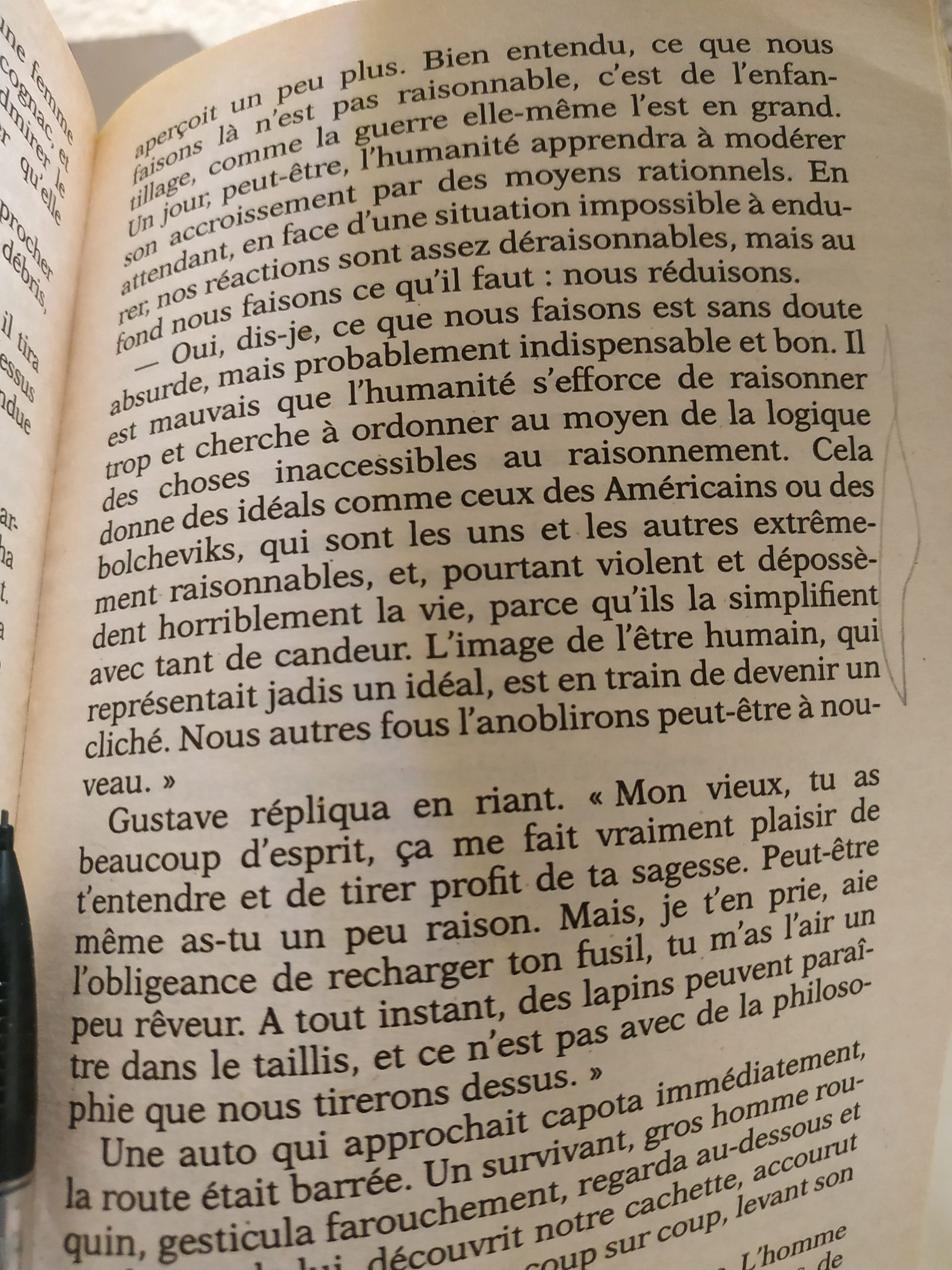Le propre du « suicidé » – et Harry l’était – n’est pas de se trouver forcément en relation constante avec la mort, mais de sentir son moi, à tort ou à raison n’importe, comme un germe particulièrement dangereux, douteux, menaçant et menacé de la nature ; c’est de se croire toujours exposé au danger, comme s’il se trouvait sur la pointe extrême d’un rocher d’où la moindre poussée du dehors et la moindre faiblesse du dedans peuvent suffire à précipiter dans le vide.
(…)
Ce cas était celui de Harry, le Loup des steppes. L’idée que le chemin de la mort lui était accessible à n’importe quel moment, il en fit comme des milliers de ses semblables, non seulement un jeu d’imagination d’adolescent mélancolique, mais un appui et une consolation. Il est vrai que tout bouleversement, toute souffrance, toute situation défavorable provoquaient immédiatement en lui, comme en tous ceux de son espèce, le désir de s’y soustraire par la mort. Mais, peu à peu, il transforma ce penchant en philosophie utile à la vie. L’accoutumance à l’idée que cette sortie de secours lui était toujours ouverte lui donnait de la force, le rendait curieux de goûter les douleurs et les peines et, lorsqu’il se sentait bien misérable, il lui arrivait d’éprouver une sorte de joie féroce : « Je suis curieux de voir combien un homme est capable de supporter. Si j’atteins à la limite de ce qu’on peut encore subir, eh bien, je n’ai qu’à ouvrir la porte et je serai sauvé ! »
(…)
Chacun d’eux, dans quelque recoin de son âme, sait fort bien que le suicide n’est qu’une sortie de secours piteuse et illégitime, et qu’il est plus beau et plus noble de se laisser vaincre et abattre par la vie elle-même que par sa propre main.p. VIII-X
Le Loup des steppes, en raison de sa propre conception, se trouvait absolument hors du monde bourgeois, puisqu’il ne connaissait ni vie de famille ni ambition sociale. Il se sentait exclusivement comme un être à part, tantôt comme un maniaque et un solitaire morbide, tantôt comme un individu aux aptitudes géniales, au-dessus des normes mesquines de la vie quotidienne. En toute conscience, il méprisait le bourgeois et se félicitait de n’en être pas un. Cependant, sous maint rapport, il vivait fort bourgeoisement, il avait de l’argent à la banque et secourait des parents pauvres ; il s’habillait sans recherche, mais convenablement et sobrement ; il cherchait à vivre en paix avec la police, le fisc et autres puissances. En outre, une nostalgie profonde et secrète l’attirait continuellement vers le petit monde bourgeois, vers les pensions de famille tranquilles et convenables, aux jardins proprets, aux escaliers astiqués, et à toute cette modeste atmosphère d’ordre et de décence.
(…)
Il ne se sentait chez lui ni dans l’atmosphère des hommes violents et exceptionnels, ni dans celle des criminels et des déclassés, et continuait à habiter la province bourgeoise, à entretenir des relations quelconques, fût-ce celle du contraste et de la révolte, avec ses normes et son atmosphère.p. XI
Le bourgeoisisme lui-même, en tant qu’état humain qui subsiste à perpétuité, n’est pas autre chose qu’une aspiration à la moyenne entre les innombrables extrêmes et antipodes de l’humanité. Prenons pour exemple une de ces paires de contrastes telles que le saint et le débauché, et notre comparaison deviendra immédiatement intelligible. L’homme a la possibilité de s’abandonner absolument à l’esprit, à la tentative de pénétration du divin, à l’idéal de la sainteté. Il a également la possibilité inverse de s’abandonner entièrement à la vie de l’instinct, aux convoitises de ses sens, et de concentrer tout son désir sur le gain de la jouissance immédiate. La première voie mène à la sainteté, au martyre de l’esprit, à l’absorption en Dieu. La seconde mène à la débauche, au martyre des sens, à l’absorption en la putrescence. Le bourgeois, lui, cherche à garder le milieu modéré entre ces deux extrêmes. Jamais il ne s’absorbera, ne s’abandonnera ni à la luxure ni à l’ascétisme ; jamais il ne sera un martyr, jamais il ne consentira à son abolition : son idéal, tout opposé, est la conservation du moi ; il n’aspire ni à la sainteté ni à son contraire, il ne supporte pas l’absolu, il veut bien servir Dieu, mais aussi le plaisir ; il tient à être vertueux, mais en même temps à avoir ses aises. Bref, il cherche à s’installer entre les extrêmes, dans la zone agréable et tempérée, sans orages ni tempêtes violentes, et il y réussit, mais aux dépens de cette intensité de vie et de sentiment que donne une existence orientée vers l’extrême et l’absolu. On ne peut vivre intensément qu’aux dépens du moi. Le bourgeois, précisément, n’apprécie rien autant que le moi (un moi qui n’existe, il est vrai, qu’à l’état rudimentaire). Ainsi, au détriment de l’intensité, il obtient la conservation et la sécurité ; au lieu de la folie en Dieu, il récolte la tranquillité de la conscience ; au lieu de la volupté, le confort ; au lieu de la liberté, l’aisance ; au lieu de l’ardeur mortelle, une température agréable. Le bourgeois, de par sa nature, est un être doué d’une faible vitalité, craintif, effrayé de tout abandon, facile à gouverner. C’est pourquoi, à la place de la puissance, il a mis la majorité ; à la place de la force, la loi ; à la place de la responsabilité, le droit de vote.
Il est clair que cet être pusillanime, en quelque grande quantité qu’il existe, est incapable de se maintenir, qu’en raison de ses facultés il ne peut jouer dans le monde un autre rôle que celui d’un troupeau de brebis entre des loups errants. Néanmoins, nous voyons que, aux périodes de domination des natures puissantes, le bourgeois, bien qu’opprimé, ne reste jamais sur le carreau et parfois paraît même régir le monde. Comment est-ce possible ? Ni la quantité numérique du troupeau, ni la vertu, ni le sens commun, ni l’organisation ne seraient assez puissants pour le sauver de la mort. Aucune médecine au monde ne saurait garder en vie celui dont la force vitale, dès l’abord, est à ce point affaiblie. Cependant le bourgeoisisme existe, il est fort, il prospère. Pourquoi ?
La réponse est : grâce au Loup des steppes. En effet, la puissance de vie du bourgeoisisme ne se base aucunement sur les facultés de ses membres normaux, mais sur celles des outsiders extrêmement nombreux, qu’il est capable de contenir par suite de l’indétermination et de l’extensibilité de ses idéals. Il demeure toujours dans le monde bourgeois une foule de natures puissantes et farouches. Notre Loup des steppes en est un exemple caractéristique. Lui, qui a évolué vers l’individualisme bien au-delà des limites accessibles au bourgeois, lui qui connaît la félicité de la méditation, ainsi que les joies moroses de la haine et de l’horreur de soi, lui qui méprise la loi, la vertu et le sens commun, est pourtant un détenu du bourgeoisisme et ne saurait s’en évader. C’est ainsi que s’accumulent autour de la masse fondamentale du bourgeoisisme proprement dit de vastes couches d’humanité, des milliers de vies et d’intelligences dont chacune, bien qu’échappée à l’élément bourgeois et destinée à l’absolu, se rattache encore à l’existence bourgeoise par des sentiments infantiles : infectée en partie par sa décroissance de vitalité, elle continue à lui appartenir, à la servir et à la magnifier. Car le mot d’ordre du bourgeoisisme est le principe inverti des forts : celui qui n’est pas contre moi est pour moi.
si c’est à ce point de vue-là que nus envisageons l’âme du Loup des steppes, il nous paraît destiné à être un non-bourgeois par le degré même qu’atteint son individualité, car toute individualisation poussée à l’extrême se tourne contre le moi et tend à le détruire. Nous voyons qu’il a en lui des penchants violents à la sainteté comme à la débauche, mais qu’une faiblesse ou une indolence quelconque l’empêche de faire le saut dans l’espace universel, libre et farouche, et le laisse attaché à la lourde constellation maternelle du bourgeoisisme. Telle est sa place dans l’univers, tel est son enchaînement. La plupart des intellectuels, le plus grand nombre des artistes appartiennent à ce type. Seuls les plus forts d’entre eux pourfendent l’atmosphère du monde bourgeois et atteignent au cosmique ; tous les autres se résignent et consentent à des compromis, méprisent le bourgeoisisme et pourtant lui appartiennent, le renforcent, le glorifient, puisque, finalement, ils sont forcés de le réaffirmer afin de pouvoir vivre.p. XII-XV
Il est facile au possédé divin d’admettre le criminel, et inversement ; mais, à eux deux et à tous les autres absolus, il est impossible d’admettre en outre le bourgeoisisme, cette moyenne neutre et tiède. Seul l’humour, trouvaille splendide des êtres entravés dans leur destination de grandeur, des presque-tragiques, des malheureux trop bien doués, seul l’humour (création la plus singulière et peut-être la plus géniale de l’humanité) réalise cette chose impossible, juxtapose et unit toutes les sphères humaines sous les radiations de ses prismes. Vivre au monde comme si ce n’était pas le monde, estimer la loi et rester pourtant au-dessus d’elle, posséder « comme si l’on ne possédait pas », renoncer comme si on ne renonçait pas, toutes ces exigences courantes et si souvent formulées de la science de vivre, seul l’humour est en état de les réaliser.
Et si le Loup des steppes, à qui ne manquent point les dons et les facultés nécessaires, réussissait encore, dans le dédale étouffant de son enfer, à bouillir, à mettre en fermentation avec sa sueur ce philtre magique, alors il serait sauvé. Pour ce faire, il lui manque encore bien des choses. Mais l’espoir et la possibilité existent. Que ceux qui l’aiment lui souhaitent ce sauvetage ! Ses souffrances deviendraient supportables, fécondes même, et, bien que lié pour toujours à la bourgeoisie, ses rapports avec elle, aimants ou haineux, perdraient leur sentimentalité, et son enchaînement à ce monde cesserait de le torturer comme une perpétuelle honte.
Pour atteindre à ce but, ou pour, en fin de compte, oser quand même le saut dans l’infini, ce Loup des steppes devrait être une bonne fois placé en face de lui-même, pénétrer du regard son propre chaos, devenir pleinement conscient de son être. Son existence problématique se révèlerait alors à ses yeux dans toute son inaltérabilité, et il deviendrait impossible à l’avenir de continuer, encore et toujours, à fuir l’enfer de ses sens pour se réfugier dans des consolations sentimentales et philosophiques, abandonnant de nouveau ces dernières pour recourir à l’ivresse aveugle de ses instincts de fauve. Le loup et l’homme seraient obligés de se reconnaître réciproquement sans camouflages sentimentaux, de se regarder, nus, entre les deux yeux. Ou bien ils éclateraient et divorceraient pour toujours, de sorte qu’il n’y aurait plus de Loup des steppes, ou bien ils feraient un mariage de raison, à la lumière de l’humour levant.p. XV-XVI
L’homme n’est point capable de penser dans une grande mesure, et même le plus cultivé, le plus intelligent d’entre les humains ne voit le monde et surtout ne se voit lui-même qu’à travers les lunettes de formules naïves, simplifiantes et falsificatrices. Car c’est, à ce qu’il paraît, un besoin inné et obligatoire de se représenter leur être comme une unité.
p. XIX
Quand, dans les âmes humaines douées d’une organisation délicate, éclot la prescience de leur multiplicité, quand elles brisent, comme tous les génies, l’illusion de l’unité individuelle et se sentent une multitude, un faisceau de moi disparates, elles n’ont qu’à l’exprimer pour que la majorité les enferme, appelle au secours la science, constate la schizophrénie et protège l’humanité contre l’appel à la vérité sortant de la bouche de ces malheureux.
(…)
Par conséquent, lorsqu’un homme s’enhardit à étendre l’unité illusoire de son moi à la dualité, il est déjà presque un génie, ou du moins une rare et intéressante exception. En réalité, aucun moi, même le plus naïf, n’est une unité, mais un monde extrêmement divers, un petit ciel constellé d’astres, un chaos de formes, d’états, de degrés, d’hérédités et de possibilités.p. XIX
Bien qu’admirables elles ne nous sont pas innées, mais simplement serinées, ces notions de l’Antiquité qui, la première, prenant toujours pour point de départ le corps visible, a inventé la fiction du moi, de l’individu. Cette notion est absolument inconnue aux poèmes de l’Inde ancienne ; les héros des épopées hindoues ne sont pas des personnes, mais des faisceaux de personnes, des séries d’incarnations. Et, ,dans notre monde moderne, il y a des œuvres qui essaient, probablement sans que l’auteur s’en rende pleinement compte, de représenter derrière les voiles des personnages et des caractères une multiplicité d’âme.
p. XX
Car l’homme n’est point une création solide et durable (ce qui était, malgré les divinations opposées de ses sages, l’idéal de l’Antiquité) mais plutôt un essai et une transition ; il n’est pas autre chose que la passerelle étroite et dangereuse entre la nature et l’esprit. Sa destination la plus fervente l’aspire vers l’esprit, vers Dieu ; son désir le plus intime le repousse à la Mère, à la Nature : entre ces deux puissances oscille sa vie frémissante et craintive. Ce que les hommes entendent par la notion d’humain n’est toujours qu’une convention bourgeoise périssable. Certains instincts des plus brutaux sont méprisés et honnis par cette convention, une parcelle de conscience, de moralité et de « débestialisation » est obligatoire, un brin d’esprit est non seulement permis, mais exigé. L’homme de cette convention est, comme tout idéal bourgeois, un compromis, un essai timide et ingénument malin de berner la méchante aïeule Nature, de même que l’ennuyeux ancêtre Esprit, et de garder entre eux deux la moyenne confortable.
C’est pourquoi le bourgeois permet et supporte ce qu’il appelle « personnalité », mais livre en même temps cette dernière au moloch dénommé « Etat » et les oppose continuellement l’un à l’autre. C’est pourquoi le bourgeois brûle aujourd’hui comme hérétique, ou fait pendre comme criminel, celui à qui demain il élèvera des statues.
La divination que l’homme n’est pas une création toute faite, mais une exigence de l’esprit, une possibilité lointaine aussi crainte que désirée, et que le chemin qui y mène n’est jamais suivi que l’espace de quelques pas, dans des souffrances et des extases terribles, par ces êtres isolés et rares en l’honneur de qui on dresse aujourd’hui l’échafaud, demain le monument, cette divination, dis-je, vivait dans l’âme du Loup des steppes. (…) Harry peut bien pressentir ce chemin qui mène à l’homme véritable, le chemin des immortels, ils peut même ça et là y avancer d’un pas hésitant et infinitésimal, qu’il paie ensuite par des tourments cuisants, par une douloureuse solitude. Mais, au tréfonds de son âme, il craint pourtant d’admettre et de vouloir cette exigence suprême, cette création humaine véritable recherchée par l’esprit, de suivre ce chemin étroit et unique vers l’immortalité. (…) Bien qu’il soit plus conscient que les bourgeois du but du devenir humain, il ferme pourtant les yeux et ne veut pas savoir que s’accrocher désespérément à son moi, ne pas vouloir mourir est la voie la plus sûre vers la mort éternelle, tandis que pouvoir mourir, dépouiller les voiles, abandonner éternellement le moi au changement mène à l’immortalité. Quand il rend un culte à ses préférés parmi les immortels, à Mozart par exemple, il ne le voit, en fin de compte, qu’avec des yeux de bourgeois ; tel un maître d’école, il est enclin à attribuer la perfection de Mozart uniquement à un don spécial, au lieu de l’expliquer par la grandeur de son abandon, par son acceptation de la souffrance, son indifférence aux idéals bourgeois, son endurance de cet isolement extrême qui, autour de celui qui souffre et devient homme, raréfie l’atmosphère bourgeoise jusqu’à l’éther glacé, jusqu’à la solitude du jardin de Gathsémani.p. XXII-XXIV
Non, le « retour à la nature » fait toujours suivre à l’homme une fausse route pénible et sans espoir. Harry ne pourrait jamais redevenir totalement un loup et, s’il le devenait, il verrait que le loup, lui non plus, n’est rien de simple et de primitif, mais quelque chose, déjà, de multiple et de compliqué. Le loup, lui aussi, a deux âmes, et plus que deux, dans sa poitrine de fauve, et celui qui souhaite d’être un loup commet le même oubli que l’homme à la chanson populaire : Ô bonheur d’être encore un enfant ! L’homme sympathique, mais sentimental, qui chante cette chanson de l’enfant bienheureux, souhaite lui aussi le retour à la nature, à l’innocence, aux commencements, et oublie complètement que les enfants, loin d’être bienheureux, sont susceptibles de bien des conflits, de bien des déchirures, de toutes les souffrances.
En général, il n’est pas de voie qui conduise en arrière, ni vers le loup ni vers l’enfant. Au début de toutes choses, il n’y a ni innocence ni ingénuité ; tout ce qui est créé, même ce qui apparaît comme le plus simple, est déjà coupable, déjà lancé dans le torrent boueux du devenir, et ne peut jamais, jamais remonter le courant. Le chemin de l’innocence, de l’incréé, de Dieu, ne mène pas en arrière, mais en avant, non pas vers l’enfant ou le loup, mais toujours plus avant dans la culpabilité, toujours plus profondément dans la création humaine. Même le suicide, pauvre Loup des steppes, ne te servirait à rien ; tu devras malgré tout suivre le chemin plus long, plus pénible et plus difficile du devenir humain ;tu devras souvent encore multiplier ta dualité, compliquer ta complexité. Au lieu de réduire ton espace, de simplifier ton âme, tu deviendras de plus en plus le monde, tu devras finalement faire entrer l’univers entier dans ta poitrine douloureusement élargie, pour parvenir peut-être un jour au repos, à la fin.p. XXIV-XXV
Il ne s’agit pas ici de l’homme tel que le connaissent l’école, l’économie nationale, la statistique, de l’homme tel qu’il court les rues à des millions d’exemplaires et qu’on ne saurait considérer autrement que le sable du rivage ou l’écume des flots : quelques millions de plus ou de moins, qu’importe, ce sont des matériaux, pas autre chose. Non, nous parlons ici de l’homme au sens suprême, du but de la longue route du devenir humain, de l’homme souverain, de l’immortel. Le génie n’est pas aussi rare que nous le croyons, mais, en même temps, il n’est pas aussi fréquent que le déclarent l’histoire de la littérature, celle de l’univers et, par-dessus tout, les journaux.
p. XXV
Je fus entraîné de par le monde dans des voyages égarés et épuisants, de nouvelles souffrances s’amoncelèrent, et de nouveaux péchés. Et, chaque fois, l’arrachement d’un masque, l’écroulement d’un idéal avaient été précédés de ce vide et de ce silence sinistres, de cette strangulation mortelle, de cet isolement et de cette désespérance, de ce morne enfer sans amour que j’avais à traverser de nouveau.
p. 44-45
Je regardais cet homme aimable avec sa bonne figure de savant, je trouvais la scène, au fond, un peu ridicule, mais je jouissais comme un chien affamé de cette bribe de chaleur, de cette gorgée d’affection, de cette bouchée d’estime. Le Loup des steppes Harry ricanait, attendri ; la bave inondait sa gueule sèche ;la sentimentalité le faisait ployer malgré lui.
p. 52
« Tiens, tiens, c’est la faute de tes parents ! Leur as-tu demandé, par hasard, si tu pouvais venir ce soir à l’Aigle-Noir ? L’as-tu fait ? Réponds, mais réponds donc ! Tu dis qu’ils sont morts depuis longtemps. Eh bien alors ? Si tu n’as pas voulu apprendre à danser dans ta jeunesse par pure obéissance – soit ! bien que je ne croie pas que tu aies été un petit garçon modèle, toi ! Mais plus tard ? Qu’as-tu fait plus tard, pendant toutes ces années ?
– Ah ! avouai-je, je ne le sais plus moi-même. J’ai étudié, j’ai fait de la musique, j’ai lu des livres, j’ai écrit des livres, j’ai voyagé.
– Drôles de vues que tu as sur la vie ! Ainsi, tu as toujours fait des choses difficiles et compliquées, et les choses simples, tu ne les as jamais apprises ? Pas le temps ? Pas envie ? Comme tu voudras ! Dieu merci, je ne suis pas ta mère. Mais, après ça, faire comme si tu avais essayé de tout, et que rien ne t’ait réussi, non, pas de ça, mon petit !
– Ne me grondez pas ! priai-je. Je le sais bien, allez, que je suis fou.
– Taratata ! Chansons que tout ça ! Tu n’es pas fou le moins du monde, monsieur le professeur, tu es même beaucoup moins fou qu’il ne le faudrait, à mon gout. Tu es bêtement intelligent, à la manière des professeurs. Allons, prends encore un sandwich. Après ça, tu me raconteras autre chose. »p. 65-66
« Ainsi, commença-t-elle, ainsi ce Goethe est mort il y a cent ans, et Harry l’aime bien et se fait de lui une idée merveilleuse, et c’est bien son droit, à Harry, pas vrai ? Mais le peintre, qui, lui aussi, est toqué de Goethe et s’en fait une image à sa façon, n’en a pas le droit, hein ? Et le professeur non plus, ni personne, parce que Harry n’aime pas ça ! Il ne supporte pas le goût des autres, il dit des sottises et puis il fiche le camp. S’il avait un brin d’esprit, il rirait tout bonnement du peintre et du professeur. S’il était fou, il leur jetterait leur Goethe à la tête. Mais, parce qu’il n’est qu’un gosse, il court à la maison et il a envie de se pendre. J’ai bien compris ton histoire, Harry. C’est une drôle d’histoire. Elle me fait rire. Halte, ne bois pas si vite ! On boit le bourgogne à petites gorgées, autrement il échauffe trop. Mais, à toi, il faut tout te dire, gosse que tu es ! »
p. 67-68
« Pareil en cela à tous les grands esprits, vous avec nettement reconnu et senti, monsieur de Goethe, le doute et le désespoir de la vie humaine : la splendeur du moment et sa misérable déchéance, l’impossibilité de payer autrement un bel élan autrement que par la geôle du quotidien, la nostalgie brûlante du royaume de l’esprit et sa lutte éternelle et mortelle contre la soif, sacrée elle aussi, de l’innocence perdue de la nature ; cette terreur de rester suspendu dans le vide et dans le doute, cette certitude d’être condamné au périssable, à l’imperfection, à l’éternel essai, au dilettantisme, bref, tout le sans-issue, l’impasse et le désespoir brûlant de l’humanité. Tout cela, vous l’avez connu, vous l’avez même avoué, et cependant, par l’exemple de votre vie, vous avez prêché le contraire, vous avez fait montre de foi et d’optimisme, vous avez feint, pour vous et pour les autres , de trouver une durée et un sens à nos efforts spirituels. Vous avez éconduit et assourdi les aveux de l’abîme, la voix de la désespérante vérité, en vous-même comme en Kleist et en Beethoven. Pendant des dizaines d’années, vous avez fait mine de prendre l’assemblage de savoir et de valeurs, la confection et la collection de lettres, toute votre existence sénile à Weimar, pour le moyen d’éterniser l’instant, que pourtant vous n’étiez capable que de momifier, de spiritualiser la nature que vous ne pouviez que styliser en masque. C’est cela, l’hypocrisie, que nous vous reprochons. »
(…)
« Mon petit, tu prends le vieux Goethe trop au sérieux. Prendre trop au sérieux les vieilles gens qui sont mortes, c’est leur faire du tort. Nous autres immortels, nous n’aimons pas cela, nous préférons la plaisanterie. Le sérieux naît, mon petit, je veux bien te révéler cela, d’une surestimation du temps. Moi aussi, jadis, j’ai surestimé la valeur du temps, c’est pourquoi je tenais à atteindre l’âge de cent ans. Mais, vois-tu, dans l’éternité, le temps n’existe pas, l’éternité n’est qu’un seul instant, juste assez pour une plaisanterie. »
En effet, il était devenu impossible de lui parler sérieusement ; il sautillait, joyeux et leste (…). Tandis qu’il brillait par ses écarts et ses entrechats, je songeai que cet homme-là, au moins, n’avait pas négligé d’apprendre la danse. Il dansait à merveille.p. 72-75
Mais ce dont j’avais un tel besoin, une soif si désespérée, ce n’était pas savoir et comprendre, c’était vivre, agir, m’élancer, sauter.
p. 82-83
Ne saisis-tu pas, monsieur le savant, que si je te plais, si j’ai à tes yeux de l’importance, c’est que je te suis une sorte de miroir, qu’il y a en moi quelque chose qui te comprend et te répond ? Au fond, tous les hommes devraient être les uns pour les autres de tels miroirs, se répondre et se correspondre ainsi, mais les fous comme toi deviennent facilement si butés qu’ils ne peuvent plus rien voir ni lire dans les yeux des autres ; ils ne s’en soucient plus. Et, qund un toqué de cette espèce retrouve soudain un visage qui le regarde vraiment, il découvre quelque chose comme une réponse et une parenté, alors, naturellement, cela lui fait plaisir.
p. 85
Attention, je vais te donner un petit bout de cette belle cuisse, tu vas voir. Là, ouvre la bouche… Oh ! Le monstre ! Voilà-t-il pas qu’il louche du côté des autres pour s’assurer qu’on ne l’a pas vu accepter une bouchée de ma fourchette Sois sans crainte, petit garçon modèle, je ne te compromettrai pas. Mais si tu as besoin pour ton plaisir de la permission des autres, tu n’es vraiment qu’un pauvre type !
p. 89
La lutte contre la mort, mon cher Harry, est toujours une chose belle, magnifique et respectable, de même que la lutte contre la guerre. Mais c’est en même temps du donquichottisme sans issue.
– Peut-être, m’écriai-je violemment, mais, avec des vérités comme celles-ci : que nous mourrons tous et que, par conséquent, on peut se moquer de tout, on rend toute la vie plate et bête. Faut-il donc tout abandonner, renoncer à tout esprit, à tout effort, à toute humanité, laisser gouverner l’argent et l’ambition et attendre la prochaine mobilisation en buvant des bocks ? »
Le regard que, maintenant, me jetait Hermine était bien curieux, un regard de camaraderie intime, amusé, malicieux, moqueur et, en même temps, si lourd de savoir et de gravité sans fond.
« Mais non, il ne le faut pas, dit-elle maternellement. Et ta vie ne devient pas plate et bête parce que tu sais que la lutte sera sans succès. Il serait bien plus plat, Harry, de lutter pour quelque bel idéal en croyant que tu l’atteindras. Les idéals sont-ils là pour être atteints ? Vivons-nous donc, nous autres, pour nous débarrasser de la mort ? Non, nous vivons pour la craindre et aussi pour l’aimer, et c’est grâce à elle que ce petit bout de vie, quelquefois, l’espace d’une heure, brûle d’une flamme si belle. Tu n’es qu’un enfant, Harry. Sois sage et viens avec moi, nous avons tant à faire. Je ne me soucierai plus aujourd’hui de la guerre ni des journaux. Et toi ? »
Oh ! moi, j’étais docile.p. 95
« Je ne peux pas ! dis-je, tout malheureux. oui, si j’étais un beau garçon ! Mais un vieil empoté comme moi, qui ne sait même pas danser – elle va se moquer de moi ! »
Hermine me regarda, méprisante.
« Et si je me moque de toi, moi ? Ca t’est égal ? Quel poltron tu fais ! Tous ceux qui s’approchent d’une femme risquent qu’on se moque d’eux ; c’est l’enjeu. Risque-toi donc, Harry, et au besoin laisse-la rire de toi – autrement je ne crois plus à ton obéissance. »p. 99
Pour l’instant, nous sommes camarades, nous sommes des gens qui espèrent devenir amis, parce qu’ils se sont reconnus. Maintenant, nous allons jouer ensemble, et nous enseigner mutuellement. Je te montrerai mon petit théâtre, je t’apprendrai à danser, à être un peu bête et un peu gai, et tu me montreras tes pensées et un peu de ton savoir.
– Ah ! Hermine, il n’y a pas grand-chose à montrer, tu en sais bien plus que moi. Quel être remarquable tu fais, toi ! Tu me comprends en tout, tu me devances partout. Suis-je donc quelque chose pour toi ? Se peut-il que je ne t’ennuie pas ? »
D’un regard assombri, elle fixa le parquet.
« Je n’aime pas t’entendre parler ainsi. Songe au soir où, claqué, au bout, du fond de ta torture et de ta solitude, tu es venu tomber sur mon chemin pour devenir mon camarade. Sais-tu pourquoi j’ai pu, à ce moment-là, te reconnaître et te comprendre ?
– Pourquoi, Hermine ? Dis-le moi.
– Parce que je suis comme toi. Parce que je suis aussi seule que toi et que j’arrive aussi peu à aimer et à prendre au sérieux les hommes, la vie et moi-même. Il y a toujours des êtres qui exigent de la vie de grandes choses et ne peuvent se faire à sa stupidité et à sa brutalité.
– Toi, toi ! m’exclamai-je, profondément étonné. Je te comprends, camarade, personne ne te comprend comme moi. Et cependant tu demeures pour moi une énigme. Toi qui maîtrises la vie en jouant, toi qui possèdes cette merveilleuse estime des petites choses et des jouissances passagères, toi qui es une telle artiste en l’art de vivre, comment peux-tu souffrir de la vie ? Comment peux-tu désespérer ?
– Je ne désespère pas, Harry. Mais souffrir de la vie, oh ! oui, je connais ça. Tu t’étonnes de ne pas me voir heureuse, moi qui sais si bien danser et me tenir à la surface de la vie. Et moi, ami, je m’étonne de te voir si déçu, toi qui es apparenté aux choses les plus belles et les plus profondes : l’esprit, l’art, la pensée. C’est pour cela que nous avons été attirés l’un vers l’autre, c’est pour cela que nous sommes frère et sœur. Je t’apprendrai à danser, à jouer, à sourire et à n’être pas satisfait quand même. Tu m’apprendras à penser et à connaître et à n’être pas satisfaite quand même. Sais-tu que nous sommes tous les deux les enfants du diable ?p. 102-103
« Monsieur Pablo, lui dis-je, tandis qu’il jouait avec une mince canne noir et argent, vous êtes un ami d’Hermine, c’est la raison pour laquelle je m’intéresse à vous. Mais puis-je vous dire que vous ne me rendez pas la conversation facile ? J’ai essayé plusieurs fois de vous parler de musique ; j’aurais aimé entendre votre opinion, vos objections, votre jugement ; mais vous n’avez pas daigné me donner la moindre réponse. »
Il se mit à rire et, pour une fois, se livrant, dit, paisible : « Voyez-vous, selon moi, cela n’a aucune valeur de parler de musique. Je n’en parle jamais. Qu’aurais-je donc pu répondre à toutes les choses justes et intelligentes que vous m’avez dites ? Vous aviez tellement raison ! Mais voyez-vous, moi, je suis musicien et non savant, et je ne crois pas qu’en musique il soit de quelque importance d’avoir raison. Ce qui compte, ce n’est pas d’avoir raison, d’avoir du goût, de l’instruction, rien de tout cela.
– Bon, bon. Mais alors qu’est-ce qui compte ?
– Ce qui compte, monsieur Haller, c’est de faire de la musique tant qu’on peut, le mieux qu’on peut, de toutes ses forces. Cela seul compte, monsieur.
(…)
– Mais oui, monsieur Haller, Yearning et Valencia, eux aussi sont reproduits silencieusement toutes les nuits par bien des gens solitaires et rêveurs ; la plus pauvre petite dactylo dans son bureau fredonne mentalement le dernier one-step et en rythme l’accompagnement en tapant à la machine. Ils ont tous raison, ces gens solitaires, laissons-leur cette musique muette, que ce soit Yearning, La Flûte enchantée ou Valencia. Mais cette mélodie solitaire, où la prennent-ils ? Ils la prennent chez nous, les musiciens ; elle doit d’abord être jouée et entendue, il faut l’avoir dans le sang avant de pouvoir en rêver et la réentendre dans son coin isolé.p. 108-109
Eh ! oui, j’avais souvent ressassé ces réflexions, non sans éprouver de temps en temps la soif violente de contribuer, moi aussi, une bonne fois, à modeler la réalité, à agir en être sérieux et responsable, au lieu d’évoluer éternellement dans l’esthétique et les idéologies. Mais cela finissait toujours par la résignation, par l’acceptation de la facilité. Messieurs les généraux et les grands industriels avaient bien raison : nous n’étions bons à rien, nous autres « intellectuels », bande de bavards intelligents, irresponsables, improductifs, ignorants de la réalité. Pouah ! Saleté ! Rasoir !
p. 112
Elle aurait mieux fait à ce moment-là de me laisser périr au lieu de me traîner et de me ravaler dans ce monde jouisseur, trouble, papillotant, où je resterais toujours, malgré tout, un étranger, et où étouffait et se consumait ce qu’il y avait de meilleur en moi.
p. 113
J’appris avant tout que ces joujoux, ces objets de luxe ces bijoux à la mode, n’étaient pas seulement des babioles et des brimborions inventés par les fabricants et les commerçants avides, mais qu’ils étaient justifiés, multiples, beaux ; que c’était un petit ou plutôt un grand monde d’objets ayant pour but unique de servir l’amour, d’affiner les sens, de raviver un univers inanimé et de le douer magiquement de nouveaux organes d’amour, de la bague à l’étui à cigarettes, du sac à main à la boucle de ceinture. Le sac n’était pas un sac, ni le porte-monnaie un porte-monnaie, ni l’éventail un éventail, ni les fleurs des fleurs, tout était matière plastique à l’amour, à la magie, à la tentation, tout n’était qu’arme, message, éclaireur, appel.
p. 120
« Tu avais en toi une image de la vie, une croyance, une exigence, tu étais prêt à des exploits, des souffrances, des sacrifices ; et puis, peu à peu, tu remarquas que le monde n’exigeait de toi aucun exploit et aucun sacrifice, que la vie n’est pas une épopée héroïque avec des rôles en vedette, mais une cuisine bourgeoise, où l’on se contente de boire et de manger, de prendre un café, de tricoter des bas, de jouer aux cartes et d’écouter la T.S.F. Et celui qui veut et qui a en lui autre chose : l’héroïque, le beau, l’adoration des grands poètes, la piété pour les saints, n’est qu’un imbécile et un don Quichotte. Bon. Et moi, mon ami, j’ai eu le même sort. J’étais une jeune fille bien douée, destinée à vivre en grand, à exiger de moi-même de grandes choses, à remplir de dignes missions. Je pouvais prendre sur moi une haute destinée, être la femme d’un roi, l’amante d’un révolutionnaire, la sœur d’un génie, la mère d’un martyr. Et la vie m’a tout juste permis de devenir une courtisane d’assez bon goût ; cela même ne m’a pas été facile. D’abord, j’ai désespéré, et, pendant longtemps, j’ai cherché la faute en moi-même. En fin de compte, pensais-je, c’est toujours la vie qui doit avoir raison, et, si elle s’est jouée de mes beaux rêves, eh bien, c’est qu’ils étaient bêtes et avaient tort. Mais cela ne me réconfortait pas. Et, comme j’avais de bons yeux et de bonnes oreilles et que j’étais un peu curieuse, j’observai exactement la vie – la soi-disant vie – je regardai mes amis, mes voisins, plus d’une cinquantaine d’êtres et de destins, et je vis, Harry, que mes rêves avaient eu raison, mille fois raison, comme les tiens. C’étaient la vie, la réalité qui avaient tort. Qu’une femme de mon espèce ne trouvât pas d’autre issue que de vieillir bêtement et misérablement devant une machine à écrire, au service d’un brasseur d’affaires, ou bien d’épouser ce brasseur pour son argent, ou encore de devenir une sorte de fille, c’était aussi peu juste que de trouver un homme comme toi, solitaire, désespéré, farouche, finalement acculé au rasoir. Chez moi, la misère était plutôt matérielle et morale, chez toi, plutôt intellectuelle, mais le chemin était le même. Crois-tu que je ne puisse comprendre ta peur du fox-trot, ton horreur des bars et des dancings, ta résistance au jazz-band et à toutes ces insanités ? Je ne les comprends que trop, et aussi ton dégoût de la politique, ton horreur des bavardages et des agissements irresponsables des partis et de la presse, ton désespoir en face de la guerre, celle qui fut et celle qui viendra, en face de la façon dont on pense aujourd’hui, dont on lit, dont on construit, dont on fait de la musique, dont on célèbre les cérémonies, dont on fabrique l’instruction publique ! Tu as raison, Loup des steppes, tu as mille fois raison, et pourtant tu dois périr. Tu es bien trop exigeant et affamé pour ce monde moderne, simple, commode, content de si peu ; il te vomit, tu as pour lui une dimension de trop. Celui qui veut vivre en notre temps et qui veut jouir de sa vie ne doit pas être une créature comme toi ou moi. Pour celui qui veut de la musique au lieu de bruit, de la joie au lieu de plaisir, de l’âme au lieu d’argent, du travail au lieu de fabrication, de la passion au lieu d’amusettes, ce joli petit monde-là n’est pas une patrie… »
(…)
Pour ne pas porter atteinte à la dignité du monde, je veux croire que ce n’est que notre époque, que ce n’est qu’une maladie, un malheur momentané. Les leaders travaillent vaillamment et victorieusement à la prochaine guerre, et nous autres, entre-temps, nous dansons le fox-trot, gagnons de l’argent et croquons des pralinés… A une pareille époque, le monde ne saurait avoir un aspect plus digne. Espérons que des temps ont été meilleurs et le seront encore, oui, meilleurs, plus riches, plus profonds, plus vastes. Quant à nous, nous ne nous en trouverons ni bien ni mal. Et peut-être en a-t-il toujours été de même…
(…) Oui, je pense que peut-être il en fut et il en sera toujours ainsi, et que ce qu’ils appellent dans les écoles « histoire universelle », ce qu’il faut apprendre par cœur pour être instruit, ces lieux communs sur les héros, les génies, les belles actions et les grands sentiments, tout ça n’est que du truquage inventé par les maîtres d’école pour que l’enseignement existe et pour que les gosses fassent quelque chose pendant l’année scolaire. Il en fut toujours ainsi, il en sera toujours ainsi ; la puissance et l’argent, le temps et le monde appartiennent aux petits, aux mesquins, et les autres, les êtres humains véritables, n’ont rien. Rien que la mort.
– Pas autre chose ?
– Si, l’éternité.
– Tu entends par là le nom, la gloire pour la postérité ?
– Non, mon Loup, pas la gloire… A-t-elle donc de la valeur ? Et crois-tu que tous les hommes vraiment grands, vraiment accomplis, soient devenus célèbres et connus par la postérité ?
– Bien entendu, non.
– Donc, ce n’est pas la gloire. La gloire, ça n’existe que pour l’enseignement, c’est un truc des maîtres d’école. Ce n’est pas la gloire, oh ! non. Mais c’est ce que j’appelle éternité. Les croyants l’appellent royaume de Dieu. Il me semble à moi que nous autres, les exigeants, ceux qui ont une dimension de trop, ceux qui sont nostalgiques, ne pourrions pas vivre s’il n’y avait pas d’autre air à respirer que l’atmosphère de ce monde, si, en dehors du temps, il n’existait pas l’éternité : car c’est elle le domaine du vrai. C’est à elle qu’appartiennent la musique de Mozart et les vers de tes grands poètes, c’est à elle qu’appartiennent les saints, ceux qui ont fait des miracles, souffert le martyre et donné un grand exemple aux hommes. Et de même appartiennent à l’éternité l’image de toute action vraie, la puissance de tout sentiment réel, même si personne ne s’en doute, le ne voit, ne le fixe et ne le garde pour la postérité. Pour l’éternité, il n’y a pas de survivants, il n’y a que des contemporains.p. 126-130
Il fait bon dire adieu, cela rend plus doux.
p. 137
Cette nuit, au bal, il me fut donné d’éprouver une sensation que j’avais ignorée pendant cinquante ans, bien que tout étudiant, toute midinette la connussent : la sensation de la fête, la griserie de la fraternité en liesse, la fusion mystérieuse de l’individu avec la foule, l’Union Mystique de la joie. J’en avais souvent entendu parler ; chaque femme de chambre l’avait ressentie fréquemment ; j’avais vu briller les yeux de celui qui en parlait et j’avais eu un sourire moitié envieux, moitié supérieur. Ce rayonnement dans le regard enivré d’un homme enlevé à lui-même, affranchi de sa personnalité, ce sourire et cet abandon à moitié dément de celui qui se noie dans la griserie de la communauté, je l’avais vu des centaines de fois en des exemples nobles et vulgaires, matelots et troupiers soûls, grands artistes dans l’enthousiasme des représentations extraordinaires, jeunes soldats partant pour la guerre ; tout dernièrement encore, j’avais admiré, aimé, raillé et envié ce rayonnement et ce sourire du bienheureux ravi à lui-même sur le visage de mon ami Pablo, suspendu, dans l’ivresse de la musique, à son cher saxophone, ou contemplant, extatique, le chef d’orchestre, le tambour, l’homme au banjo.
(…) Je n’étais plus moi, ma personnalité s’était dissoute dans la fête comme le sel dans l’eau. Je dansais avec celle-là ou celle-ci, mais ce n’étais pas elle seulement que je tenais dans mes bras, dont les cheveux m’effleuraient, dont le parfum me captivait, c’étaient toutes, toutes les autres femmes qui flottaient dans la même salle, la même musique, la même danse, et dont les visages radieux se balançaient devant moi, pareils à de grandes fleurs fantastiques ; toutes m’appartenaient, j’appartenais à toutes ; nous participions tous les uns aux autres.p. 145-146
« Ah ! pensais-je en reprenant haleine, qu’importe maintenant ce qui m’arrive, puisque moi aussi, fût-ce une fois, j’ai été heureux, rayonnant, délivré de moi-même, un enfant, un frère de Pablo. »
p. 147
– Oui, dis-je, ce que nous faisons est sans doute absurde, mais c’est probablement indispensable et bon. Il est mauvais que l’humanité s’efforce de raisonner trop et cherche à ordonner au moyen de la logique des choses inaccessibles au raisonnement. Cela donne des idéals comme ceux des Américains ou des bolcheviks, qui sont les uns et les autres extrêmement raisonnables, et, pourtant, violent et dépossèdent horriblement la vie, parce qu’ils la simplifient avec tant de candeur. L’image de l’être humain, qui représentait jadis un idéal, est en train de devenir un cliché. Nous autres fous l’anoblirons peut-être à nouveau. »
p. 165